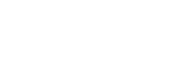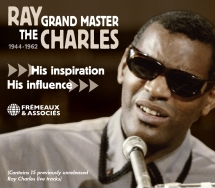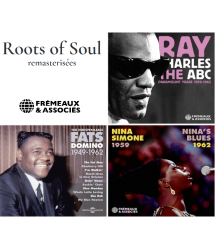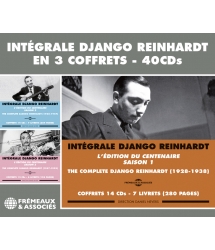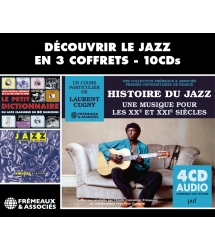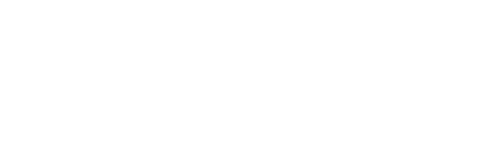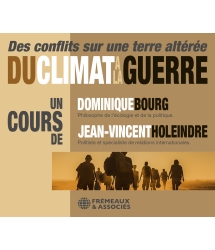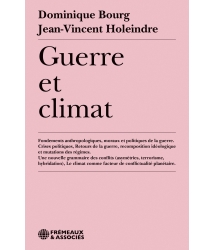« Tout le monde a encore en tête la déclaration du chef d’état-major des armées, le général Mandon, concernant le fait qu’il faut se préparer « à accepter de perdre nos enfants »… et Matignon s’apprête à dévoiler le guide « Tous responsables » destiné à former la résilience populationnelle française face à la recrudescence des risques systémiques, dont la guerre.
Dans leur dialogue, Guerre et climat. Fondements anthropologiques, moraux, retours de la guerre, recomposition idéologique et mutations des régimes (Frémeaux & Associés, 2025), Dominique Bourg et Jean-Vincent Holeindre échangent sur les nouvelles modalités de la guerre, quand le climat redevient un acteur majeur de la conflictualité. La guerre est « de retour », nourrie par la fragilisation des démocraties, l’appétit autoritaire des grandes puissances et le déclin de la promesse progressiste.
L’idéal de paix par le commerce s’est effondré. La mondialisation, loin d’ouvrir les régimes, a consolidé les économies de guerre : la Russie finance ses missiles avec son gaz ; la Chine durcit son contrôle ; les États-Unis ont basculé dans une diplomatie où le « deal » fait office de doctrine belliqueuse.
Le monde redevient un jeu à somme nulle, où « survivre, c’est vaincre » (Raymond Aron). Dans ce paysage, l’habitabilité même de la Terre se délite : mégafeux, vagues de chaleur, pollutions invisibles, effondrements de montagnes. Les tensions migratoires, la raréfaction des ressources, l’empoisonnement des fleuves ou la géo-ingénierie délirante participent d’une « reconfiguration planétaire » où la guerre contre la nature redéfinit le politique.
Les auteurs décrivent aussi le basculement d’un monde post-guerre froide vers une désoccidentalisation. La guerre interétatique ne suffit plus : nous évoluons vers une forme de guerre civile généralisée où le crime est institutionnalisé. L’exemple russe en Ukraine est central : la violence extrême est normalisée, intégrée au projet politique, utilisée pour racheter des criminels et galvaniser une population travaillée par la propagande.
S’ajoute une dynamique globale : bellicisation de l’économie, appétits territoriaux des anciens empires dans un monde sans croissance, multiplication des conflits internationalisés (Ukraine, Syrie, Yémen, Gaza). Les auteurs rappellent que les précédentes déstabilisations syriennes ou yéménites ont eu pour moteur initial une sécheresse extrême, préfiguration de ce que deviendra une planète à + 2 °C.
Bourg et Holeindre replacent la guerre dans le cadre des limites planétaires : altération de l’habitabilité, réduction des surfaces viables, intensification des événements extrêmes. La mondialisation apparaît alors comme une guerre au climat, une guerre au vivant. Et la diplomatie, encore largement construite sur le seul paradigme interétatique, peine à saisir un problème « sans passeport » (Kofi Annan). »
Par Cynthia FLEURY – L’HUMANITE