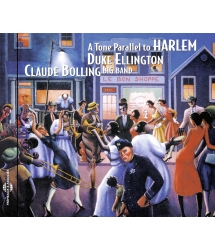Cet album consacré à Duke Ellington comprend des enregistrements de 1999, deux inédits d’un concert du Big Band à la Maison de Radio France en février 1991, des reprises d’albums antérieurs (First Class, Warm Up The Band, etc., permettant ainsi d’entendre Stéphane Grappelli, Fernand Vers solos ; une sorte de salut anthologique de Claude Bolling au talent du maestro illustré par des pièces diverses : le pianiste nourri par l’école du piano stride de Harlem, le créateur du jungle style marqué par la Harlem Renaissance, le maître du big band de l’époque classique né au Cotton Club, enfin le compositeur puissant et fécond de l’après-guerre. Claude Bolling et ses compagnons musiciens sont parvenus à rendre un bel hommage au grand musicien. Fidèles à l’esprit du compositeur et respectueux de sa musique, ils nous en donnent une lecture classique et vivante. Les solos de piano rappellent que Claude Bolling est un des grands spécialistes du stride (« Lot O’Fingers ») et un virtuose de l’instrument (« Caravan »). Le programme compte deux compositions personnelles, écrites en hommage au Duke, quelques grands classiques du Cotton Club Orchestra et du Famous Orchestra mais aussi de moins connus et non moins intéressants, qui jalonnent cette œuvre immense. Les musiciens du big band maîtrisent parfaitement ce langage. On apprécie particulièrement la cohésion de la formation dans des ensembles bien équilibrés. Les chorus de Michel Delakian et Michel Bonnet(tp), Claude Tissendier (as) et Pierre Schirrer (ts) ressortent. Mais arrêtons-nous sur la première pièce, « A Tone Parallel », elle mérite attention. Dans l’ouvrage d’A. Berini et G.M. Volonte, Duke Ellington, Un genio, un mito (Ponte Alle Grazie, Milan 1994, 730p), un chapitre entier est consacré aux suites et notamment à A Tone Parallel to Harlem. On compte une bonne douzaine de versions, publiées ou inédites, de cette pièce par l’orchestre du Duke Ellington dont les concerts de Seattle (25 mars 1952) et de Londres (21 février 1964), qui ont servi (avec la participation incomplète prêtée par Mercer Ellington) de référence à cette réalisation de Claude Bolling. La première avait été donné le 21 janvier 1951 en concert au Metropolitan Opera et le premier enregistrement effectué le 7 décembre 1951. La partition de « Harlem », ainsi dénommée habituellement, a vraisemblablement été écrite autour de 1950, au retour d’Europe. Elle avait en fait été commandée pour l’orchestre de la NBC, alors dirigé par Arturo Toscanini ; le maître avait sollicité la contribution d’un certain nombre de compositeurs américains à une œuvre collective en forme d’opéra, Portrait of New York Suite. Le projet ne vit jamais le jour, mais Duke Ellington avait produit sa part. La partition originale était écrite pour formation symphonique et orchestre de jazz. Duke, à cette occasion , se frotte à l’écriture symphonique et en respecte les règles essentielles. Il lui applique les principes déjà mis en œuvre dans son orchestre : opposition des pupitres et mise en valeur des timbres de chaque instrument, un traitement sonore des sections instrumentales hérité de sa propre expérience d’orchestrateur de jazz. Duke, à cette occasion, se frotte à l’écriture symphonique et en respecte les règles essentielles. Berini et Volonte soutiennent que la synthèse entre deux esthétiques musicales, jazz et classique, n’est pas aboutie. Mais était-ce bien le projet d’Ellington? Sa construction n’est-elle pas au contraire la volonté délibérée de les confronter dans leur logique propre? Duke n’a pas renoncé à son identité, et cette musique reste intrinsèquement ellingtonienne, et l’orchestre symphonique (cf. l’enregistrement de Cincinnati), parvient à se transcender pour acquérir une vraie souplesse rythmique. La réunion avec formation symphonique étant rare, Ellington en a réalisé une version exclusivement jazz, assez souvent jouée dans ses concerts entre 1953 et 1970, celle que donne ici le grand orchestre de Claude Bolling. C’est en général la préférée des amateurs de jazz. Cependant, l’unanimité ne s’est jamais faite sur cette œuvre difficile qui ne laisse aucune place à l’aventure individuelle, chacun encourant à l’œuvre collective. Certains y ont vu, à cause de sa densité structurelle et de l’austérité quelque peu solennelle qui s’en dégage, une pièce prétentieuse. Pourtant, jamais œuvre ne fut aussi ellingtonienne que celle-ci, par le ton, par la couleur, par le rythme, par l’orchestration, par l’esprit même d’une grande cohérence musicale. La pièce, d’un seul corps et sans interruption, comprend en fait deux parties. Chacune d’elles est construite autour d’un thème unique : les deux syllabes de « Harlem », en leitmotiv growlés comme un blues, lancées de manière incantatoire par la trompette, servent au développement et à l’élaboration de la première partie. Un hymne traité en forme de gospel song sert de support à la seconde partie. Le chant d’église, en opposition, se métamorphose successivement au cours du développement de gospel song en musique de cabaret, pour devenir marche américaine, le tout dans une expression où le swing reste permanent. Par son dessin affirmé, par son organisation en plans de la masse orchestrale, aux tonalités soutenues, aux teintes sombres, cet Ellington sans complaisance, taillé à la serpe, joue de l’orchestre. Et « Harlem » qui tranche pour ces raisons sur ses autres grandes compositions (suites) par sa dominante orchestrale, doit être classée dans la catégorie des poèmes symphoniques. Cette œuvre, certes solennelle, qui se veut être une évocation du quartier de Harlem, n’est pas une lecture exotique du ghetto. Elle recompose superbement de l’intérieur la vie multiforme de cet univers cosmopolite, des minorités diverses et rassemblées par la musique de leurs différences culturelles, reconstituées dans une américanité afro-américaine. Il y a dans cette réalisation ellingtonienne plus d’une parenté avec Rhapsody in Blue de Gerschwin, composée cinquante ans avant. En contrepoint d’une autre de ses œuvres des années soixante. People, ce poème symphonique, glorification d’une négritude assumée, reconstitue dans le langage du jazz, la mythologie quotidienne du peuple de Harlem. Nous ne pouvons que nous réjouir que ce répertoire soit repris par des orchestres, comme celui dirigé par Claude Bolling ou par Wynton Marsalis au Lincoln Center qui s’attache à perpétuer dans leur logique d’interprétation (la version de Claude Bolling est à plus d’un titre remarquable) l’œuvre de Duke Ellington, pianiste emblématique, chef d’orchestre mythique et compositeur de génie, musicien à n’en pas douter le plus original de la civilisation américaine. Félix W.SPORTIS – JAZZ HOT
- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire
Mon panier
Total TTC
0,00 €
Sous-total
gratuit
Livraison
Total produit(s)
0 articles
Livraison
gratuit
Sélectionnés pour vous

Roots of Soul remasterisées - Offre 14 CD
RAY CHARLES, FATS DOMINO, NINA SIMONE
Version CD
119,00 €
Version Numérique
79,95 €

Django Reinhardt - Les 40 CD de l'intégrale (Saison 1, 2 et 3)
L'intégrale 1928-1953
Version CD
199,00 €
Version Numérique
149,95 €

Compositeurs - L'offre 6 coffrets CD
Michel Magne, Nino Rota, Georges Delerue, Maurice Jarre,...
Version CD
134,00 €
Version Numérique
99,95 €

Découvrir le jazz
Le jazz raconté par Laurent Cugny - Le dictionnaire et...
Version CD
89,00 €
Version Numérique
55,95 €
Sélectionnés pour vous
L’éditeur de référence du patrimoine musical et de la Librairie Sonore



Mon panier
Total TTC
0,00 €
Sous-total
gratuit
Livraison
Total produit(s)
0 articles
Livraison
gratuit
Sélectionnés pour vous

Roots of Soul remasterisées - Offre 14 CD
RAY CHARLES, FATS DOMINO, NINA SIMONE
Version CD
119,00 €
Version Numérique
79,95 €

Django Reinhardt - Les 40 CD de l'intégrale (Saison 1, 2 et 3)
L'intégrale 1928-1953
Version CD
199,00 €
Version Numérique
149,95 €

Compositeurs - L'offre 6 coffrets CD
Michel Magne, Nino Rota, Georges Delerue, Maurice Jarre,...
Version CD
134,00 €
Version Numérique
99,95 €

Découvrir le jazz
Le jazz raconté par Laurent Cugny - Le dictionnaire et...
Version CD
89,00 €
Version Numérique
55,95 €
Sélectionnés pour vous
- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire