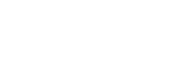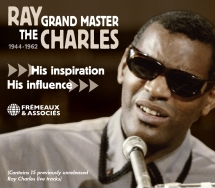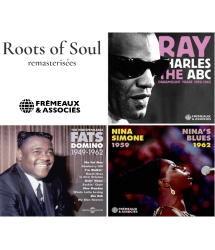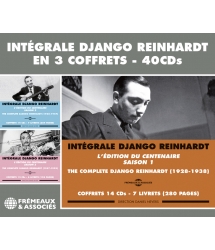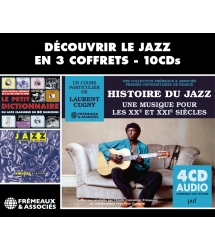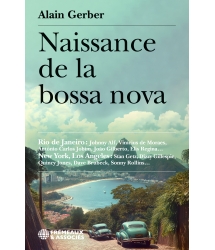« Une fois n’est pas coutume, l’auteur de cette chronique avoue n’avoir pratiquement rien connu de la bossa nova avant d’avoir lu le livre d’Alain Gerber. Ou alors ce n’est qu’une impression, tant ce livre lui a ouvert les yeux et les oreilles sur des rythmes et des harmonies qu’il avait en tête sans les identifier formellement. Tout cela pour dire que Naissance de la bossa nova est un titre bien modeste pour un ouvrage d’une érudition qui, certes, ne surprend pas de la part de l’auteur, mais se déploie d’un air si naturel qu’on ne se doute pas de la somme de travail qu’a sûrement nécessité la quantité de références précises qu’il propose.
Il y a la « genèse à Rio de Janeiro », avec les « pères fondateurs » (Vinicius de Moraes, Antônio Carlos « Tom » Jobim, Joấo Gilberto), un certain nombre de chanteurs et chanteuses comme Chico Buarque ou Nara Leấo, et il y a la « jeunesse à New York et ailleurs dans le monde », dont Dizzy Gillespie et Stan Getz sont des figures dominantes, mais non uniques. La première phrase de l’histoire résume un état des lieux implacable : « Grâce à Dizzy Gillespie surtout, le jazz s’est afrocubanisé dans les années 40. Grâce à Stan Getz entre autres, le jazz s’est brésilianisé au début des années 60. » On s’attend donc à apprendre beaucoup de choses au fil des pages, et cette attente n’est pas déçue ! On apprend, par exemple, que l’expression bossa-nova a été utilisée pour la première fois dans une chanson de Mendonça, et d’ailleurs qu’à l’origine les bossas-novas sont essentiellement des chansons avec des paroles qui « leur collent à la peau » ; que la « nonchalance » apparente du genre est loin d’être un « relâchement rythmique », que « des sanitaires ont servi de maternité à la bossa-nova », que la chanson Tu verras chantée par Nicole Croisille et Claude Nougaro est de Chico Buarque (O Que Sera), que Stan Getz a inventé le « Brésil universel », « un pays de nulle part, plein d’ombres et de reflets, de mirages et de réminiscences. »
On le voit, ce n’est pas parce qu’Alain Gerber nous fait partager ses connaissances qu’il abandonne son costume d’écrivain. Même dans un livre historique abondamment documenté, il s’adonne à des considérations bien pensées sur les mystères de « l’invention mélodique », sur la musique codifiée, sur « la science harmonique » qui n’explique pourtant pas « ce qui fait qu’un certain agencement de notes trouvera un écho sur la sensibilité universelle. » Et il ne se prive pas, pour notre plus grand plaisir, de laisser se développer son style ô combien séduisant. Au hasard, un exemple à propos du « L.A. Four » : « Prolifique, professionnel en diable, prodigue en performances instrumentales, délicieux sans conteste, mais aussi, comment dire ?... facultatif, essentiellement distractif. Sans faiblesses et sans reproche. Sans folie et sans nécessité non plus. […] La démagogie n’a pas cours chez les Quatre de Los Angeles. Et la mièvrerie ne pouvait compter sur eux pour s’épanouir : montrer leurs muscles ne fut pas leur préoccupation majeure ; en revanche leur musique en quête de raffinement restait en toute circonstance remarquablement articulée. » Ce ne sont là que quelques lignes parmi de nombreuses non moins prenantes, à la manière de la bossa nova elle-même que, pour changer un peu de plume, Patrick Frémeaux définit en quelques mots dans sa note liminaire : « La bossa nova incarne cette élégance nonchalante qui nous charme immédiatement et qui a vite su conquérir bien au-delà des frontières brésiliennes. » Laissons-nous prendre par cette musique comme par la prose élégante d’Alain Gerber. »
Par Jean-Pierre LONGRE – NOTES ET CHRONIQUES