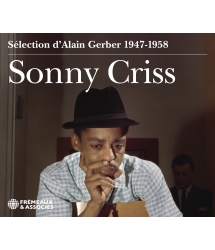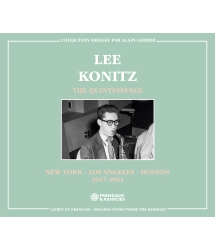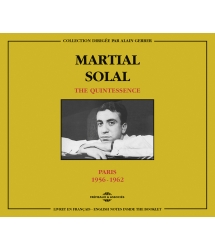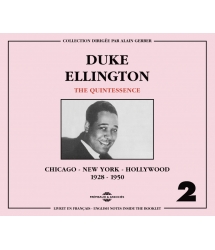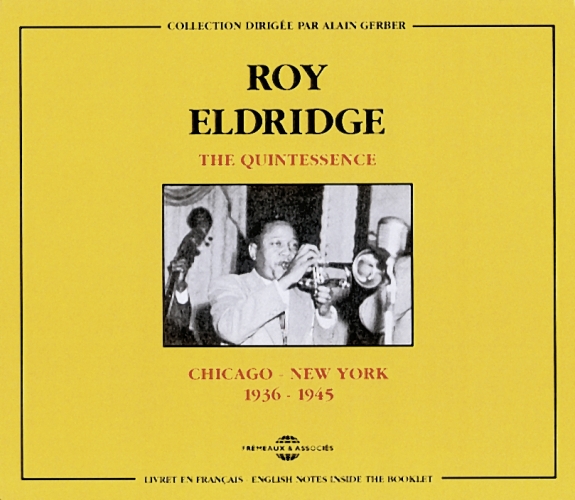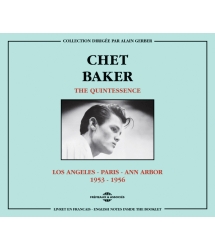- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary











- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary
CHICAGO - NEW-YORK 1936 - 1945
ROY ELDRIDGE
Ref.: FA231
EAN : 3700368458877
Artistic Direction : ALAIN GERBER
Label : Frémeaux & Associés
Total duration of the pack : 1 hours 50 minutes
Nbre. CD : 2
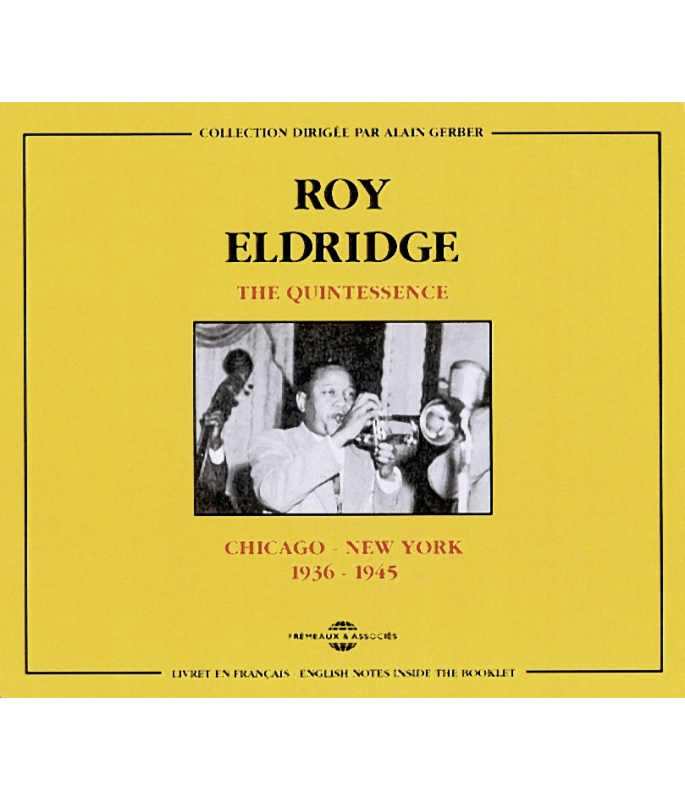
CHICAGO - NEW-YORK 1936 - 1945
- - ÉVÉNEMENT TÉLÉRAMA
- - CHOC JAZZMAN
- - * * * EPOK
- - LE DISQUE JAZZ NOTES
- - SUGGÉRÉ PAR “COMPRENDRE LE JAZZ” CHEZ LAROUSSE
CHICAGO - NEW-YORK 1936 - 1945
(2-CD set) The wildest of them all. Includes a 32 page booklet with both French and English notes.
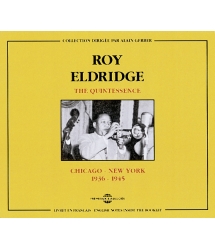


-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1MARY HAD A LITTLE LAMBROY ELDRIDGEM MALNECK M00:02:531936
-
2TOO GOOD TO BE TRUEROY ELDRIDGEBOLAND00:03:071936
-
3WARMIN UPROY ELDRIDGEWILSON00:03:111936
-
4BLUES IN C SHARP MINORROY ELDRIDGEWILSON00:03:151936
-
5SHOE SHINE BOYROY ELDRIDGES VOL DE NUIT CHAPLIN00:03:301936
-
6YOU CAN DEPEND ON MEROY ELDRIDGEEARL HINES00:03:261936
-
7WABASH STOMPROY ELDRIDGEROY ELRIDGE00:03:071937
-
8FLORIDA STOMPROY ELDRIDGEROY ELRIDGE00:02:551937
-
9HECKLERS HOPROY ELDRIDGEELRIDGE R ET J00:02:351937
-
10WHERE THE LAZY RIVER GOES BYROY ELDRIDGEADAMSON00:02:311937
-
11THAT THINGROY ELDRIDGEROY ELRIDGE00:03:001937
-
12AFTER YOU VE GONE 1ROY ELDRIDGEJ T LAYTON00:02:591937
-
13SITTIN INROY ELDRIDGEM GABLER00:02:101938
-
14STARDUST 1ROY ELDRIDGEH CARMICHAEL00:03:531938
-
15BODY AND SOUL 1ROY ELDRIDGEJOHNNY GREEN00:03:501938
-
16FALLING IN LOVE AGAINROY ELDRIDGEJOE HOLLANDER00:02:471940
-
17I M NOBODY S BABYROY ELDRIDGEDAVIS00:02:561940
-
18I SURRENDER DEARROY ELDRIDGEH BARRIS00:04:361940
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1I CAN T BELIEVE THAT YOU RE IN LOVE WITH MEROY ELDRIDGEJ MC HUGH00:04:121940
-
2I M ALL FOR YOUROY ELDRIDGEBRESLER00:03:061940
-
3I HEAR MUSICROY ELDRIDGELANE00:02:391940
-
4LET ME OFF UPTOWNROY ELDRIDGEBOSTIC00:03:021941
-
5ROCKIN CHAIRROY ELDRIDGEH CARMICHAEL00:02:571941
-
6KNOCK ME A KISSROY ELDRIDGEJACKSON00:03:001942
-
7AFTER YOU VE GONE 2ROY ELDRIDGEJ T LAYTON00:02:451943
-
8THE GASSERROY ELDRIDGEELRIDGE00:02:531943
-
9STAR DUST 2ROY ELDRIDGEH CARMICHAEL00:02:261943
-
10BEAN AT THE METROY ELDRIDGEHAWKINS00:03:021944
-
11BODY AND SOUL 2ROY ELDRIDGEJOHNNY GREEN00:03:161944
-
12FISH MARKETROY ELDRIDGEELRIDGE00:03:101944
-
13TWILIGHT TIMEROY ELDRIDGERAM00:02:511944
-
14ST LOUIS BLUESROY ELDRIDGEHANDY00:02:211944
-
15THE GRABTOWN GRAPPLEROY ELDRIDGESHAW00:02:541945
-
16EMBRACEABLE YOUROY ELDRIDGEGEORGE GERSHWIN00:03:191945
-
17LITTLE JAZZROY ELDRIDGEELRIDGE00:02:591945
-
18SCUTTLEBUTTROY ELDRIDGESHAW00:03:071945
ROY ELDRIDGE THE QUINTESSENCE FA 231
ROY ELDRIDGETHE QUINTESSENCE
CHICAGO - NEW YORK
1936 - 1945
DISCOGRAPHIE
CD I
01. Mary Had A Little Lamb. TEDDY WILSON AND HIS ORCHESTRA : Wilson (p, lead), R.E. (tp, voc), William C. “Buster” Bailey (cl), Leon “Chu” Berry (ts), Robert “Bob” Lessey (g), Israel Crosby (b), Sidney “Big Sid” Catlett (dm). Chicago, 14 mai 1936. BRUNSWICK C.1376-1. 2’53
02. Too Good To Be True. Même formation et même séance que pour Mary Had A Little Lamb, mais Roy ne chante pas. BRUNSWICK C.1377-2. 3’07
03. Warmin’ Up. Même formation et même séance que pour Mary Had A Little Lamb, mais Roy ne chante pas. BRUNSWICK C.1378-1.3’11
04. Blues In C Sharp Minor. Même formation et même séance que pour Mary Had A Little Lamb, mais Roy ne chante pas. BRUNSWICK C.1379-1. 3’15
05. Shoe Shine Boy. FLETCHER HENDERSON AND HIS ORCHESTRA : Henderson (p, lead), David “Roy” Eldridge (tp, voc), Richard Thomas “Dick” Vance, Joseph “Joe” Thomas (tp), Fernando Arbello, Edward Emerson “Ed” Cuffee (tb), William C. “Buster” Bailey, Jerome Pasquall, Elmer A. Williams, Leon “Chu” Berry (reeds), Robert “Bob” Lessey (g), Israel Crosby (b), Walter Johnson. Arrangement : probablement L.J. Russell. Chicago, 4 août 1936. VICTOR BS 100882-1. 3’30
06. You Can Depend On Me. Même formation et même séance que pour Shoe Shine Boy, mais Horace Henderson remplace Fletcher au piano. C’est Dick Vance et non R.E. qui chante. Arrangement : Fletcher Henderson. VICTOR BS 100887-1. 3’26
07. Wabash Stomp. ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA : R.E. (tp, lead), George Dorman “Scoops”Carry, Joseph “Joe” Eldridge, David A. “Dave” Young (reeds), Theodore “Teddy” Cole (p), John Collins (g), Charles Valdez “Truck” Parham (b), Arthur James “Zutty” Singleton (dm). Chicago, 23 janvier 1937. VOCALION C.1793-1. 3’07
08. Florida Stomp. Même formation et même séance que pour Wabash Stomp. VOCALION C.1794-1. 2’55
09. Hecklers Hop. Même formation et même séance que pour Wabash Stomp. VOCALION C.1795-1. 2’35
10. Where The Lazy River Goes By. Même formation que pour Wabash Stomp, mais la chanteuse Gladys Palmer s’ajoute à l’orchestre. Chicago, 28 janvier 1937. VOCALION C.1796-1. 2’31
11. That Thing. Même formation et même séance que pour Where The Lazy River Goes By, mais sans Gladys Palmer. VOCALION C.1797-1. 3’00
12. After You’ve Gone 1. Même formation et même séance que pour Where The Lazy River Goes By, mais sans Gladys Palmer. VOCALION C.1798-2. 2’59
13. Sittin’In. CHU BERRY AND HIS “LITTLE JAZZ” ENSEMBLE : Berry (ts, voc, lead), R.E. (tp, voc), Clyde Hart (p), Daniel “Danny” Barker (g), Arthur “Artie” Shapiro (b), Sidney “Big Sid” Catlett (dm, voc). New York City, 11 novembre 1938. COMMODORE 23699-2. 2’10
14. Stardust 1. Même formation et même séance que pour Sittin’In, mais ni Roy, ni Chu Berry ni Sidney Catlett n’interviennent vocalement. COMMODORE 23700-1. 3’53
15. Body And Soul 1. Même formation et même séance que pour Sittin’In, mais ni Roy, ni Chu Berry ni Sidney Catlett n’interviennent vocalement. COMMODORE 23701-1. 3’50
16. Falling In Love Again. BILLIE HOLIDAY AND HER ORCHESTRA : B. Holiday (voc, lead), R.E. (tp), Jimmy Powell, Carl Frye, Kermit Scott (reeds), Ellerton Oswald “Sonny” White (p), Lawrence Lucie (g), John Williams (b), Harold “Doc” West (dm) . New York City, 29 février 1940. VOCALION W.26575-A. 2’47
17. I’m Nobody’s Baby. MILDRED BAILEY AND HIS ORCHESTRA : M. Bailey (voc, lead), R.E. (tp), Robert Burns, James “Jimmy” Carroll, Carl Prager (reeds), Eddie Powell (fl), “Mitch” Miller (oboe), Theodore “Teddy” Wilson (p), John Collins (g), Peter “Pete” Peterson (b), William “Bill” Beason (dm). Arrangement : Eddie Sauter. New York City, 2 avril 1940. COLUMBIA WCO.26698-A. 2’56
18. I Surrender Dear. COLEMAN HAWKINS AND THE CHOCOLATE DANDIES : Hawkins (ts, lead), R.E. (tp), Bennett Lester “Benny” Carter (p), Bernard Addison (g), John Kirby (b), Catlett (dm). New York City, 25 mai 1940. COMMODORE R-2996. 4’36
CD II
1. I Can’t Believe That You’re In Love With Me. Même formation et même séance que pour I Surrender Dear, mais Carter joue du saxophone alto. COMMODORE R-2997. 4’12
2. I’m All For You. BILLIE HOLIDAY AND HER ORCHESTRA : B. Holiday (voc, lead), R.E. (tp), Donald Matthew “Don” Redman, James “Jimmy” Hamilton, George “Georgie” Auld, Carlos Wesley “Don” Byas (reeds), Wilson (p), Collins (g), Alfred Wesley “Al” Hall (b), Kenneth Spearman “Kenny” Clarke (dm). Arrangement : probablement Don Redman. New York City, 12 septembre 1940. OKEH 28617-1. 3’06
3. I Hear Music. Même formation et même séance que pour I’m All For You. OKEH 28618-2. 2’39
4. Let Me Off Uptown. GENE KRUPA AND HIS ORCHESTRA : Krupa (dm, lead), R.E. (tp, voc), Norman Murphy, Torg Halten, Graham Young (tp), John Grassi, Jay Kelliher, “Babe” Wagner (tb), Clint Neagley, Mascagni Ruffo, “Sam” Musiker, Walter Bates (reeds), “Bob” Curtis (p), Remo “Ray” Biondi (g), “Biddy” Bastien (b), Anita O’Day (voc). New York City, 8 mai 1941. OKEH CO.30443-1. 3’02
5. Rockin’ Chair. GENE KRUPA AND HIS ORCHESTRA : Krupa (dm, lead), R.E. (tp), Murphy, Halten, Young (tp), Grassi, Kelliher, Wagner (tb), Ruffo, Musiker, Bates, Sam Listengart (reeds), Milton William “Milt” Raskin (p), Biondi (g), Edward “Ed” Mihelich (b). Arrangement : Elton Hill. New York City, 2 juillet 1941. OKEH CO.30830-1. 2’57
6. Knock Me A Kiss. GENE KRUPA AND HIS ORCHESTRA : Krupa (dm, lead), R.E. (tp, voc), “Mickey” Mangano, Murphy, “Al” Beck (tp), Grassi, Joseph “Joe” Conigliaro, Wagner (tb), Musiker, “Ben” Feeman, “Jimmy” Migliore, “Don” Brassfield, Rex Sittig (reeds), Joseph “Joe” Springer (p), Biondi (g), Mihelich (b). Chicago, 2 avril 1942. COLUMBIA C.4209-1. 3’00
7. After You’ve Gone 2. ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA : R.E. (tp), Joseph “Joe” Eldridge, Andrew “Goon” Gardner, Abrams “Ike” Quebec, Thomas “Tom” Archia (reeds), Rozelle Gayle (p), Theodore “Ted” Sturgis (b), Harod “Doc” West (dm). “Choeurs” par l’orchestre. Chicago, 16 novembre 1943. 2’45
8. The Gasser. Même formation et même séance que pour After You’ve Gone 2, mais sans interventions vocales. BRUNSWICK C15095. 2’53
9. Stardust 2. Même formation et même séance que pour After You’ve Gone 2, mais sans interventions vocales. BRUNSWICK C15098. 2’26
10. Bean At The Met COLEMAN HAWKINS QUINTET : Hawkins (ts, lead), R.E. (tp), Wilson (p), William “Billy” Taylor (b), Cole (dm). New York City, 31 janvier 1944. KEYNOTE KHL-12. 3’02
11. Body And Soul 2. ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA : R.E. (tp, lead), Gus “Rice” Aiken, John “Bugs” Hamilton, Robert “Cookie” Mason, Clarence Wheeler (tp), Theodore “Ted” Kelly, Andrew “Sandy” Williams, George Wilson (tb), Joseph “Joe” Eldridge, Samuel “Sam” Lee, Franz Jackson, Harold “Hal” Singer, David “Dave” McKay (reeds), Anthony “Tony” D’Amore (p), Samuel “Sam” Allen (g), Carl “Flat Top” Wilson (b), Lester “Les” Erskine (dm). New York City, 26 juin 1944. DECCA 72299. 3’16
12. Fish Market. ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA : R.E. (tp, lead), Sidney De Paris, Paul Cohen, Robert Mason, Pingus “Pinky” Savitt (tp), Williams, Wilbur De Paris, Victor “Vic” Dickenson, George Stevenson (tb), Joseph “Joe” Eldridge, Curby Alexander, Jackson, Singer, McRae (reeds), Humphrey “Ted” Brannon (p), Napoleon “Snags” Allen (g), Taylor (b), Cozy Cole (dm). New York City, 13 octobre 1944. DECCA 72430-A. 3’10
13. Twilight Time. Même formation et même séance que pour Fish Market. DECCA 72431-A. 2’51
14. St. Louis Blues. Même formation et même séance que pour Fish Market. DECCA 72432. 2’21
15. The Grabtown Grapple. ARTIE SHAW AND HIS GRAMERCY FIVE : Shaw (cl, lead), R. E. (tp), Michael “Dodo” Marmarosa (p), Barney Kessel (g), Morris Rayman (b), Louis “Lou” Fromm (dm). New York City, 9 janvier 1945. VICTOR D5-VB-OO32. 2’54
16. Embraceable You. ROY ELDRIDGE AND HIS ORCHESTRA : R. E. (tp, lead), Andrew “Andy” Ferretti, William “Bill” Graham, John R. “Yank” Lawson, James “Jimmy” Maxwell (tp), Wilbur “Will” Bradley, Harold “Hal” Matthews, Frederick “Fred” Ohms, Ward Silloway (tb), Raymond “Ray” Eckstrand, Michael “Mike” Doty, Donald “Don” Purvance, Henry “Hank” Ross, Ernesto “Ernie” Caceres (reeds), David “Dave” Bowman (p), Michael Neely “Mike” Bryan (g), Theodore “Ted” Sturgis (b), William Randoph “Cozy” Cole (dm). Arrangement : Lavere “Buster” Harding. New York City, 5 mars 1945. DECCA 72727. 3’19
17. Little Jazz. ARTIE SHAW AND HIS ORCHESTRA : Shaw (cl, lead), R.E., Paul Cohen, Bernard “Bernie” Glow, George Schwartz (tp), Gus Dikson, Harry Rogers, Robert “Bob” Swift, Ollis Wilson (tb), Louis “Lou” Prisby, Rudoph Tanza, Ralph Roseland, Jon Walton, Charles “Chuck” Gentry (reeds), Marmarosa (p), Kessel (g), Rayman (b), Fromm (dm). Los Angeles, 5 avril 1945. VICTOR D5-VB-1046. 2’59
18. Scuttlebutt. Même formation que pour The Grabtown Grapple. Hollywood, 31 juillet 1945. VICTOR D5-VB-1102. 3’07
LE PLUS SAUVAGE D’ENTRE TOUS
“We’re still trying, aren’t we?”* (Roy Eldridge)
Connaître ses limites et les ignorer, tenter le diable, voler le feu quitte à s’y brûler les doigts, risquer parfois le tout pour le tout, sinon pour presque rien : ces bravades et ces extravagances furent la routine de David Roy Eldridge, surnommé “Little Jazz”. Tel ces candidats au titre de “fastest gun in the West”, David chercha des noises à tous les Goliath qu’il rencontra sur son chemin**. Devenu roy d’une terre luxuriante mais ingrate (éruptive, escarpée, pleine d’à-pics et de crevasses), il misa sa couronne, son sceptre et sa dernière chemise dans des parties où l’on jouait des haricots. Et alors, quand il faisait sauter la banque - c’est-à-dire la plupart du temps, durant une bonne décennie*** -, le “Petit Jazz” prenait tout à coup une stature colossale.Le jazz des années trente est dominé par la figure jupitérienne, foudroyante mais consolatrice, de Louis Armstrong. Dans ce jazz ivre d’équilibre, que l’on commence à croire abrité des sinistres, Roy Eldridge débarque comme le Vertige incarné, l’Incendie en personne. Il prêche une religion terrible, selon quoi la musique la plus perdue est celle qui n’a pas tenté de se perdre. Et il la prêche de la façon la plus scandaleuse, la plus impitoyable de toutes : par l’exemple. Si bien que les sceptiques n’ont même plus la ressource de crier à l’utopie. En l’espace de trente-deux mesures, cet illuminé est capable de vous attraper deux ou trois fois la lune, comme si de rien n’était.
Dans une situation pareille, il n’y a pas trente-six façons de réagir: ou bien, comme les rhumatisants du corps ou de l’esprit, on s’emploie à discréditer les courses à la lune (déclarées trop vaines, trop présomptueuses, trop m’as-tu-vu, trop vulgaires - ce qui du reste n’est pas tout à fait inexact); ou bien - à la manière de Dizzy Gillespie - on retourne au gymnase et on se résigne à travailler sa détente.Armstrong avait contraint la plupart des trompettistes de sa génération à jouer comme Armstrong, en moins bien****. Roy incitera ceux de la suivante soit à faire mieux que lui, soit à faire autre chose. En ce sens, il fut un libérateur considérable. Extirpant chez ceux-ci la tentation d’obédience. Délivrant ceux-là du respect de l’impossible. Appelant tout un chacun à oublier ses marques, à déserter son confort. Après Roy Eldridge, on ne va pas forcément jouer un jazz différent (plus les années passeront, moins il sera aisé de pointer la fracture entre ses oeuvres et les travaux de ses contemporains), mais on va le jouer d’une manière différente. Avec la ferveur retrouvée, la brutalité candide des premiers âges. Avec un sentiment d’insécurité redevenu grâce à lui critère d’intégrité.“Little Jazz” a réinventé le jazz quand le jazz menaçait de rapetisser. Lorsqu’il enregistre Wabash Stomp, Florida Stomp et la première version d’After You’ve Gone, l’académisme auquel elle allait largement succomber dans les années quatre-vingt est déjà sur le point, sinon de transir, du moins de civiliser à l’excès la musique afro-américaine.
Un décapant s’impose pour dissoudre cette patine (au demeurant luxueuse, là n’est pas la question). Avant tout le monde, il en a trouvé la formule : celle d’un élixir de jouvence, le premier de cette efficace depuis que Satchmo s’est démarqué de King Oliver. Eldridge restera pour cela - et l’hommage appuyé qu’un Mingus lui rendra par la suite***** n’aura pas d’autre but que de le rappeler - le plus sauvage d’entre tous. Le plus sauvage et le plus pur. Nat Hentoff raconte qu’en U.R.S.S., un journaliste des Izvestia s’était juré de faire dire à Norman Granz quel était le jazzman qui, d’après lui, personnalisait le mieux le jazz. Oscar Peterson soufflait avec insistance : “Tatum. Tatum. Dis-lui que c’est Tatum.” Mais Granz finit par répondre : “Non, c’est Roy Eldridge qui incarne le mieux l’essence du jazz. C’est un musicien pour qui il est de loin plus important d’oser, de s’acharner à atteindre un certain sommet - même si dans sa tentative il se retrouve cul par-dessus tête - que de jouer la sécurité. Le jazz ne consiste en rien d’autre.”
Alain Gerber
© GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SA 1999
*“Nous n’avons toujours pas renoncé, n’est-il pas vrai ?”
**“Si c’était possible, il essaierait de se mesurer à Buddy Bolden”, a écrit Nat Hentoff, tandis que Norman Granz observait : “Il adorerait affronter Miles Davis ou Chet Baker”.
***De1936 à1947. ****N’oublions quand même pas ces grands dissidents que furent, par exemple, Henry “Red” Allen, Jabbo Smith, Bix Beiderbecke, Bubber Miley et Rex Stewart.
*****En l’invitant à une de ses séances d’enregistrement, dès 1960 (Mysterious Blues, Body And Soul, Me And You, etc.), puis, douze ans plus tard, en lui dédiant sa Little Royal Suite.
A PROPOS DE LA PRÉSENTE SÉLECTION
Avec Teddy Wilson (CD I, plages 1 à 4)De toutes les séances en petite formation organisées autour de Teddy Wilson à partir de 1934 et jusqu’en 1945, celle du 14 mai 1936 reste l’une des plus mémorables. Avec, bien sûr, les sessions auxquelles Billie Holiday prêta son concours. Membre du trio de Benny Goodman depuis quelques semaines, le pianiste, qui engageait ses partenaires au coup par coup, selon qu’ils étaient disponibles, avait recruté ce jour-là des musiciens du Fletcher Henderson Orchestra, basé à Chicago où il se produisait dans ce qui avait été pendant huit ans le bunker d’Earl Hines (lequel, d’ ailleurs, y retrouvera sa place, qu’il n’abandonnera définitivement qu’en 1947) : le Grand Terrace. Le guitariste Bob Lessey, originaire des Antilles britanniques, est le seul de l’équipe qui n’ait pas laissé dans l’histoire une trace bien profonde; il avait quitté le big band de Tiny Bradshaw en 1935 pour celui de Fletcher, qu’il déserterait au profit du Don Redman Orchestre. Les cinq autres appartiennent au gotha du jazz pré-parkérien. Buster Bailey était un vétéran des formations hendersoniennes, dans lesquelles il avait déjà effectué deux stages (octobre 1924-juillet 1927, janvier-septembre 1934); grand technicien de la clarinette, il s’est fait accuser quelquefois de manquer de chaleur, un reproche qu’on ne peut adresser à son solo de Warmin’ Up (auquel certains commentateurs préfèrent toutefois son intervention dans Blues In C Sharp Minor). Leon “Chu” ou “Chew” Berry, d’abord surnommé “Chu-Chin-Chow”, avait eu à la fin de l’année précédente le redoutable honneur d’occuper au sein de la section d’anches la place abandonnée par Coleman Hawkins pendant l’hiver 1934 et qui avait d’abord échu à Ben Webster. Pour lui aussi, la séance est à marquer d’une pierre blanche ; on retiendra en particulier la jubilante énergie dont il fait preuve dans Mary Had A Little Lamb et Warmin’ Up (où Catlett lui aussi apparaît au sommet de son art, bien qu’il ne s’y adjuge même pas un break).
En évidence dans Blues In C Sharp Minor, le contrebassiste Israel Crosby, bien qu’il eût fêté depuis peu son dix-septième anniversaire, n’était déjà plus exactement un débutant, puisqu’il exerçait en professionnel depuis quatre ans (période au cours de laquelle on avait pu l’entendre, notamment, aux côtés d’ Albert Ammons et de Gene Krupa). A l’instar du batteur avec lequel il forme ici un tandem rythmique d’une consistance et d’une autorité peu communes, il contribuera beaucoup par la suite à faciliter la transition entre middle jazz et be-bop ; en 1951, il entrera d’ailleurs pour deux ans dans le premier trio d’Ahmad Jamal, qu’il rejoindra en 1957, ne reprenant sa liberté que pour s’associer en 1962 à George Shearing, quelques mois avant de succomber à un accident cardiaque. En compagnie d’un tel équipier, “Big Sid”, sûr que le tempo n’allait pas flotter, pouvait concentrer son attention sur le jeu des solistes, veillant - c’était une de ses grandes spécialités - à planter derrière chacun d’eux un décor dont la couleur et la texture fussent les plus propices à mettre sa contribution en valeur (cf. la subtile évolution des formules d’accompagnement dans Too Good To Be True, tandis que se succèdent sur le devant de la scène Berry, Wilson puis Roy - et pourtant il ne s’agit là que d’une ballade, où l’activité rythmique est réduite). Le grand Sidney brillait dans tous les compartiments du jeu, mais s’il fallait citer sa principale qualité, ce serait sans doute l’intelligence qui viendrait d’abord à l’esprit.
Quant à Roy, excellent partout (même lorsqu’il intégre à son jeu, dans Warmin’Up, quelques clichés d’époque où l’influence d’Armstrong se fait sentir), il triomphe dans Mary Had A Little Lamb et, plus encore peut-être, dans Blues In C Sharp Minor. Outre le sens de la construction qu’il manifeste dans son chorus de trompette (d’une silhouette et d’une architecture irréprochables) et sa maîtrise dans la préparation puis dans la conduite de la brève collective finale, la première de ces pièces permet d’apprécier ses talents de vocaliste, un aspect de sa personnalité moins anecdotique que la lecture des historiens et des analystes n’inciterait à le croire; c’est surtout pour ces talents-là, du reste, que nous avons retenu le Knock Me A Kiss publié sous le nom de Gene Krupa (CD II, plage 6). En ce qui concerne Blues In C Sharp Minor, ce titre a recueilli en octobre 1948, dans un article confié à la revue Jazz Hot, les éloges du très pénétrant André Hodeir, lequel en a souligné non seulement l’élégance et l’audace, mais encore le côté troublant. Au vrai, rarement l’art de “Little Jazz” manifestera un tel sens du tragique et de la mesure, réalisera une coïncidence si parfaite de la profondeur avec la sobriété. On admire à bon droit le Roy baroque d’After You’ve Gone; pour autant, on ne doit pas ignorer le Roy classique de Blues In C Sharp Minor : ces deux images du maître sont indissociables dans la mesure où chacune d’elle confère à l’autre une part de son relief.Si les sidemen sont en verve, le leader ne s’en laisse pas conter et, même lorsque la musique est torride comme dans Mary Had A Little Lamb, il n’oublie jamais d’y ajouter cette touche de grâce aérienne qui était sa signature et suffisait à mettre le swing en apesanteur. Pour autant, il demeure capable d’intensité lorsqu’il éprouve le besoin de maintenir la pression : c’est ce que démontre le solo de piano presque haletant (pour du Wilson, en tout cas) de Warmin’ Up, morceau que son titre - quelque chose comme “L’excitation gagne” - définit à merveille.
Avec Fletcher Henderson (CD I, plages 5 et 6)
L’histoire du petit agneau de Mary devait être dans l’air du temps puisque, moins de dix jours après le septette de Teddy, c’est l’orchestre de Henderson qui, le 23 mai, en livre sa version pour Victor (et, cette fois encore, Roy, Buster Bailey et Chu Berry figurent au nombre des solistes). Le 4 août, au bénéfice de la même compagnie, la même formation confie à la cire six interprétations dont deux au moins, Shoe Shine Boy et You Can Depend On Me, présentent le trompettiste sous son meilleur jour. Un peu plus tôt déjà, il avait été mis en valeur par des réalisations hendersoniennes telles que Christopher Columbus, Blue lou, Stealin’ Apples ou Jangled Nerves, inscrites au programme du recueil Quintessence consacré à Fletcher (1). Après être intervenu comme chanteur sur Shoe Shine Boy, R.E. encadre le chorus de clarinette de deux fort belles paraphrases du thème de Saul Chaplin et Sammy Cahn qu’il exécute - avec sourdine - dans sa veine la plus lyrique et en gardant un oeil sur Armstrong. En revanche, le morceau suivant - composé par Earl Hines et arrangé par un “Smack” très efficace - lui offre l’occasion de prendre davantage de distance avec le texte original. Du coup, il semble plus fidèle à lui-même, au point que certains critiques n’ont pas hésité à considérer ce solo comme le meilleur de ceux qu’il ait gravés au sein du groupe. On souscrirait à leur point de vue si ce n’était, à notre estime, faire trop peu de cas de Stealin’ Apples et Jungle Nerves. On notera que, dans cette version de You Can Depend On Me où le vocal est l’oeuvre du trompettiste Dick Vance, Berry ne se laisse pas ignorer non plus.
Avec les ténors du ténor (CD I, plages 13 à 15 et plage 18 ; CD II, plages 1 et 10)
Le moment est venu de rappeler que Chu, plus âgé que lui de quelques mois, mais plus mûr, avait été avec Joe Eldridge - le frère aîné de Roy, lui-même saxophoniste (2) - l’une des bonnes fées qui, à la fin de la décennie précédente, veillèrent sur les débuts du trompettiste. Celui-ci a raconté comment les deux compères l’avaient enfermé dans une chambre d’hôtel, l’obligeant à assimiler tous les airs à la mode et à travailler son instrument de manière à défendre à New York sa réputation, acquise en terrain moins exposé, de “jeunot aux lèvres d’acier et aux doigts véloces”. Les reedmen, en général, exerçaient alors sur lui une profonde influence. D’où cet aveu ironique : “C’était du beau saxophone que je jouais sur ma trompette!” Il n’avait pas encore mesuré le génie de Satchmo (3), mais il reconnaissait sa dette envers Benny Carter et surtout Coleman Hawkins : “Le premier boulot que j’ai obtenu, je l’ai décroché parce que j’avais été capable de reproduire sur mon instrument le solo de Hawkins dans The Stampede (1).” Pour ce qui est des trompettistes, Red Nichols et Rex Stewart, deux musiciens soumis à l’influence de Bix Beiderbecke, avaient été les premiers à retenir son attention. Nichols par la netteté de son énonciation, Stewart par la fantaisie et le relief de son phrasé. L’un et l’autre par l’originalité de leur approche. En fait, par ce qui les distinguait des élèves trop appliqués de “Little Louie”. L’adolescent surdoué avait écouté les disques de Red et fréquenté Rex, qui vivait sous le même toit que lui à l’époque où il appartenait aux Elite Serenaders de son frère Joe. Délicat mélodiste à la sonorité ouatée, Joe Smith le fascinait aussi. A New York, il découvrira les styles flamboyants, eux aussi atypiques et même volontiers capricieux de Jabbo Smith (4) puis de Henry “Red” Allen (5) (deux réponses ébouriffantes aux problèmes que posait la compatibilité de la vitesse d’élocution avec un discours substantiel), avant d’être enfin initié à celui d’Armstrong. Comme à tant d’autres, quoique plus tardivement, Armstrong lui fera “voir la lumière”, pour reprendre sa propre expression.
Entendez qu’il lui apprendra par son exemple, je le cite encore, à “raconter une histoire”. Jusque là, Roy avait sacrifié le souci de communiquer avec le public à l’obsession solipsiste de maîtriser son outil, s’attirant à cause de cela les reproches du batteur Chick Webb (personnage peu enclin à ménager les débutants trop présomptueux, comme Art Blakey devait en faire lui aussi l’amère expérience). Brillant athlète, il lui restait à devenir artiste. Autant dire que quatre ou cinq ans encore avant la réalisation de ces indiscutables chefs-d’oeuvre que sont, entre autres, Wabash Stomp, Forida Stomp et le premier After You’ve Gone de notre sélection, la partie semblait loin d’être gagnée pour celui qui, dans sa ville natale de Pittsburgh, avait dirigé son propre orchestre dès l’âge de seize ans, sous le nom de guerre de Roy Elliott.Après leur passage chez Fletcher Henderson, R.E. et Chu Berry se séparent : celui-ci rejoint Cab Calloway, tandis que celui-là, devenu l’idole d’une nouvelle génération de trompettistes (celle de Dizzy Gillespie), se remet à son compte. Ils suivaient des voies parallèles depuis 1929 et ces parallèles s’étaient rencontrées à plus d’une reprise. Ainsi avaient-ils tous deux été engagés par Cecil Scott et Charlie Johnson, avant de se retrouver en 1935 au Savoy Ballroom de Harlem, chez Teddy Hill. Le saxophoniste était membre de cette formation depuis plus d’un an ; c’est avec elle que le trompettiste gravera, le 26 février, le premier disque dans lequel on peut l’entendre prendre un chorus : (Lookie, Lookie, Lookie) Here Comes Cookie. La même année, ils enregistreront ensemble pour Vocalion sous la direction du pianiste et chanteur Louis “Putney” Dandridge et, déjà, pour Brunswick au sein d’un groupe réuni par Teddy Wilson et comprenant Billie Holiday (Yankee Doodle Never Went To Town, If You Were Mine, etc.) Dans ces conditions, on ne s’étonne pas que Chu ait fait appel à Roy pour assurer le succès d’une des trop rares séances dont on lui confiera la responsabilité, avant qu’il trouve la mort le 30 octobre 1941 à la suite d’un accident de voiture.Ni l’un ni l’autre ne dut s’en mordre les doigts. Les quatre faces réalisées ce jour-là (et où Catlett, une fois de plus, fait merveille) comptent parmi les joyaux du jazz classique. A l’exception de Forty-Six West Fifty-Two, nous les avons toutes retenues.
Sittin’In, d’abord, pour l’incandescence et la virtuosité jamais gratuite d’un solo que “Little Jazz”(6) était sans doute, à cette date, le seul spécialiste des pistons à pouvoir négocier (d’où la fameuse réflexion de Dizzy, qui lui avait succédé chez Teddy Hill : “J’essayais de jouer comme lui et je n’y arrivais pas. Cela me rendait fou, et finalement je me suis décidé à essayer autre chose : on a appelé ça le style bop.”). Stardust, ensuite, parce qu’il a rarement mieux joué la ballade qu’en cette occasion : les idées sont aussi neuves, voire révolutionnaires, qu’abouties; on assiste à l’émergence et à l’accomplissement instantané d’une esthétique des tempos lents adoptée par les saxophonistes mais jusque là inouïe chez un trompettiste. Cette approche fera florès une demi-douzaine d’années plus tard, grâce à Gillespie. Un peu moins mémorable peut-être, l’excellent Body And Soul, au-delà de ses qualités intrinsèques (nées d’une féconde opposition de climats), autorise d’instructives comparaisons entre, bien sûr, Berry et Hawkins (7), mais aussi entre les différentes versions qu’Eldridge lui-même en proposera (cf. ici CD II, plage 11 - mais il y en eut d’autres). Celle-ci a le mérite d’associer le mordant à la flexibilité et de présenter une parfaite adéquation entre l’irrésistible élan d’une phrase portée par le swing et le mouvement d’une pensée musicale exigeante et lucide jusque dans l’exaltation.Curieusement, les interviews que Roy a accordées contiennent assez peu d’allusions à Chu Berry. En revanche, il y insiste sur ses liens avec Coleman Hawkins. La raison en est sans doute qu’ils furent très souvent associés, en studio ou sur scène, à partir du moment (avril 1951) où Roy, installé quelque temps à Paris, revint s’établir à New York (8). Au surplus, comme par exemple Lester Young et Billie Holiday, Lee Konitz et Warne Marsh, Miles Davis et Tony Williams, ils constituaient une société d’admiration mutuelle. I dug him, and he dug me, confiera longtemps après au critique Whitney Balliett le trompettiste (alors condamné à une semi-retraite par une crise cardiaque). Autrement dit : “je le sentais bien et il me sentait bien aussi”. Le I Surrender Dear et le I Can’t Believe That You’re In Love With Me des Chocolate Dandies témoigne avec éclat de leur première rencontre phonographique. Rencontre au sommet, soit dit en passant, puisque cette formation d’un jour (qui reprenait le nom d’un groupe de hendersoniens dont avaient fait partie en 1930 Carter et Hawkins) ne comprenait, à l’exception du guitariste Bernard Addison (9), que des figures historiques.
Roy est le seul interlocuteur du saxophoniste dans la prise de I Surrender Dear éditée à l’origine par Milt Gabler, mais, sans faire rouler ses muscles le moins du monde, il ne se laisse pas intimider pour si peu. D’évidence, l’esprit de compétition (dont, chacun de son côté, les deux hommes avaient à revendre) était demeuré au vestiaire : il s’agissait de produire ensemble, non seulement de la belle ouvrage, mais du sens et, chez l’auditeur, des émotions qui fussent mieux qu’épidermiques. La pièce offre de ce fait un magnifique exemple de lyrisme recueilli, Eldridge faisant valoir un aspect de sa personnalité plus secret que d’autres. Dans I Can’t Believe That You’re In Love With Me, gravé dans la foulée, il va se surpasser et tranquillement voler la vedette à Hawkins avec deux chorus de 32 mesures que Gunther Schuller a relevés et auxquels il a consacré une longue et fine analyse. Le musicologue y insiste en particulier sur la commande de l’instrument, utilisé dans toute l’étendue de sa tessiture, et sur l’exécution “pratiquement impeccable” (virtually flawless), sur les efflorescences de la pensée opposées à la concision du discours, sur le sens de la construction spontanée et sur l’esprit d’aventure (le goût de prendre autrui à contre-pied et de se surprendre soi-même) en particulier dans le domaine mélodico-harmonique, où R.E., en quête de dissonnance, va jusqu’à retenir des blue notes auxquelles le jazz ne s’était pas arrêté avant lui (cf. The Swing Era - The Development of Jazz 1930-1945, page 459).Bean At The Met, du 31 janvier 1944, ne représente certes pas comme I Can’t Believe That You’re In Love With Me une borne dans l’histoire du jazz, mais quelle ferveur! Une section rythmique comme on en trouvait beaucoup en ce temps-là, mais qui serait qualifié d’introuvable aujourd’hui (Wilson, Cozy Cole et le contrebassiste Billy Taylor) ouvre aux souffleurs une piste qui ressemble à une voie royale. “Hawk” se comporte en conquistador dans son intervention, obligeant son complice à surenchérir quand le moment est venu de conclure, mais qu’importe? Avant l’entrée en scène du pianiste, Roy a eu le loisir de prouver qu’il était capable de conjuguer sensibilité et ardeur, éloquence et pugnacité.
Avec trois chanteuses d’exception (CD I, plages 16 et 17 ; CD II, plages 2 à 4)
Schuller, encore lui, estime qu’en compagnie de “Lady Day”, le “Petit Roi”(10) - que Billie cita toujours comme l’un de ses accompagnateurs préférés avec Lester Young et Buck Clayton - a livré “une partie de ce qui constitue le plus admirable de son travail”. Parmi les éléments les plus représentatifs de cet ensemble, plusieurs étaient déjà accessibles via les deux coffrets Quintessence (11) de Billie et le recueil Lady Day & Pres 1937-1941 (12). Par exemple Body And Soul et I’m In A Lowdown Groove - sans même parler des obbligatos si discrets et si inoubliables de I’m Pulling Through, Tell Me More And More, Laughing At Life, Time On My Hands, Am I Blue? ou Solitude. Nous avons décidé de ne pas y revenir et de fixer notre choix sur des oeuvres encore inédites chez Frémeaux et Associés, où, pourtant, le génie de Billie Holiday est largement représenté. Son Falling In Love Again, si différent de la version chantée par Marlene Dietrich dans L’Ange Bleu une dizaine d’années plus tôt, renferme un solo de trompette bouchée plein de charme auquel on reviendrait sans cesse s’il n’était éclipsé par ceux de I’m All For You et I Hear Music, entre lesquels il est bien difficile de se faire une religion. Le premier dit en moins de vingt secondes toute l’énigme de vivre et d’aimer; le second, en à peine plus de temps, administre une précieuse leçon dans l’art de ne jamais être prévisible sans jamais se montrer excentrique.C’est encore notre héros qui, plus que Teddy Wilson, plus que la chanteuse elle-même, se taille la part du lion dans I’m Nobody’s Baby, proposé au public par Mildred Bailey (dont la gloire, aux États-Unis, surpassait alors celle de Billie et d’Ella Fitzgerald). Comme dans I’m In A Lowdown Groove ou I’m All For You, son solo s’y apparente davantage, par la cambrure et le refus d’expressionnisme, au style intimisme d’un Bobby Hackett qu’à la sublime pyrotechnie de After You’ve Gone 1.
Un peu comme si, atteignant la maturité, l’artiste se souvenait avec attendrissement de ses premières amours : le Rex Stewart des années 20, Red Nichols, Joe Smith et, à travers eux, Bix - Bix qui, dans sa jeunesse, lui semblait un idéal inaccessible. Nous avons affaire ici au Roy Eldridge le moins démonstratif qui soit : il est clair que ce n’est pas celui qui laisse en nous la trace la moins profonde.N’en concluons pas cependant que l’entertainer de choc et le phénomène des pistons qu’il fut aussi - comme Armstrong et même, dans une certaine mesure, comme Gillespie, showbusiness oblige - serait à négliger. Son duo avec Anita O’Day dans Let Me Off Uptown, en particulier, demeure une réussite, en dépit des incursions dans la stratosphère et des citations militaristes qui étaient sa marque de fabrique chez Krupa (13), où il remplissait la fonction d’ “attraction spéciale”, comme Cootie Williams chez Benny Goodman. Une réussite au même titre que, plus tard, le Swing Low, Sweet Cadillac de Dizzy ou le Mack The Knife de Louis. Le batteur-leader aimait du reste à rappeler aux fines bouches que son orchestre, bon gré mal gré, était payé pour faire danser les gens, les considérations artistiques figurant seulement la cerise sur le gâteau (the art’s thrown in extra). Ce qui doit surprendre, ce ne sont donc pas les complaisances imposées par le cahier des charges, mais bien au contraire l’obstination à ne pas s’en tenir là, au risque d’être désavoué par ceux qui, que vous le vouliez ou non, assurent votre survie. Il faut, en outre, ne pas confondre musique facile à consommer et musique facile à produire. Les jazzmen se donnaient souvent un mal de chien pour remplir avec intégrité leur contrat d’amuseurs publics. Dans ses mémoires (14), Anita O’Day a raconté qu’elle avait dû prendre des cours avec une célèbre vocal coach du nom de Miriam Spier (15) dans le seul but d’interpréter la dernière syllabe de la phrase Let Me Off Uptown comme le souhaitait son ami Redd Evans qui en était l’auteur !
Avec Gene Krupa et Artie Shaw (CD II, plages 5 et 6, 15, 17 et 18)
Sous l’autorité de Krupa, R.E. avait participé en février 1936 à une séance dont l’un et l’autre eurent tout lieu d’être fiers (cf. I Hope Gabriel Likes My Music et Swing Is Here). Quand il accepte d’intégrer la formation de Gene en avril 1941, il renonce aux avantages - et s’affranchit des responsabilités - de son propre leadership, une charge qu’il assumait tant bien que mal depuis septembre 1936, c’est-à-dire près de cinq ans (16), écumant les clubs, les théâtres, les dancings de New York et de Chicago (17). Chez Krupa, où il demeurera jusqu’à la dissolution de l’orchestre au printemps 1943 (18), il s’époumonne dans sa trompette, chante, fait le pitre - tout cela à la fois dans le non-sensique Knock Me A Kiss. Assez souvent, il lui arrive même de se glisser derrière la batterie du patron lorsque celui-ci abandonne son poste pour diriger les opérations à la manière des grands chefs de la musique symphonique (ou de Jimmie Lunceford). Dès l’âge de six ans, Roy avait été initié aux “rudiments” du tambour militaire : sa technique de percussionniste restait rudimentaire, surtout comparée à celle du “Drummin’ Man”. Mais - nous dit encore Anita - “il swinguait comme un dingue”(he swung like mad). C’était plus que n’en réclamaient les foules. Et pourtant, dans un contexte qui aurait pu l’incliner au laisser-aller, il va produire l’une des pièces maîtresses de sa discographie, le Rockin’ Chair de juillet 1941. Spécialement destinée à promouvoir le trompettiste vedette de la formation, l’oeuvre réussira pour de bon à faire de lui, j’emprunte la formule à Stanley Dance, une “figure nationale”, tout en se classant - pour citer cette fois Balliett - parmi les quelques ballades “monumentales” qu’il ait enregistrées. Elle lui vaudra, note quant à lui François-René Cristiani, “de triompher au référendum de Down Beat, alors que seuls des trompettistes blancs en avaient avant lui connu les honneurs”.
Près d’un demi-siècle plus tard, Schuller, que ses préférences ne portent pas vers le jazz de divertissement, conviendra qu’on est là en présence d’une réalisation “par moments terriblement émouvante” (at times tremendously moving). Admettons avec lui, toutefois, qu’elle s’attirerait davantage d’éloges encore si elle ne s’ouvrait et ne se refermait sur des séquences évocatrices de ce que la tradition lyrique a proposé de pire en matière de cadenza, c’est-à-dire aussi creuses que déclamatoires, aussi tonitruantes qu’inadaptées au climat général du morceau.Chez Krupa, Roy a connu dans les états du Sud, au cours des tournées qu’aucun orchestre ne pouvait se payer le luxe d’éviter, des humiliations qui le marqueront pour le reste de son existence, d’autant qu’elles ne lui seront pas épargnées non plus lorsqu’il aura répondu, en octobre 1944, à l’appel d’Artie Shaw. “Pour ce qui est du préjudice racial, ça n’a vraiment pas été sa fête lorsqu’il était avec moi”, déclarera le clarinettiste (19). R.E. lui restera pourtant fidèle jusqu’en septembre 1945). Il est vrai que Shaw lui avait fait tailler par l’excellent Buster Harding, également fournisseur de Cab Calloway, Count Basie, Benny Goodman et Dizzy Gillespie, entre autres, un arrangement à sa mesure et à sa gloire (il s’intitulait Little Jazz) sur lequel il pouvait s’en donner à coeur joie. Vrai aussi qu’il lui avait offert un rôle de premier plan dans son Gramercy Five, dont ils étaient tous deux les seuls souffleurs, soutenus par une section rythmique où s’activaient deux “modernistes” : le pianiste Dodo Marmarosa et le guitariste Barney Kessel, lesquels enregistreraient bientôt pour Ross Russell avec Charlie Parker. Nous avons sélectionné deux des six plages laissées par ce petit ensemble quelquefois décrié, on se demande bien pourquoi : The Grabtown Grapple (à la composition duquel Harding avait prêté la main) et Scuttlebutt. Globalement, la première de ces pièces, à la fois très compacte et très déliée, est peut-être la plus convaincante (20), mais c’est sans doute dans la seconde, où il clôt les débats, qu’Eldridge lui-même s’exprime - là encore en moins d’un tiers de minute - avec le maximum d’intensité, illustrant dans la grâce l’esthétique de la grenade dégoupillée qu’on serre dans son poing à s’en faire craquer les jointures.
Sous son nom (CD I, plages 7 à 12 ; CD II, plages 7 à 9, 11 à 14 et 16)
“Roy, en Wabash Stomp et Florida Stomp, donne un prolongement au style d’Armstrong et, en After You’ve Gone, simultanément, s’émancipe : la phrase bouleversée, sinueuse, mélodiquement téméraire, regorgeant de notes qu’on qualifie alors d’étranges, donne une image de ce romantisme naissant qui succède au modèle armstrongien...”, écrit dans son Histoire du Jazz et de la musique afro-américaine Lucien Malson, pour qui l’on assiste avec ces plages fameuses - point de non-retour dans l’évolution d’un langage qui, déjà, était menacé d’académisme - au “surgissement d’un expressionisme violent, sensible dans le brutal vibrato comme dans le tumulte du verbe”. Avec le chorus final du dernier morceau de la session d’enregistrement des 23 et 28 janvier 1937 (21), le be-bop ne se manifeste pas encore, mais on est en droit de dire qu’il est devenu inévitable. La chose peut paraître difficile à concevoir soixante ans après, mais cet effort d’émancipation fut alors regardé par de nombreux observateurs comme un crime de lèse-majesté et condamné en tant que tel. Pour nombre de critiques, le plus déroutant était sans doute l’instabilité (voulue, cultivée, calculée) de ce jazz qui passait sans crier gare de la retenue à l’effervescence, tout en rendant compatibles le voeu de repousser l’horizon et le souci de garder le contrôle du territoire.
Chez le Roy Eldridge de l’époque, le point d’ébullition se situait très bas et le goût effréné du risque s’accompagnait d’un sens très sûr de la forme. Grâce à quoi il fut typiquement l’improvisateur qui savait jusqu’au aller trop loin et ne se permettait encore (cela viendrait avec la perte, inévitable, de sa formidable maîtrise instrumentale et mentale dans les situations extrêmes) ni de rester en-deça ni de s’égarer au-delà de cette limite. En ce sens, ce n’était pas un moderne, mais c’était un révolutionnaire. Telle est la conclusion qu’en substance proposera André Hodeir, après avoir vanté la véhémence, l’exaspération contenues (dans Wabash Stomp et Florida Stomp en particulier), l’intime urgence d’un discours qui le hisse au niveau des créateurs de tout premier plan et une sonorité “plus sensuelle, plus ardente” que celle d’Armstrong lui-même (dont R.E. ne possède pas toutefois - précise le même auteur - l’inépuisable invention mélodique, le sens de l’équilibre, la sérénité) (22).Comme Hodeir, sachons faire la part des choses : la tentation d’épater le bourgeois (que Gene Krupa encouragera pour les raisons économiques qu’on a vues) n’est pas tout à fait absente des séances Vocalion. Elle se manifeste sans fard dans Heckler’s Hop, où le trompettiste caracole dans le registre aigü à des hauteurs qu’avant lui l’on jugeait non seulement vertigineuses, mais encore infréquentables. Toutefois, la plupart du temps, y compris dans le tourbillonnaire After You’ve Gone 1, la virtuosité n’est pas recherchée pour elle-même mais en tant que moyen de concrétiser un projet esthétique qui l’exige.
Du reste, si l’artiste avait souhaité se concilier les bonnes grâces des badauds, il aurait évité de leur faire aussi peur! Ajoutons que, dans deux des titres du 28 janvier, Where The Lazy River Goes By et That Thing, il abandonne toute idée de tour de force (ce qui ne signifie pas qu’il n’exploite pas à fond les ressources d’une technique exceptionnelle - 23), retrouvant même sur le second thème, une composition de son cru, des accents pénétrés qui rappellent un peu, quoique dans une tonalité moins sombre et avec une mobilité supérieure, Blues In C Sharp Minor.Il est impossible d’évoquer cette série d’interprétations cruciales pour le devenir du jazz sans donner au passage un solide coup de chapeau à Zutty Singleton, champion de la tradition néo-orléanaise nullement désorienté d’avoir à épauler un homme qui passait à bon droit pour avant-gardiste (24). Le batteur ne s’adjuge aucun solo, mais il est omniprésent, dans la mesure où il apparaît à la fois comme un point de référence, un repère stable pour ses partenaires et comme le moteur de la progression collective. Il est l’ancre et il est le vent dans les voiles. Ce qui revient à dire qu’il remplit de façon exemplaire la fonction paradoxale que tous les orchestres de jazz confient à leur drummer, mais que seule l’élite de la corporation se révèle capable d’assumer avec autant de naturel et de pertinence.Des disques réalisés par “Little Jazz” sous son nom à partir du 16 novembre 1943 et jusqu’au 24 septembre 1946 - date de son dernier enregistrement Decca à la tête d’un big band (25) -, la présente sélection offre la crème, encore que nous ayons dû laisser de côté, faute de place, des interprétations aussi représentatives que Tippin’Out ou Hi Ho Trailus Boot Whip. L’esprit de turbulence caractérise l’After You’ve Gone de 1943 (où le saxophoniste ténor Ike Quebec fit ses débuts phonographiques), autant que celui de 1937, tandis que le nouveau solo sur Stardust rivalise de grandeur avec l’ancien (au côté de Chu Berry, on s’en souvient). Entre ces deux merveilles : le bouillonnant The Gasser (26), qui ne leur cède en rien.
Roy reviendra une fois de plus sur After You’ve Gone le 26 juin 1944, mais de cette séance-là, c’est surtout Body And Soul 2 qui mérite une mention spéciale. Voilà encore une interprétation de haute volée, effusive mais touchante, qui reprend avec bonheur l’idée des changements de tempo du Body And Soul 1 et procède d’un art de la paraphrase dont, dix mois plus tard, Embraceable You offrira un autre exemple, étonnamment paisible celui-là. Du 13 octobre, enfin, aucun titre ne pouvait nous échapper. Le charme de Twilight Time, sans doute, ne répond pas à des exigences aussi élevées que la splendeur de Stardust, mais il est prenant. Dans Fish Market, sur les figures imposées du blues, Eldridge trouve un interlocuteur à sa mesure en la personne du tromboniste Sandy Williams (27), lequel ne s’est peut-être jamais exprimé avec plus de liberté ni d’audace. Quant à St. Louis Blues, où intervient le ténor Franz Jackson, c’est en matière de swing et d’abattage un morceau d’anthologie. A la batterie, Cozy Cole relève ici, et avec un succès comparable, le même genre de défi qu’autrefois Zutty Singleton.Le mot de la fin, laissons-le à Dizzy Gillespie qui, mieux que personne, a mérité de l’eldridgisme, cette patrie de l’inconfort et du défi permanent : “Pour une large part, ma contribution personnnelle est une extension de ce que Roy Eldridge avait accompli... Je m’inscris simplement dans une longue lignée de trompettistes qui ont apporté leur contribution à l’ensemble du jazz et, en ce sens, je me place au niveau des Buddy Bolden, King Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Miles Davis et Clifford Brown. Le message qu’apporte un trompettiste est spécifique. Tous les messagers ont la même stature. (...) Si l’on me confondait avec Roy Eldridge, je serais quelque peu surpris, dans la mesure où son message et le mien, bien que d’une égale importance, ne sont pas identiques. Celui de Roy passe d’ailleurs toujours, en même temps que le mien, parce que je viens de Roy et que son message se manifeste à travers moi.”(28)
A.G.
J’adresse mes remerciements les plus cordiaux à Isabelle Marquis et Philippe Baudoin.
© GROUPE FRÉMEAUX COLOMBINI SA 1999
(1) CF. coffret de 2 CD FA 219.
(2) Il lui avait appris à lire la musique en 1928.
(3) Les hasards de l’existence feront qu’il n’aura pas l’occasion de l’entendre en direct avant 1931, au Lafayette Theater.
(4) Son voisin de pupitre dans l’orchestre de Speed Webb, en 1929.
(5) Qui le précéda chez Fletcher Henderson.
(6) Ce sobriquet lui avait été attribué par le saxophoniste Otto Hardwick, alors qu’ils travaillaient tous deux pour Elmer Snowden.
(7) Le “Hawk” fera de ce thème son cheval de bataille après son retour d’Europe l’année suivante (cf. coffret Quintessence FA 213).
(8) Ils codirigeront même un quintette l’année suivante.
(9) Il avait quand même été l’accompagnateur, entre autres, d’Art Tatum, de Louis Armstrong et de Fats Waller.
(10) Un surnom que lui donnèrent certains journalistes français.
(11) FA 209 et FA 222.
(12) FA 013.
(13) Voir aussi leur After You’ve Gone, enregistré le mois suivant.
(14) Publiés sous le titre de High Times Hard Times.
(15) Laquelle commença bien sûr, la situation est classique, par lui affirmer qu’elle ne saurait jamais chanter. En revanche, après le formidable succès populaire de Let Me Off Uptown, elle publia par voie de presse l’annonce suivante : Anita O’Day, vocalist with Gene Krupa, studies singing with Miriam Spier, 1307 Sixth Avenue, New York City (“Anita O’Day, vocaliste chez Gene Krupa, étudie le chant avec Miriam Spier, au n° 1307 de la 6e Avenue de New York”).
(16) Si l’on fait abstraction d’un congé qu’il avait dû prendre en août 1937 pour cause de pneumonie et des quelques semaines de l’été 1938 au cours desquelles il s’était mis en tête de devenir ingénieur radio (preuve que le métier de star du jazz, en cet “âge d’or” déjà, n’était pas que rose), avant d’accepter un poste provisoire de guest soloist chez Mal Hallett, puis de reformer son propre groupe.
(17) A New York, son orchestre fit notamment les folles nuits de l’Arcadia Ballroom (à l’angle de Broadway et de la 53e Rue ouest), où le relaiera le big band de Coleman Hawkins.
(18) Il retravaillera pour le batteur de février à septembre 1949. Gene était l’un des très rares Blancs auxquels il faisait encore confiance après ses mésaventures dans le Sud. De surcroît, il adorait son jeu de batterie et ses qualités humaines. Pour lui, dira-t-il un jour au critique George T. Simon, Krupa était le leader qui ne vous fusillait pas du regard sur scène le soir où vous n’étiez pas en lèvres. En d’autres termes, l’anti-Buddy Rich et l’anti-Benny Goodman.
(19) Les choses en arrivèrent, toujours selon Shaw, au point où son trompettiste vedette, sentant que sa vie pouvait être à tout moment menacée par un quelconque lunatique, portera en permanence une arme à feu, au risque d’avoir les pires ennuis avec la police locale, non moins raciste que les citoyens qui l’avaient élue.
(20) C’est la raison pour laquelle on la trouve au programme du second volume de Jazz, 36 chefs-d’oeuvre (coffret de 2 CD FA 059).
(21) Si fertile qu’à part une seconde prise de Wabash Stomp, d’ailleurs admirable elle aussi, nous n’en avons rien écarté.
(22) On peut les entendre côte à côte dans le Flying On A V Disc enregistré le 18 janvier 1944 au Metropolitan Opera House, à l’occasion d’une jam session historique qui réunissait aussi Barney Bigard, Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Art Tatum, Al Casey, Oscar Pettiford et Sidney Catlett. Cette interprétation figure dans le coffret Quintessence consacré à Hampton (FA 211).
(23) Cf., dans When The Lazy River Goes By, son intervention après le vocal peu nécessaire de Gladys Palmer, beaucoup moins touchante au demeurant que son exposé liminaire, même si John Chilton y voit “l’oeuvre des dieux”.
(24) En 1945, il lui arrivera même de faire équipe avec Gillespie et Parker, à la demande de Slim Gaillard.
(25) Ce jour-là, on ne peut malheureusement pas l’ignorer, apparaissent les premières traces de ce qu’André Hodeir n’hésitera pas à nommer le déclin du trompettiste. En particulier, et cela ne laisse pas d’être intrigant, dans une nouvelle version de son vieux cheval de bataille Rockin’ Chair, dont il donne le sentiment de ne plus avoir la grille harmonique en tête.
(26) Thème troussé par Roy à partir des harmonies et de la structure rythmique de Sweet Georgia Brown.
(27) 1906-1991. Il avait déjà travaillé, notamment, pour Horace et Fletcher Henderson, Chick Webb, Benny Carter, Coleman Hawkins et même Duke Ellington (pendant quelques semaines, en remplacement de Lawrence Brown).
(28) Pour l’essentiel, la traduction de ces extraits de To BE, or not... to BOP reprend celle de Mimi Perrin dans l’édition française publiée en 1981 par les Presses de la Renaissance.
english notes
He knew his own limits, then deliberately went beyond them. He flew by the seat of his pants, and played a high-risk game even when the rewards were minimal. For David Roy Eldridge, a.k.a. “Little Jazz”, it was a way of life. Like some kind of gunslinger in the Old West, Little David would challenge any Goliath who crossed his path. In the process he became a trumpet colossus and dominated the scene for over a decade.
Jazz in the 1930s was very much in thrall to the awe-inspiring yet benign figure of Louis Armstrong, who seemed invincible. Roy Eldridge burst on the scene like a whirlwind, with the message that if music was not prepared to take risks, it was already a lost cause. Roy was no hypocrite: he practised what he preached. Nobody could accuse him of having his head in the clouds. In the space of 32 bars he could cheerfully roar off to the moon and back, as though it were the easiest thing in the world. Reactions were predictable. People either dismissed it as vulgar grandstanding or, like Dizzy Gillespie, they went back to school.
Armstrong had made it mandatory for trumpet players of his generation to play like him, but never as well. Roy inspired his own generation either to outdo him or to do something entirely different. In this respect he freed jazz musicians from the need to be slavish copyists. After Roy Eldridge jazz itself was not necessarily any different, but the approach to playing it had changed. The music rediscovered its old fire and a kind of raw, primeval energy. Thanks to Roy, not being absolutely sure of yourself became a mark of integrity once again.
Just when jazz seemed to be heading into decline, “Little Jazz” reinvented it. Around the time that he recorded Wabash Stomp, Florida Stomp and the first version of After You’ve Gone, Afro-American music was already being threatened by the ‘civilising’ influence of a stodgy academicism to which it would eventually fall prey in the 1980s. A powerful solvent was needed to strip off the veneer,and Roy was the one who provided it. It was the most effective shot in the arm for jazz since Satchmo left King Oliver to go his own way. To the end, Roy was to remain the wildest and purest of them all.
Nat Hentoff tells how, once in the U.S.S.R., an Izvestia journalist asked Norman Granz which musician he thought best embodied jazz. Oscar Peterson kept whispering, “Tatum. Tatum. Tell him it’s Tatum.” Eventually Granz replied, “No, its Roy Eldridge who embodies what jazz is all about. He’s a musician for whom it’s far more important to dare, to try to achieve a particular peak – even if he falls on his ass in the attempt – than it is to play safe. That’s what jazz is all about.
Alain Gerber
About some of the tracks on this album:
Of all Teddy Wilson’s small-band recording dates between 1934 and 1945, the session of 14th May 1936 remains one of the most memorable. Wilson tended to hire his sidemen on an ad hoc basis, depending on who happened to be available. Having recently joined the Benny Goodman trio on piano, he was playing with the group in Chicago, where the Fletcher Henderson orchestra had an engagement at the Grand Terrace Ballroom. Wilson duly borrowed five of Henderson’s star musicians, plus his guitarist, Bob Lessey.
The great clarinet technician, Buster Bailey, had already done a couple of stints with Henderson (October 1924 to July 1927; January to September 1934). He is sometimes accused of lacking warmth, which could hardly be said of his solos on Warmin’ Up or, indeed, Blues In C Sharp Minor, where the seventeen-year-old bassist Israel Crosby is much in evidence. The piece is also notable for a finely constructed solo from Roy Eldridge, which is both audacious and moving. Eldridge is excellent throughout and demonstrates his vocal talents (and another fine solo) on Mary had A Little Lamb, which also provides a showcase for tenor player Ben Webster’s jubilant energy. “Big Sid” Catlett’s intelligent drumming provides exactly the right backdrop to showcase the soloists.
As leader, Teddy Wilson does not let himself get too carried away by his fiery sidemen and always manages to add an airy, weightless grace to the proceedings, while being capable of turning on the heat if need be.
On 4 August 1936 Roy made his second record date with the Fletcher Henderson orchestra, which also included Buster Bailey and Chu Berry. Six sides were cut that day, two of which, Shoe Shine Boy and You Can Depend On Me (CD 1, tracks 5 and 6), show off the trumpet player to his best advantage. On the first of these he begins with a vocal, then, with a nod in the direction of Louis Armstrong, uses his mute to produce two fine paraphrases of the tune. The second number is a masterly Henderson arrangement that gives Eldridge more scope to take off on his own, and it is considered by some to be his best effort of the session.
At the end of the 1920s, Roy Eldridge’s most important mentors were his own brother, alto player Joe Eldridge, and tenor player Chu Berry. Roy related how the two of them locked him in a hotel room until he had memorised all the popular tunes of the day and could handle his instrument well enough to hold his own in New York. Reedmen had a profound influence on him, notably Benny Carter and Coleman Hawkins. As for trumpet players, Louis Armstrong did not particularly impress him at this stage. He liked Red Nichols’ precision and Rex Stewart’s imaginative phrasing, plus the originality of both men’s approach. Joe Smith’s veiled tone fascinated him, as well as the quirky impetuosity of Jabbo Smith and Henry “Red” Allen. Belatedly, he came to appreciate Armstrong and his capacity to “tell a story”.
Until then Roy was less concerned with communicating with his audience than with an absolute, obsessive mastery of the tool of his trade. He was a brilliant athlete, but not much of an artist. It was to be five years before he was in a position to produce masterpieces like Wabash Stomp, Florida Stomp and After You’ve Gone. A few days after that session, he was back in the studio for Where The Lazy River Goes By and That Thing, where he makes no attempt to produce the same kind of tour de force, even though he still makes full use of his phenomenal technique.
After leaving Henderson, Roy Eldridge and Chu Berry went their separate ways. Berry joined Cab Calloway, while Roy went out on his own to become the idol of the new generation of trumpet players. They had been members of the same bands since 1929, and so it was understandable that Chu should call on Roy for one of the few record dates under his own name. With the brilliant Sidney Catlett on drums, the four sides produced that day are all-time jazz classics. Roy’s solo on Sittin’ In has the kind fiery virtuosity that he and he alone was capable of producing at the time. Even the young Dizzy Gillespie used to go crazy trying to copy him. Stardust is one of his finest ballad performances, full of fresh, revolutionary ideas, expertly delivered. The style was usual among saxophonists, but no trumpet player had ever played a ballad like this. Body And Soul is also excellent, and later on we have the benefit of a second version (CD II, track 11).
Billie Holiday always named Roy Eldridge as one of her favourite backing musicians, and no less a figure than Gunther Schuller considers Eldridge’s recordings with her to be some of his finest work. Indeed, Billie’s version of Falling In Love Again contains a charming muted solo from Roy that you would be listening to all the time, if it were not for the fact that his work on I’m All For You and I Hear Music puts it completely in the shade. Our hero gets the lion’s share of Mildred Bailey’s I’m Nobody’s Baby with a restrained solo that is more like the intimacy of Bobby Hackett than the pyrotechnics of After You’ve Gone.
Curiously, in interviews Roy talks less about Chu Berry than about Coleman Hawkins, possibly because Eldridge had a lot to do with Hawkins in the 1950s. Besides, as Roy told columnist Whitney Balliett, “I dug him, and he dug me.” Borrowing the name of a 1930 Henderson studio group, the 1940 Chocolate Dandies consisted almost entirely of jazz legends. On I Surrender Dear Roy is Hawkins’ only sparring partner, but he is unfazed and does not even flex his muscles. The result is sheer lyricism from both men. OnI Can’t Believe That You’re In Love With Me, however, Eldridge quietly steals Hawkins’ thunder with two 32-bar choruses that Gunther Schuller has described as “virtually flawless”. Bean At The Met, from 31 January 1944, is not quite such a milestone, but the playing is red hot. Laying the groundwork is the kind of rhythm section that was not particularly unusual for those days, but would be simply inconceivable today: Teddy Wilson on piano, Cozy Cole on drums and bassist Billy Taylor. Hawk struts in like a conquistador, forcing Roy to outplay him in the final moments. But, it really is not an issue, as Roy had already had plenty of time before the piano solo to show that fervour, sensitivity, eloquence and a hot temper are not incompatible.
One should not ignore Eldridge’s talents as an entertainer. His duet with Anita O’Day on Let Me Off Uptown works especially well, despite the gratuitous stratospherics and martial quotes that were his trademark with Gene Krupa’s band, where he was the “special attraction”. In her memoirs Anita related that she had to take lessons with a famous vocal coach to get the last syllable of Let Me Off Uptown right!
Roy had already worked with Krupa in 1936 on a session that they were both proud of. He left his own band to join Krupa full time in 1941, staying until the band’s break-up in 1943. He blew his horn, sang and clowned around, and on the nutty Knock me A Kiss he does all three. As he also had moderate – yet swinging – percussion skills, he often played the drum kit when the boss was in front of the band waving a baton. This went beyond all that an audience could possibly hope for. Yet, on one occasion when he could have just sat on his laurels, he produced one of the finest offerings of his entire recorded output – the July 1941 recording of Rockin’ Chair. The arrangement was designed as a star vehicle for the trumpet soloist and it made Roy a national figure.
While he was with Krupa, Roy had encountered the inevitable humiliations that were involved in touring the South. When he joined Artie Shaw in October 1944, it was much the same. As the clarinettist-leader himself remarked, “It was very tough for him racially in my band.” Even so, Eldridge stuck it out until September 1945. Shaw hired master-arranger Buster Harding to write some features for Roy, including the aptly named Little Jazz, which was a license for him to cut loose. Eldridge also plays the only other horn in Shaw’s small group, the Gramercy Five, where we can hear him to good effect on The Grabtown Grapple and Scuttlebutt.
Of the sides by Eldridge’s own big band, made between 16 November 1943 and 24 September 1946, the new version of After You’ve Gone is as fast and furious as the first, and the solo on the remake of Stardust is just as impressive as the earlier one. The Gasser seethes with excitement, while the 1944 version of Body And Soul deserves special mention. It is effusive and moving and makes good use of some of the same ideas about tempo changes as the 1938 version. Here Roy’s art of the thematic paraphrase is on display, as indeed it is ten months later on Embraceable You. The attractive Twilight Time is perhaps not such an imposing work as Stardust, but it has its points. On Fish Market Eldridge meets his match in trombonist Sandy Williams, who never sounded so bold and free. Meanwhile St. Louis Blues, featuring tenor player Franz Jackson, is a textbook example of the overwhelming power of swing.
Let us leave the last word to Dizzy Gillespie, who said, “What I did was very much an extension of what Roy Eldridge had done... I’m just in a long line of contributing trumpet players to the whole picture of jazz. I look at my stature as a major contributor to the music on the same scale as that of Buddy Bolden, King Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Miles Davis and Clifford Brown. The message that a trumpet player brings is specific. All messengers have the same stature. (...) If you called me Roy Eldridge, I’d say, “Huh?”. Because he brought a message and I brought one which, though equal, is not the same. Roy’s message continues too, just like mine, because, you see, I’m from Roy and his message is manifested in me.”
CD Roy Eldridge © Frémeaux & Associés (frémeaux, frémaux, frémau, frémaud, frémault, frémo, frémont, fermeaux, fremeaux, fremaux, fremau, fremaud, fremault, fremo, fremont, CD audio, 78 tours, disques anciens, CD à acheter, écouter des vieux enregistrements, albums, rééditions, anthologies ou intégrales sont disponibles sous forme de CD et par téléchargement.)