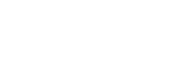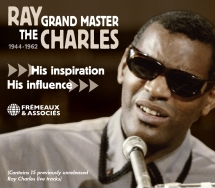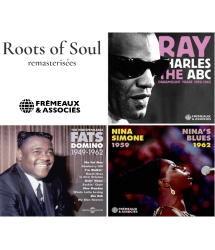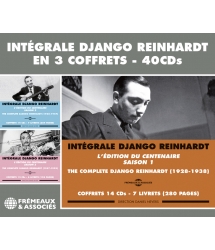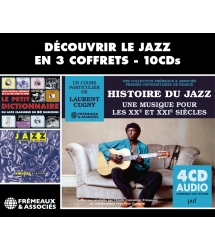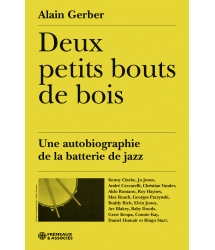Que ce soit en creux ou en bosses, ce livre est intéressant à plus d'un titre (c'est le cas de le dire). D'abord, il est bien écrit, ce qui n'étonnera personne de la part d'un auteur ayant émargé au Goncourt et à l'Interalliée. Par ailleurs, Alain Gerber y parle surtout de lui-même, et c'est souvent là que les écrivains donnent leur meilleur. Ça nous fera toujours un point commun - toutes proportions gardées et rêves de grandeur à part. Sans compter que, nés à quelques mois d'intervalle dans le même monde de bruit et de fureur, nous avons aussi celui d'être devenus l'un et l'autre, à force d'à force, octogénaires : séquence bilan et confession à l'ordre du jour, option testament littéraire... et pour le lecteur, de quoi ouvrir la boîte à souvenirs.
Quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz, du temps du tandem Ténot-Filippachi, d'Europe Number one et de Pour ceux qui aiment le jazz, je n'ai pas compris pourquoi le même mot recouvrait à la fois une musique qui mettait mes molécules en ébullition et une autre qui me plongeait dans l'aridité d'un ennui mortel. J'ai fini par comprendre le fin mot de l'histoire: il y avait bien là deux branches distinctes de l'art musical, chacune avec ses propres critères et son propre public. J'appartenais à l'une et pas à l'autre, et voilà tout.
Autour de moi, c'était la même dichotomie, le plus souvent dans l'autre sens et avec la même passion : pas d'emballage commun à envisager... juste une entourloupe sur les étiquettes ! Les uns avaient été portes par Louis Armstrong, Duke Ellington ou Fats Waller, les autres par Miles Davis (c'est le cas de l'auteur de Deux petits bouts de bois, via, dit-il, les premières mesures du Man I love enregistré le 24 décembre 1954, vous pouvez aller y mettre les oreilles sur YouTube si le coeur vous en dit).
L'époque était à l'agressivité, aux insultes et même parfois aux voies de fait. Deux blocs se harpignaient dans un affrontement inutile : au-delà de la sémantique et de l'enjeu commercial qui allait avec ("jazz", mot magique, était autrement vendeur que "bop", surtout assorti de "moderne"), au-delà aussi des effets de snobisme, aucun des adversaires n'avait la moindre chance de convertir l'autre: personne ne peut s'affranchir de son idiosyncrasie et la sensibilité de chacun, guide de ses choix, n'appartient qu'à lui-même. Par ailleurs, un concept présupposant une évolution linéaire vecteur de progrès artistique n'est pas compatible avec une vision extensive à (au moins) deux dimensions, s'en tenant aux faits, à la transmission et aux expansions, et assimilant l'idée de progrès artistique à un mythe fondé sur une fausse analogie. En somme, deux positions bien tranchées dès l'origine, sans zone tampon objectivement exploitable, comme viennent d'ailleurs expliciter les déclarations parkériennes dont la traduction a été récemment publiée dans la Revue du Jazz.
Rien n'a changé depuis ces hautes époques : même si le livre d'Alain Gerber ne comporte pas un "index des noms cités", ce qui soulignerait ses choix, sa lecture démontre que, au jeu des deux familles, l'auteur est bien identifiable. Son intérêt se porte essentiellement du côté bopien, intimes convictions rythmiques à l'appui: alors que, dans le jazz et depuis toujours, la vocation du batteur est de nourrir l'orchestre, que l'énergie fédérative est sa priorité et que tout ce que lui sa technique, parfois superlative, va dans ce sens, pour Alain Gerber, le batteur a au contraire comme mission "de modérer les transports, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu" - il ajoute que "toute une partie du public s'en désolera". Face au jazz, musique partagée entre la scène et la salle, cette conception réductrice milite pour une autre musique, porteuse d'un entre-soi privilégiant "l'émotion intime, plutôt que l'excitation épidermique". Cette appréciation péjorative marque une sorte d'indifférence élitiste ponctuée d'un balayage des non-initiés... alors que le jazz, lui, est une musique populaire... la musique de tout le monde... alors que l'excitation épidermique est justement le témoignage d'une émotion intime... alors que, premier témoin de cette émotion, la danse, est ici complètement laissée de côté - ce qui renvoie à Jo Jones et à son "sans les danseurs, la musique n'est qu'un tas de notes jetées au hasard".
Sans rapport avec ce qui précède, un autre intérêt de Deux petits bouts de bois est le "fil rouge" de l'ouvrage, passionnante problématique du type zaninien - "tu veux ou tu veux pas"- transposée à la première personne. Une manière de valse-hésitation ne concernant pas le Gerber- écrivain, mais le Gerber-musicien.
Il s'agit ici de batterie et des rapports compliqués qu'il a eu - et qu'il a encore - avec les fûts et les caisses en général et les baguettes en particulier (d'où le titre
de l'ouvrage). Comme il dissèque ses états d'âme avec profondeur et sincérité, son propos est passionnant - et concerne beaucoup de monde. Il en ressort - sauf
erreur de ma part - que, toute sa vie, l'auteur a été hanté par une vocation de musicien condamnée à l'inaboutissement.
Alain Gerber en sait long comme le bras sur la batterie : au fil des pages, vous en apprendrez beaucoup sur les peaux, les alliages à base de cuivre et les accessoires de toutes sortes, Et naturellement sur les baguettes - il en a tellement collecté de toutes tailles, diamètres, poids, couleurs, signatures et morphologies de l'olive terminale, qu'il pourrait sans doute ouvrir un musée et même établir un guide des bonnes adresses. Batteur, il a fait tout ce qu'il y avait à faire : écouter des tonnes de disques, chercher à le faire en compagnie de musiciens accomplis, s'entraîner à jouer dessus et même prendre des leçons. C'est ensuite que ça coince, car, s'il se rêve musicien, quelque chose en lui se dérobe quand il s'agit de le devenir. Le chapitre "jouer en pure perte" expose le cas avec un significatif souci du détail. Une dizaine de pages plus loin, il constate : "Les tambours et moi, nous connûmes de longues et lentes fiançailles. Que j'ai prises pour des noces, mais le mariage ne fut jamais consommé. J'ai joué de la batterie comme, enfant, on joue au docteur ou au voleur : c'était pour de faux". Mots terribles, qui ouvrent au lecteur quelques pistes de réflexion. Pour ma part, ils m'ont renvoyé à une discussion avec Buddy Tate sur le meilleur conseil à donner à un jeune musicien. Son point de vue : "Allez jouer devant des gens! vous ne ferez jamais de jazz en restant dans votre chambre".
Partager avec un public est en effet le but du jeu, la compensation de tant d'efforts et de transpiration, l'ouverture à d'autres progrès que ceux de la technique, et tout autant fondamentaux... c'est là qu'il faut s'asseoir sur ses complexes et se rappeler Louis Armstrong: "l'important n'est pas d'être le meilleur, mais de faire de son mieux". Il reste alors à se jeter à l'eau avec - et malgré - la conviction qu'on ne sait pas nager. Et là, devant tout ce monde venu vous entendre, plus de faux- semblants: de ce côté-là de la rampe, vous êtes tout nu. Jouer "pour de faux"? Le père Armstrong, de nouveau : "Le jazz est uniquement ce que vous êtes vous-même". Se donner ou pas.
Maintenant, si vous préférez rester un musicien de living-room (comme on dit là-bas), vous passez à côté du plus important... du trac qui vous tordra toujours les tripes au moment de vous y jeter... de la marée invisible montant de la salle et déferlant sur l'orchestre à l'instant où il soulève l'adhésion de ceux qui lui font face...du bonheur de jouer pour de bons danseurs et de profiter de leur retour... des joies terribles du batteur, justement, pris dans le fracas et la montée en puissance d'un orchestre jouant sous son autorité comme un seul homme, en pleine synergie.. d'avoir donné à vos contemporains un moment
d'évasion dans une émotion commune. Moments profondément gratifiants, mais inséparables de grosses prises de risque... il y a de la bagarre, là-dedans ! et cette bagarre de Gerber avec lui-même est ici parfaitement analysée, décortiquée, explicitée, aussi bien qu'un fameux verre de cognac le fut en son temps chez M.de Talleyrand (Périgord) reposé intact sur le guéridon avant de devenir sujet de conversation.
Regrets éternels ? Repli stratégique? Pesanteurs de l'inconscient ? Au lecteur de conclure - ou pas -, voire de faire son propre examen de conscience...voire même de passer à l'acte s'il se sent des dispositions. Sans doute me direz-vous que, justement, le bop ne vous intéresse pas plus que ça et que vous préférez balader vos oreilles dans un jardin extraordinaire plutôt que dans un champ de chardons. Je veux bien ! mais là, franchement, il n'est pas inutile d'aller faire un tour chez le voisin d'en face, d'en savoir plus sur sa propre culture et de profiter d'une auto-dérision teintée d'humour... cette politesse du désespoir.
Laurent Verdeaux - La revue du jazz - Bulletin du Hot Club de France