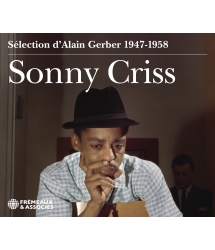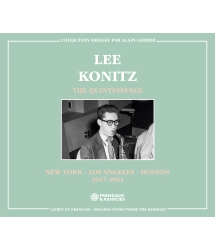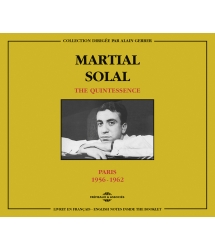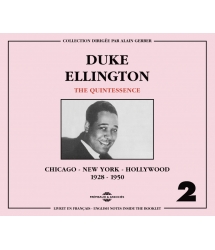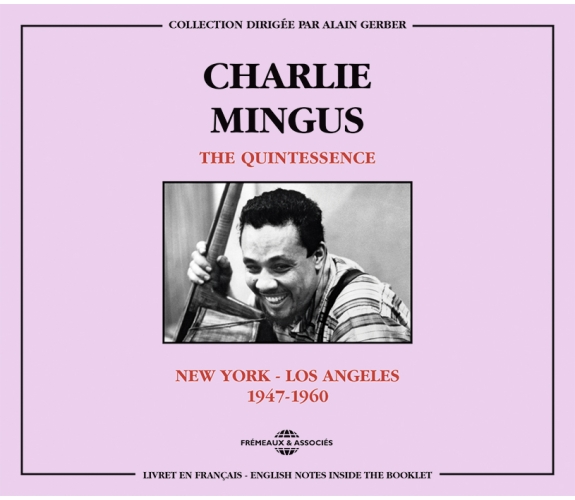- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire











- Notre Catalogue
- Philosophie
- Philosophes du XXème siècle et d'aujourd'hui
- Histoire de la philosophie (PUF)
- Contre-Histoire et Brève encyclopédie par Michel Onfray
- L'œuvre philosophique expliquée par Luc Ferry
- La pensée antique
- Les penseurs d'hier vus par les philosophes d'aujourd'hui
- Textes philosophiques historiques interprétés par de grands comédiens
- Histoire
- Livres
- Sciences Humaines
- Paroles historiques
- Livres audio & Littérature
- Notre Catalogue
- Jazz
- Blues - R'n'B - Soul - Gospel
- Rock - Country - Cajun
- Chanson française
- Musiques du monde
- Afrique
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- Antilles
- Caraïbes
- Cuba & Afro-cubain
- Mexique
- Amérique du Sud
- Tango
- Brésil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Espagne
- Yiddish / Israël
- Chine
- Tibet / Népal
- Asie
- Océan indien / Madagascar
- Japon
- Indonésie
- Océanie
- Inde
- Bangladesh
- URSS / Chants communistes
- Musiques du monde / Divers
- Musique classique
- Compositeurs - Musiques de film - B.O.
- Sons de la nature
- Notre Catalogue
- Jeunesse
- Philosophie
- Nouveautés
- Comment commander ?
- Recevoir le catalogue
- Manifeste
- Dictionnaire
NEW YORK - LOS ANGELES (1947-1960)
CHARLIE MINGUS
Ref.: FA293
EAN : 3448960229326
Direction Artistique : ALAIN GERBER AVEC DANIEL NEVERS ET ALAIN TERCINET
Label : Frémeaux & Associés
Durée totale de l'œuvre : 2 heures 18 minutes
Nbre. CD : 2
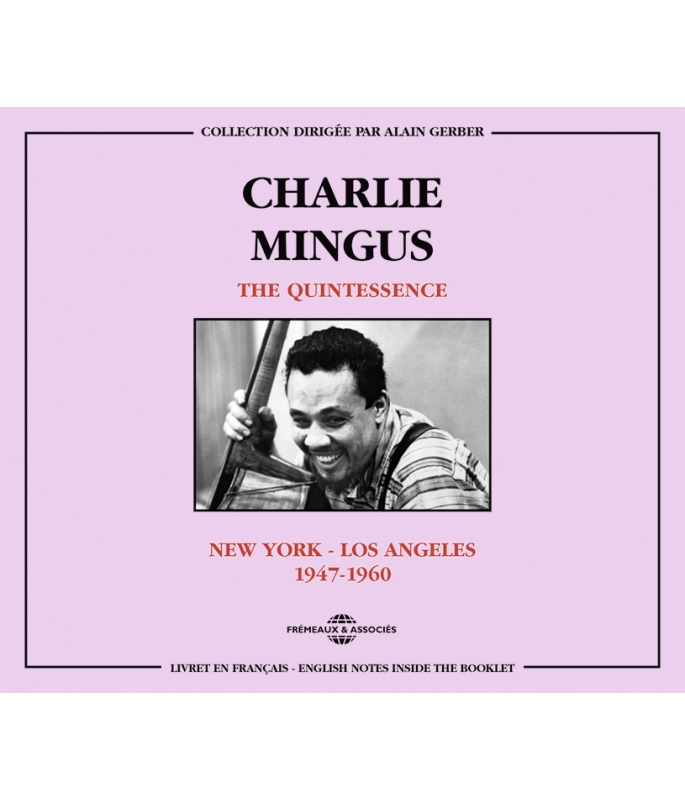
NEW YORK - LOS ANGELES (1947-1960)
Dur comme fer, il se croyait la cible élue du désastre, le souffre-douleur personnel de toutes les oppressions, le préjudice incarné. Son appétit de persécution aurait trouvé refuge dans la folie, si la musique ne lui avait accordé le privilège d’être plus fou encore.
Alain GERBER
Les coffrets « The Quintessence » jazz et blues, reconnus pour leur qualité dans le monde entier, font l’objet des meilleurs transferts analogiques à partir des disques sources, et d’une restauration numérique utilisant les technologies les plus sophistiquées sans jamais recourir à une modification du son d’origine qui nuirait à l’exhaustivité des informations sonores, à la dynamique et la cohérence de l’acoustique, et à l’authenticité de l’enregistrement original.
Chaque ouvrage sonore de la marque « Frémeaux & Associés » est accompagné d’un livret explicatif en langue française et d’un certificat de garantie.
He blindly believed himself to be disaster’s chosen target, the personal whipping boy of all kinds of repression, prejudice incarnate. His appetite for persecution would have found refuge in madness if music hadn’t granted him the privilege of being even madder.
Alain GERBER
Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee.
This 2 CD set present a selection of the best recordings by Charles Mingus between 1947 and 1960.
DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN GERBER AVEC Daniel Nevers ET ALAIN TERCINET
DROITS : DP / FREMEAUX & ASSOCIES
CD 1 (1947-1957) - LIONEL HAMPTON & HIS ORCHESTRA (10/11/1947) : MINGUS FINGERS (C.MINGUS). CHARLES MINGUS JAZZ COMPOSERS WORKSHOP (31/10/1954) : TEA FOR TWO (V.YOUMANS). CHARLES MINGUS QUINTET (30/01 & 13/03/1956) : PITHECANTHROPUS ERECTUS (C.MINGUS) • TONIGHT AT NOON (C.MINGUS) • HAITIAN FIGHT SONG (C.MINGUS). CHARLES MINGUS “TIJUANA MOODS” (18/07/1956) : YSABEL’S TABLE DANCE (C.MINGUS). CHARLES MINGUS “EAST COASTING” (6/08/1957) : WEST COAST GHOST (C.MINGUS). CHARLES MINGUS “A MODERN JAZZ SYMPOSIUM” (8/10/1957) : SCENES IN THE CITY (C.MINGUS).
CD 2 (1959-1960) -CHARLES MINGUS QUINTET (16/01/1959) : NOSTALGIA IN TIMES SQUARE (C.MINGUS). CHARLES MINGUS “BLUES & ROOTS” (4/02/1959) : MY JELLY ROLL SOUL (C.MINGUS) • MOANIN’ (C.MINGUS). CHARLES MINGUS“AH! HUM!” (5 & 12/05/1959) : SELF-PORTRAIT IN THREE COLORS (C.MINGUS) • BIRD CALLS (C.MINGUS) • GOODBYE PORK PIE HAT (C.MINGUS) • BETTER GIT IT IN YOUR SOUL (C.MINGUS). CHARLES MINGUS “MINGUS DYNASTY” (1/11/1959) : SONG WITH ORANGE (C.MINGUS) • GUNSLINGING BIRD (C.MINGUS). CHARLES MINGUS ORCHESTRA “PRE-BIRD” (24/05/1960) : BEMOANABLE LADY (C.MINGUS). CHARLES MINGUS PRESENTS CHARLES MINGUS (20/10/1960) : ORIGINAL FABLES OF FAUBUS (C.MINGUS).
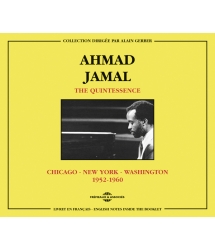
CHICAGO - NEW YORK - WASHINGTON 1952-1960
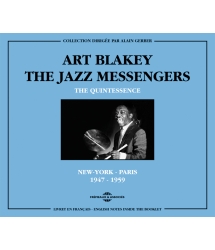
NEW-YORK - PARIS 1947-1959
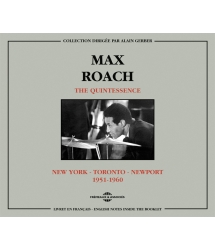
NEW YORK - TORONTO - NEWPORT 1951-1960
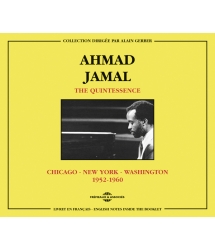
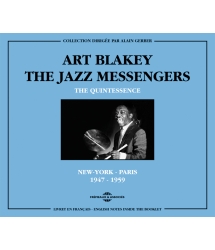
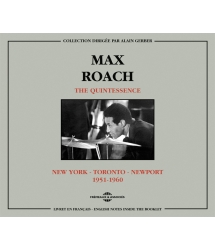
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1Mingus FingersCharles Mingus-Lionel Hampton & His Orchestra00:03:061947
-
2Tea For TwoCharles Mingus Jazz Composers Workshop00:06:191954
-
3Pithecanthropus ErectusCharles Mingus Quintet00:10:361956
-
4Tonight At NoonCharles Mingus Quintet00:06:001957
-
5Haitian Fight SongCharles Mingus Quintet00:12:041957
-
6Ysabel's Table DanceCharles Mingus Tijuana Moods00:10:291957
-
7West Coast GhostCharles Mingus East Coasting00:10:291957
-
8Scenes in The CityCharles Mingus A Modern Jazz Symposium00:11:511957
-
PisteTitreArtiste principalAuteurDuréeEnregistré en
-
1Nostalgia in Time SquareCharles Mingus Quintet00:12:121959
-
2My Jelly Roll SoulCharles Mingus Blues & Roots00:06:501959
-
3Moanin'Charles Mingus Blues & Roots00:08:031959
-
4Self Portrait in Three ColorsCharles Mingus Ah! Hum!00:03:121959
-
5Bird CallsCharles Mingus Ah! Hum!00:03:181959
-
6Goodbye Pork Pie HatCharles Mingus Ah! Hum!00:04:541959
-
7Better Git in Your SoulCharles Mingus Ah! Hum!00:07:321959
-
8Song With OrangeCharles Mingus Mingus Dynasty00:04:191959
-
9Gunslinging BirdCharles Mingus Mingus Dynasty00:04:021959
-
10Bemoanable LadyCharles Mingus Pre-Bird00:04:271959
-
11Original Fables of FaubusCharles Mingus presents Charles Mingus00:09:131959
Charlie Mingus FA293
COLLECTION DIRIGÉE PAR ALAIN GERBER
CHARLIE
MINGUS
THE QUINTESSENCE
NEW YORK - LOS ANGELES
1947-1960
LIVRET EN FRANçAIS - ENGLISH NOTES INSIDE THE BOOKLET
DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY
CD 1 (1947-1957)
1. MINGUS FINGERS (C.Mingus) (Decca 24428/mx.DLA 4544-A) 3’04
LIONEL HAMPTON and His ORCHESTRA : Wendell CULLEY, Richard “Duke” GARRETTE, Walter WILLIAMS, Teddy BUCKNER, Leo SHEPPARD (tp) ; James ROBINSON, Britt WOODMAN, James WARWICK, Andrew PENN (tb) ; Jack KELSA (cl, as) ; Robert PLATER, Ben KYNARD (as) ; Morris LANE, John SPARROW (ts) ; Charles FOWLKES (bars) ; Lionel HAMPTON (vibes, ldr) ; Milton BUCKNER (p) ; William MACKEL (g) ; Charles MINGUS (b, arr) ; Earl WALKER (dm). Los Angeles, 10/11/1947
2. TEA FOR TWO (V.Youmans) (Savoy MG 1259) 6’16
CHARLES MINGUS JAZZ COMPOSERS WORKSHOP : John LA PORTA (cl, as) ; Teo MACERO (ts, bars) ; George BARROW (bars) ; Mal WALDRON (p) ; Charles MINGUS (b, ldr) ; Rudy NICHOLS (dm).
New York City, 31/10/1954
3. PITHECANTHROPUS ERECTUS (C.Mingus) (Atlantic LP 1237/mx.1865) 10’33
CHARLES MINGUS QUINTET : Jackie McLEAN (as) ; J.R.MONTROSE (ts) ; Mal WALDRON (p) ; Charles MINGUS (b) ; Willie JONES (dm). New York City, 30/01/1956
4. TONIGHT AT NOON (C.Mingus) (Atlantic LP 1416/mx.2456) 5’57
5. HAITIAN FIGHT SONG (C.Mingus) (Atlantic LP 1260/mx.2458) 12’01
CHARLES MINGUS QUINTET : Jimmy KNEPPER (tb) ; Curtis PORTER (as, ts) ; Wade LEGGE (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm). New York City, 13/03/1957
6. YSABEL’S TABLE DANCE (C.Mingus) (Victor LPM 2533/mx.H4JB5225) 10’26
CHARLES MINGUS TIJUANA MOODS : Clarence SHAW (tp) ; Jimmy KNEPPER (tb) ; Curtis PORTER (as, ts) ; Bill TRIGLIA (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm) ; Frankie DUNLOP (perc) ; Ysabel MOREY (castagnettes/castanets); Lonnie ELDER (voix/voice). New York City, 18/07/1957
7. WEST COAST GHOST (C.Mingus) (Bethlehem BCP 6019/take 6) 10’26
CHARLES MINGUS “EAST COASTING” : Formation comme pour 6 / Personnel as for 6. Moins/minus DUNLOP, MOREY & ELDER ; Bill EVANS (p) remplace / replaces TRIGLIA. New York City, 6/08/1957
8. SCENES IN THE CITY (C.Mingus) (Bethlehem BCP 6026) 11’51
CHARLES MINGUS “A MODERN JAZZ SYMPOSIUM” : Formation comme pour 7 / Personnel as for 7. Sol HAMMER (p) remplace/replaces EVANS. Melvin STEWART (comment). New York City, 8/10/ 1957
DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY
CD 2 (1959-1960)
1. NOSTALGIA IN TIMES SQUARE (C.Mingus) (United Artists UA 14036) 12’10
CHARLES MINGUS QUINTET : John HANDY (as) ; Booker ERVIN (ts) ; Richard WYANDIS (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm). Nonagon Art Gallery, New York City, 16/01/1959
2. MY JELLY ROLL SOUL (C.Mingus) (Atlantic LP 1305/mx.3347) 6’48
3. MOANIN’ (C.Mingus) (Atlantic LP 1305/mx.3349) 8’00
CHARLES MINGUS “BLUES & ROOTS” : Jimmy KNEPPER, Willie DENNIS (tb) ; Jackie McLEAN, John HANDY (as) ; Booker ERVIN (ts) ; Pepper ADAMS (bars) ; Horace PARLAN (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm). New York City, 4/02/1959
4. SELF-PORTRAT IN THREE COLORS (C.Mingus) (Columbia CS 8171/mx.Co 63341) 3’10
5. BIRD CALLS (C.Mingus) (Columbia CS 8171/mx.Co 63155) 3’16
6. GOODBYE PORK PIE HAT (C.Mingus) (Columbia CL 8171/mx.Co 63342) 4’52
7. BETTER GIT IT IN YOUR SOUL (C.Mingus) (Columbia CS 8171/mx.Co 63154) 7’29
CHARLES MINGUS ENSEMBLE “AH ! HUM !” : Willie DENNIS (tb sur/on 4) ; Jimmy KNEPPER (tb sur/on 7) ; John HANDY (as) ; Curtis PORTER (as, ts) ; Booker ERVIN (ts) ; Horace PARLAN (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm). New York City, 5/05 (5 & 7) & 12/05 (4 & 6)/1959
8. SONG WITH ORANGE (C.Mingus) (Columbia CS 8236/mx.Co 63882) 4’17
9. GUNSLINGING BIRD (C.Mingus) (Columbia CS 8236/mx.Co 63881) 4’00
CHARLES MINGUS “MINGUS DYNASTY” : Richard WILLIAMS (tp) ; Jimmy KNEPPER (tb) ; Jerome RICHADSON (as, fl) ; John HANDY (as) ; Booker ERVIN, Benny GOLSON (ts) ; Teddy CHARLES (vibes) ; Roland HANNA (p) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm, tymp). New York City, 1/11/1959
10. BEMOANABLE LADY (C.Mingus) (Mercury MG 20627/mx.20095) 4’25
CHARLES MINGUS ORCHESTRA “PRE-BIRD” : Marcus BELGRAVE, Ted CURSON, Hobart DOTSON, Clark TERRY, Richard WILLIAMS (tp) ; Charles GREENLEE, Eddie BERT, Slide HAMPTON, Jimmy KNEPPER (tb) ; Don BUTTERFIELD (tuba) ; Harvey SCHUMANN (hautbois/oboe) ; Bob DOMENICA (fl) ; Eric DOLPHY (fl, as, bcl) ; John LA PORTA (cl, as) ; Yusef LATEEF (fl, ts); Bill BARON, Joe FARRELL (ts) ; Danny BANK (bars) ; Charles McCRACKEN (vcl/cello) ; Roland HANNA (p) ; Charles MINGUS (b, arr, ldr) ; Dannie RICHMOND (dm) ; Sticks EVANS, George SCOTT (perc). New York City, 24/05/1960
11. ORIGINAL FABLES OF FAUBUS (C.Mingus) (Candid CJM 8005) 9’13
CHARLES MINGUS PRESENTS CHARLES MINGUS : Ted CURSON (tp) ; Eric DOLPHY (as, bcl) ; Charles MINGUS (b) ; Dannie RICHMOND (dm) ; vocal trio (CM, DR + 1). New York City, 20/10/1960
Écorché vif sur un lit de clous
Croyez-vous que Mingus était un révolté, un guerrier sanguinaire prêt à tout, comme ça, parce qu’il était avant tout un homme de combat ? Non, Charles Jr était un homme amoureux. D’abord amoureux et exclusivement amoureux. De l’humanité. De ce qu’il y a d’amoureux dans chacun de nous.
Michel Arcens (Il ne savait pas qu’il était nègre…, in « Instants de Jazz », publié en 2010 aux éditions Alter Ego)
Dans la jungle des villes, écrasé sous son propre poids, portant l’orage et l’été sur sa nuque, Mingus aux talons safranés traînait sur le bitume ses caissons de mitraille.
Par les savanes pétrifiées, par les brousses de rouille, sous le fracas du métro aérien, Mingus aux talons d’airain allait à marche forcée vers les murs d’une hypothétique Jéricho.
En s’écartant sur son passage, les moulins à vent d’eux-mêmes se brisaient les ailes. Livides, les belles paroles fuyaient de tout côté, comme des rats, sans demander leur reste. Le silence se mettait à claquer des dents.
Nulle créature, cependant, ne fut plus terrifiée que le fauteur de ces troubles bizarres. Dur comme fer, il se croyait la cible élue du désastre, le souffre-douleur personnel de toutes les oppressions, le préjudice incarné. Son appétit de persécution aurait trouvé refuge dans la folie, si la musique ne lui avait accordé le privilège d’être plus fou encore.
Fleuve de braise, brasier de sang, son œuvre étincelante et barbare — cette espèce de San Marco sonore embrasé par ses reflets d’icône et ses enluminures, cet attentat d’une splendeur déchirante, ce baptême crépusculaire, ce deuil aux accents de fête foraine — est lourde de menaces, mais Minkus Finkus, Chazz, le Baron ou quel que soit le nom qu’on lui donne n’en aura pas proféré une seule dont il ne fût le premier à trembler. L’effroi était son matériau de prédilection. Rien d’autre peut-être, dans tout le jazz, ne s’est à ce point nourri de l’impuissance et ne s’est autant acharné à entretenir la panique.
Mingus, obèse Alice au pays des maléfices, a joué, composé, dirigé ses orchestres comme il a vécu : bringuebalé par les passions, poreux aux sortilèges, empaqueté dans la chair de poule, affecté d’un priapisme dantesque, sans cesse importuné dans ses grandioses méditations par un ramassis de pithécanthropes, exposé au regard sinistré des clowns, obsédé par Duke Ellington (qui l’avait flanqué à la porte de son orchestre), cerné par les spectres1 et enfumé par les mauvaises femmes, guetté par la bombe atomique2 en équilibre instable au-dessus de son crâne à lui, promis aux trahisons, aux calomnies, aux superbes indifférences, voué de naissance au panier à salade et au passage à tabac, éternellement poussé vers des cellules, des donjons, vers ces arbres du Sud, porteurs d’étranges fruits, regardé de haut par le dernier des derniers, assailli par les cauchemars, les malchances, les accès de goinfrerie, les illusions d’intégration et les fantasmes de défense passive, par les nazis américains en goguette, par les docteurs sans foi et les docteurs sans loi, les fuligineux comptables des compagnies de disques, les critiques, il va de soi, les infortunés amoureux de son art, incapables de l’aimer comme il aurait fallu, les inaccessibles pantins de ses colères, les gouverneurs Faubus, les Rockfeller d’Attica, bref : la lie de la blanchaille, associée aux chiens de l’enfer. Sans brevet de fakir, l’écorché vif s’est allongé sur un lit de clous.
Davantage que nombre d’apôtres du retour aux sources, brûlant même sur ce terrain la politesse à Horace Silver ou à Milt Jackson, disqualifiant presque les pianistes Bobby Timmons, Gene Harris3 et Vic Feldman, Charles Mingus crucifié apparaît comme l’enfant du blues. Parfois le fils caché, souvent le fils ostentatoire. Le plus naturel de tous ses enfants, quoi qu’il en soit. Né de la haine et de l’amour, né du cafard et du rire : son très incestueux bâtard. Je veux dire le fils qu’il s’est fait à lui-même, n’ayant que sa propre engeance pour tolérer ses étreintes. Le fils non voulu par le reste de l’univers, né paria au fond d’une impasse, avec déjà, livré dans sa tête, un ghetto clé en main. Et puis aussi le fils prodigue— prodigue des tourments et des fièvres qu’il a reçus en héritage. Il va parmi ceux qui connaissent des chansons d’amour, des tours de cartes, des adresses de mages et de faiseuses d’anges, mais qui n’apprivoiseront jamais aucune malédiction. Il est de ces hommes qui se sont levés ce matin comme chaque jour pour se rendre au carnage sans musette ni gamelle, suivant à pied les rails du tramway. Il est de ceux qu’on voit plantés à contre-voie une valise à la main, résignés à l’insurrection de chaque fibre de leur chair, résignés à la payer cher et rubis sur l’ongle, résignés à ce qu’elle soit aussi vaine que de première nécessité.
Le gros Ming, épouvantail du petit Charlie juché sur ses épaules, arpente le carrefour des solitudes à l’heure de pointe. On prétend que le désespoir rend la jubilation facile. Il s’est promis d’être le boute-en-train d’une liesse absurde. Son angoisse ne se dissipe pas pour autant. Le sel de la terre a pris un goût suspect. Mingus tressaille au moindre bruit dans son dos. Vous lui demandez l’heure : il sort l’artillerie lourde. Vous ne lui demandez rien : il se met à pleurer à chaudes larmes. À tout bout de champ, il perd le fil de sa vie. Le soleil tourne, mais les ombres restent clouées sur lui. Quand personne ne regarde, il essaie de coller ses rêves à ses paupières.
Mingus rassemble autour de lui ce qu’il a pu sauver des embuscades qu’il s’est tendues. Il faut de tout pour faire le monde cruel et enchanté de Sir Charles, qu’on visite en empruntant un train fantôme de son invention, les cheveux dressés sur la tête. Des mascarades et des masques arrachés avec la peau du visage. D’exquises apparitions, des hallucinations exorbitantes. Doux oiseaux de tendresse, vieux urubus gavés de pourriture. Il y a des morceaux de soleil pur et des formes inquiétantes. Des murs couverts d’urine, de majestueux portails semés de pétales de roses. Des néons, des bûchers. Des péans et des thrènes. Des chants d’ivresse, entrecoupés de sanglots. Chants du coton, chants du béton, chants des ultimes traces. Il y a des préciosités, des matins obscurs et des meurtres de sang chaud. Des insultes, des mots d’alcôve. Des viols attendris et des noces de la dernière chance. Des célébrations, des funérailles. Des doigts tranchés dans une assiette à fleurs. Il y a encore encore des hymnes cannibales, des symphonies achevées à l’arme blanche, des concertos rongés par la lèpre, des messes clandestines et des prières du mercredi soir, de patibulaires espagnolades, des flamencos de coupe-gorge, des salsas en train de tourner au vinaigre, des gospels qui fleurent le fagot, des menuets pour culs-de-jatte et miraculés d’arrière-cour, des fugues éperdues, des berceuses à réveiller les morts, de voluptueuses fanfares et enfin, rescapé de toutes ses exécutions capitales, déambulant là au travers, un piège à loup à chaque jambe, il y a Mingus, Mingus, Mingus…
Il ne marchait pas droit, il ne filait pas doux. Excessivement amoureux, comme le souligne Michel Arcens, de tous les amours qui se refusaient à partager avec le sien. C’était un homme, tout simplement. En principe et de toute évidence un homme — mais trop de gens ne voulaient pas le savoir. Etre un homme, quelquefois dans l’existence, cela n’arrive qu’aux autres.
Alain Gerber
© 2013 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux & Associés
1. Fats Navarro, Fats Waller, Charlie Parker, Freddie Webster, Jelly Roll Morton, Lester Young et son « pork pie hat », entre autres.
2. On songe bien sûr à Devil Woman et à Oh Lord Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb On Me, pièces proposées en 1961 dans le microsillon « Oh Yeah », ainsi d’ailleurs que Passions Of A Man. D’autres allusions seront faites à des pièces extraites d’autres disques comme Put Me In That Dungeon (in « Mingus Dynasty »),Weird Nightmare, Prayer For Passive Resistance (in « Pre-Bird »),Meditations On Integration (gravé plusieurs fois, notamment à Paris les 17 et 19 avril 1964), le célébrissime Fables Of Faubus, puis Free Cell Block F, ‘tis Nazi U.S.A. et Remember Rockfeller At Attica (« Changes One » et « Changes Two »).
3. Fondateur en 1956 d’un trio soulissime : The Three Sounds, qui enregistrera pour Blue Note à bride abattue à partir de 1958.
CHARLES MINGUS – À PROPOS DE LA PRÉSENTE SÉLECTION
Le 20 septembre 1951 débutait au Birdland le « Miles Davis All Stars » ; y tenait la basse, un nouveau venu que Miles avait côtoyé quelques années plus tôt en Californie, Charles Mingus. À la suite d’un incident à tout le moins regrettable, il venait de quitter un trio auquel il appartenait depuis plus d’un an, celui du vibraphoniste Red Norvo.
Contacté par Mel Tormé, ce dernier avait été invité à se produire dans un show télévisé lorsque les représentants du Local 802 (la section new-yorkaise du syndicat des musiciens) s’aperçurent que, venu de Californie, Mingus n’était pas inscrit chez eux. Mis en demeure de changer de bassiste ou de renoncer à paraître à la télévision, Norvo remplaça exceptionnellement Mingus par Clyde Lombardi. Une péripétie qui, aux yeux du bassiste, prit les dimensions d’une affaire d’État et entraîna sa démission. Avec pertes et fracas.
Décidé à s’installer à New York à presque trente ans, Mingus n’avait plus qu’à tirer un trait sur ce qu’il avait accompli jusqu’alors. La Grosse Pomme n’attachait pas la moindre importance à ce qui se déroulait hors de ses murs or, né à Nogales, Arizona, le 22 avril 1922, Charles Mingus Jr. avait débuté à… Los Angeles.
« Une grande partie de ma musique vient de l’église. Ce fut seulement aux alentours de huit ou neuf ans que j’entendis à la radio un disque d’Ellington. Mon père allait à l’église Méthodiste alors que ma belle-mère m’emmenait à la Holiness Church, ce qu’il n’appréciait guère, la jugeant trop primitive. S’adressant directement au Seigneur, les fidèles confessaient leurs péchés, chantaient, hurlaient, se roulaient par terre. Certains prédicateurs chassaient les démons en utilisant des langues inconnues que le Diable ne pouvait comprendre. Les croyants entraient en transe et les réactions de la congrégation étaient plus sauvages, moins inhibées qu’à l’église méthodiste. Le blues avait droit de cité dans les Holiness Churches – plaintes, interjections, tout ce genre d’échanges entre l’audience et le prédicateur (1). » Mingus s’en souviendra toute sa vie.
Après une vaine tentative pour dompter le trombone, ce qui lui donna l’occasion de se lier d’amitié avec Britt Woodman, Mingus commença à dix ans l’étude du violoncelle. Entré en 1934 dans l’orchestre de la Jordan High School, l’un de ses condisciples, Buddy Collette, lui mit l’année suivante le marché en main: « Bon, tu as un violoncelle, j’ai un orchestre. J’envisage d’y adjoindre un bassiste. Si tu peux laisser tomber ton violoncelle et trouver une basse, le boulot est pour toi (2). »
Avec Red Callender en tant que conseiller puis Hermann Rheinschagen, ancien membre du New York Philarmonic Orchestra comme professeur, Mingus apprit à domestiquer la contrebasse tout en étudiant le piano et la composition. « J’essayais d’écouter tous les orchestres qui passaient en ville. Lorsque j’ai entendu pour la première fois Duke Ellington en personne, j’ai presque sauté du balcon. Un morceau m’excita tellement que je me suis mis à hurler. J’ai aussi beaucoup écouté Art Tatum et, plus tard, j’ai essayé de jouer avec lui mais il m’a ri au nez (3). »
Mingus débuta une carrière professionnelle en 1940 dans la formation du batteur Lee Young, frère de Lester, ainsi qu’au sein du grand orchestre d’Alvino Rey. Engagé trois ans plus tard par Louis Armstrong, apprenant que la tournée se dirigeait vers le Sud profond, il préféra démissionner. Parallèlement à une succession d’engagements multiples et variés, il commença à enregistrer quelques-unes de ses compositions, s’attribuant pour l’occasion le titre de « Baron ».
Arrivé en Californie à la fin de 1947, Lionel Hampton désirait engager un second bassiste. Britt Woodman alors membre de son orchestre, fit écouter un disque de Mingus à Gladys Hampton et au batteur Curley Hamner. Une brève audition et la cause était entendue. « Mingus rentra chez lui et arrangea pour grand orchestre sa composition Mingus Fingers ainsi que douze autres morceaux. Désormais Hamp fit jouer Fingers à chaque représentation, et à la première séance à laquelle mon copain participa, pour Decca, le morceau fut enregistré sur décision du chef et à la surprise de l’auteur. Ce fut sa première composition enregistrée dans son arrangement original par un orchestre célèbre. » Un extrait de « Moins qu’un chien », l’autobiographie fantasmée de Mingus qui, pour l’occasion, parle de lui à la troisième personne.
Tranchant quelque peu dans le répertoire d’Hampton, montrant à quel niveau de maîtrise instrumentale son compositeur était arrivé, Mingus Fingers mettait en évidence les exceptionnelles qualités d’arrangeur de quelqu’un qui, empoignant la pâte orchestrale à pleines mains, ne reculait pas devant l’excès.
Au terme d’un engagement de moins d’un an s’ensuivit pour Mingus une période de vaches maigres durant laquelle il prétendit avoir subsisté en se faisant souteneur ; un fantasme de plus. En fait, Red Norvo, à sa recherche, le retrouva employé aux Postes. Comme son père…
Après quelques débuts difficiles à New York en attendant son indispensable « cabaret card », Mingus ne perdit pas son temps, accompagnant Charlie Parker, Stan Getz, Bud Powell, participant à Toronto au concert historique du Massey Hall en compagnie de Dizzy et de Bird tout en flirtant avec le cercle des disciples de Lennie Tristano. Tout juste engagé par Duke Ellington, il avait réussi la prouesse de se faire congédier en raison d’une bagarre l’opposant à un autre mauvais coucheur, Juan Tizol, et de trouver le temps de fonder avec Max Roach une compagnie phonographique, Debut. Ce qui ne l’empêcha pas de faire des infidélités à son propre label puisque le 31 octobre 1954, à la tête de son sextette, il enregistrait pour Savoy sous la raison sociale de « The Jazz Composers Workshop ».
Au programme, une étonnante version de Tea for Two dans laquelle se trouvaient mixés des fragments de Perdido, Body and Soul et Prisoner of Love, toutes compositions basées sur la même trame harmonique que la mélodie de Vincent Youmans. Un patchwork musical parfaitement réussi, quelque peu héritier des expériences menées par Lennie Tristano, dont le son d’ensemble évoquait ce que l’on entendait sur la West Coast à la même époque …
« J’essaye d’exprimer ce que je suis vraiment. La raison pour laquelle c’est si difficile tient au fait que je change continuellement (4). » Pithecanthropus Erectus marque le moment à partir duquel l’œuvre de Mingus va ressembler à « une longue émeute musicale. Elle en a les flambées, les accalmies, les reprises brutales, la spontanéité qui déborde les schémas révolutionnaires » comme l’écrivit Jacques Réda (5). Jean Wagner en décrivit le « modus operandi » : « En simplifiant au maximum, il est possible de concevoir l’écriture orchestrale mingusienne comme celle d’un cri collectif poussé par un groupe de musiciens dans une direction qui, elle, est d’essence individuelle. Le chef d’orchestre est celui qui conçoit et celui qui excite : il donne à ses solistes une base précise qui lui appartient en propre ; ensuite, il diffuse quelques excitants et il n’a de cesse que ses sidemen aillent au bout d’eux-mêmes. Le résultat est un univers esthétique essentiellement baroque où la sincérité et l’authenticité savent recouvrir ce que l’entreprise peut compter, au départ, d’artifice. Autant que les plus grands, Charlie Mingus utilise son orchestre comme un instrument (6). »
Un mode de fonctionnement identique à celui qu’avait adopté Ellington à une différence près : Mingus manifestait la plus grande défiance envers les partitions écrites qui, à ses yeux, bridaient chez ses interprètes leur créativité naturelle que, paradoxalement, il entendait infléchir selon ses humeurs. Ce que la plupart du temps - paranoïa oblige - il faisait d’une manière conflictuelle. John Handy : « Vous ne pouviez jamais être détendu avec Charles. Il y avait toujours des tensions inutiles, des intimidations superflues. S’il n’aimait pas quelque chose que vous aviez fait, il menaçait d’appeler quelqu’un pour vous remplacer et cela en votre présence. Le pire de tout, c’était une bonne partie de la musique. Je sortais de l’école, j’avais des conceptions académiques sur la composition. Beaucoup de son répertoire se résumait à des lambeaux, à de fichus lambeaux pas vraiment reliés entre eux. Et ça a fini par me décourager (7). ». Jimmy Knepper reconnaissait que sa carrière était - qu’il le veuille ou non, - indissolublement liée à celle de Mingus. Il n’en fut pas moins le plus sévère : « Tout un chacun pense que Mingus était un génie mais pas moi. Beaucoup de ses trucs sont devenus de la musique par accident, enfin presque.. Il avait un espèce de don pour prendre des bouts de ci et des bouts de ça, les coller ensemble de force et arriver à en sortir quelque chose. De toute manière il n’a jamais écrit quoi que ce soit. Il nous chantait ses trucs, les jouait encore et encore et je n’avais plus qu’à les transcrire. Aucune précision ou notation ou n’importe quoi d’autre (8). » Au milieu des colères, des provocations, des déclarations à l’emporte-pièce, n’hésitant pas à humilier publiquement des musiciens qu’il considérait plus ou moins consciemment comme des extensions de lui-même, Mingus, contre toute logique, édifia dans la plus complète désorganisation une œuvre sans égale.
Mingus allait entraîner dans un « Jazz Tone Poem » que lui avait inspiré la découverte au Kenya de ce qui fut considéré alors comme le plus ancien fossile humanoïde, J. R. Monterose, un ténor aussi inclassable que valeureux, Jackie McLean, à vingt-quatre ans l’un des disciples les plus prometteurs de Parker, Mal Waldron au piano et Willie Jones à la batterie.
En un peu plus de dix minutes, Pithecanthropus Erectus entendait évoquer l’histoire de l’homo sapiens divisée en quatre mouvements, évolution, complexe de supériorité, déclin, destruction. À chaque interprète était fourni un point de départ constitué de brèves phrases à partir desquelles il devait improviser le plus librement possible, en fonction de ses réactions propres vis-à-vis des situations proposées. Décrivant la disparition de l’espèce humaine, le final préludait aux manifestations les plus extrémistes du free jazz à venir, à la différence que Mingus n’éliminait jamais les structures.
Pour prometteuse qu’ait semblé être cette édition du « Jazz Workshop », elle ne dura guère : Jackie McLean en vint aux mains avec Mingus et J.R. Monterose rejoignit les Jazz Prophets de Kenny Dorham. La suivante vit l’arrivée de Charles Daniel Richmond, ex-saxophoniste de R’N’B’, qui restera pratiquement dix-sept ans sous la férule de son Pygmalion dont il devint l’alter ego. «Je travaillais dans un club et le batteur que j’avais alors, Willie Jones, n’arrivait pas à assurer les tempos rapides. Entre deux sets, Lou Donaldson vint me dire qu’il y avait dehors un batteur qui pouvait jouer n’importe quoi. C’était Dannie Richmond. Je lui ai demandé de venir pour le prochain set et c’est ainsi que les choses ont commencé (9). »
Mingus ne manquait pas de flair dans le choix de ses musiciens. Il s’attacha ainsi les services de Curtis Porter, alias Shafi Hadi - il passait avec aisance du ténor à l’alto – à propos duquel Laurent Goddet parlait d’un « phrasé quasiment félin et de son extraordinaire façon de vocaliser ». Mingus avait une haute idée des capacités de sa nouvelle recrue. « J’estime que Jimmy Knepper est probablement le plus grand tromboniste qui ait vécu. Il est très sous-estimé. Je sais ce qu’il est capable de faire» dit-il de lui en 1975 (10). Ce qui ne l’empêcha pas de le malmener plus qu’aucun autre membre de ses orchestres.
Mingus avait décidé d’enregistrer Tonight at Noon, créé au Festival de Newport 1956. L’occasion pour lui de libérer un véritable pandémonium sonore qui indisposa tellement les responsables d’Atlantic qu’ils s’accordèrent quelques années de réflexion avant de publier ce qui annonçait les orages jazzistiques à venir.
Inclus dans l’album « The Clown », Haitian Fight Song n’avait rien à lui envier sur le plan de la violence. Mingus en explicita les tenants et aboutissants dans les notes de pochette : « Haitian Fight Song aurait pu aussi bien s’intituler Afro-American Fight Song. Il se situe dans la ligne de ces chansons folkloriques que j’ai entendues un peu partout. Dedans s’y retrouve aussi un peu du feeling des cérémonies religieuses du temps passé […] Mon solo y est profondément pensé. Je ne peux bien le jouer que si je n’ai pas à l’esprit les préjugés, la haine, les persécutions et combien tout cela est injuste. Il y a en lui de la tristesse et des pleurs mais aussi de la résolution. Et d’ordinaire, lorsque j’ai fini, je me dis : Je l’ai raconté ! J’espère que quelqu’un m’aura entendu. »
Alors sous contrat avec Debut, Thad Jones avait enregistré pour le compte de RCA-Victor. À titre de dédommagement, Celia Mingus négocia alors pour son époux une séance d’enregistrement, la première qu’il assurerait pour une « major company ». Il en résulta « Tijuana Moods », « le meilleur disque que j’ai jamais fait » selon son auteur. Un avis qui n’impressionna guère les têtes pensantes de la firme : elles laissèrent passer un certain temps avant de le publier.
Attiré depuis toujours par le Mexique et sa musique, à la fin de 1956 Mingus avait entraîné Dannie Richmond dans une virée épique à Tia Juana. Échos des orchestres de mariachis, rythmes fugitifs de paso-dobles, bribes du piano entendu dans les boîtes de strip-tease, autant de réminiscences sonores qui parsèmeront Tijuana Table Dance, rebaptisé sur disque Ysabel’s Table Dance en l’honneur d’Ysabel Morel qui y joue des castagnettes.
Pour l’occasion, Mingus avait appelé en renfort l’un de ces musiciens qu’il avait le don de découvrir, le trompettiste Clarence Shaw ; Frankie Dunlop officiait aux percussions alors que s’était assis devant le clavier Bill Triglia, membre à part entière du jazz underground new-yorkais qui gravitait autour de Tony Fruscella ; on ne le reverra pas dans le Workshop. Pour plus d’une raison, Mingus n’arrivait pas à s’attacher un pianiste de façon régulière…
Au Brandeis Creative Artists Festival organisé au mois de juin 1957 dans l’université du même nom, Jimmy Giuffre avait présenté Suspensions, Charles Mingus Revelations et George Russell All About Rosie qui avait donné l’occasion à Bill Evans de faire un malheur. Mingus ne l’oublia pas. Aussi, un jour en rentrant chez lui à quatre heures du matin, Bill Evans trouva-t-il un télégramme ainsi rédigé : « Pourriez-vous venir participer à une séance d’enregistrement de Charlie Mingus, ce matin à 10 heures ? »
Les mondes des deux musiciens semblaient n’avoir que peu de choses en commun, ce qui n’empêcha pas Bill Evans de se sentir parfaitement à l’aise chez Mingus. Fidèle à sa conception du solo au sein d’une formation, son chorus de West Coast Ghost prolonge les intentions des souffleurs, venant s’enchâsser dans l’interprétation sans y générer le moindre hiatus.
Comme son titre l’indiquait, West Coast Ghost entendait exorciser le passé de Mingus ; il s’employa à évoquer New York, sa ville d’adoption, dans Scenes in the City. Une pièce qui entendait peindre les rapports liant un harlémite au jazz dans un environnement hostile. Grande figure de la défunte « Harlem Renaissance », Langston Hughes, en compagnie duquel Mingus gravera l’année suivante l’album « Weary Blues », avait donné un coup de main à Lonnie Elders lors de la composition de son poème. Melvin Stewart, un acteur qui, à plusieurs reprises, s’était produit sur scène en compagnie de Mingus, en était le récitant. Un solo ingénieux de Clarence Shaw, le dialogue entretenu entre Jimmie Knepper et Shafi Hadi, de fréquentes et inattendues variations de tempo contribuaient à faire de Scenes in the City une pièce quelque peu déstabilisante. Dans Down Beat, le chroniqueur ne la jugea que peu convaincante, n’accordant que deux étoiles et demi à l’album « A Modern Jazz Symposium of Music and Poetry ». Une raison supplémentaire pour que Mingus continue à vouer la critique aux gémonies.
Acteur new-yorkais, animateur d’un atelier d’interprétation, John Cassavetes avait décidé de réaliser sur place un film - son premier – qui n’aurait aucun rapport avec ceux que produisait Hollywood. Pour un coût de 40 000 $, tourné à la sauvette en 16mm, Shadows fut bouclé en quatre mois au cours de l’année 1957. En grande partie improvisé par ses interprètes, il traitait, entre autres, du racisme. Un sujet cher à Mingus, aussi Cassavetes lui avait commandé une musique originale. Qu’en fut-il exactement ? Insatisfait de la première version, Cassavetes en tourna une seconde qui lui valut en 1960 le Prix de la Critique à la Mostra de Venise. Bien peu de musique signée Mingus y figurait ; on y entendait par contre un solo a capella gravé pour l’occasion par Shadi Hafi, ce qui lui valut de se voir expulsé de l’atelier Mingus.
La cause semblait entendue lorsque, en 2004, la version originale de Shadows, considérée comme définitivement perdue, fut retrouvée par un professeur de l’Université de Boston, Raymond Carrey. Contient-elle plus de musique signée Mingus ? Impossible de le savoir, les ayant droit du réalisateur disparu en 1989 s’opposant à toute diffusion publique…
Inspiré par la vie nocturne de l’un des quartiers les plus animés de Manhattan, Nostalgia in Times Square était, à l’origine, l’un des thèmes composés pour le film de Cassavetes. La présente version fut interprétée au cours d’un concert donné à la Nonagon Art Gallery par une nouvelle édition du « Jazz Workshop ». Remplaçant Shadi Hafi au ténor, Booker Ervin saura insuffler à la musique de Mingus une intensité contrôlée inédite. John Handy occupait maintenant le poste de saxophoniste alto. Mingus l’avait recruté au Five Spot au cours d’une soirée surréaliste où, après l’avoir entendu brièvement faire le bœuf, il avait imposé sa présence à l’orchestre régulier, hurlant à chacun de ses chorus « Bird est de retour ! Bird est de retour ! » À la grande confusion de John Handy…
Remarquable improvisateur à l’imagination généreuse, il s’en donne à cœur joie au cours de Nostalgia in Times Square. Qu’est-ce qui poussa Mingus à entamer son solo par une citation d’Ol’ Man River avant de passer à... Dixie au cours de son dialogue avec Dannie Richmond ? Mystère.
Sans rien perdre en intensité par rapport aux œuvres antérieures, Nostalgia in Times Square témoignait d’un certain travail de décantation. Était-ce dû à la présence de John Handy et de Booker Ervin, superlatifs musiciens entendant bien rester maîtres de leurs discours ? Sans doute. Plus incertaine serait l’hypothèse qui s’appuierait sur le fait que Mingus, aux prises avec une existence tumultueuse, se soit volontairement rendu à la fin de 1958 au service psychiatrique du Bellevue Hospital. Les prétextes invoqués par la suite - tout comme les thérapies suivies - furent aussi nombreux que variés et aussi peu plausibles les uns que les autres. Toutefois, grâce à Nat Hentoff, il rencontra alors un psychologue, le docteur Edmund Pollock, qu’il fréquentera ponctuellement, lui demandant même de rédiger la préface de son album « The Black Saint and the Sinner Lady ».
Nesuhi Ertegun, responsable du secteur jazz chez Atlantic, suggéra à Mingus de concevoir un album qui se situerait dans le droit fil de Haitian Fight Song. Une manière de répondre à ceux qui, comme LeRoi Jones, le considéraient comme un expérimentateur contaminé par la musique européenne – ce qui n’était pas totalement injustifié – donc (et de ce fait) incapable de swinguer – une allégation parfaitement fausse. La réponse fut mise en boîte au mois de février 1959 sous la forme de « Blues & Roots ». Pour ce faire, Mingus avait réuni un nonette dans lequel Jackie McLean rentré en grâce, Jimmy Knepper, Willie Dennis et Pepper Adams renforçaient son quintette ; tous débordant d’énergie dans Moanin’ – un thème sans rapport aucun avec le cheval de bataille des Messengers signé Bobby Timmons - où chaque souffleur interprète une ligne mélodique différente basée sur le blues.
Autre justification du programme annoncé par le titre de l’album, My Jelly Roll Soul qui traduisait les impressions ressenties par Mingus en écoutant la musique de Ferdinand La Mothe alias Jelly Roll Morton. Un personnage comme lui haut en couleurs et, à ses yeux aussi incompris et sous-estimé qu’il jugeait l’être. Jimmy Knepper, Horace Parlan, Jackie McLean, Dannie Richmond et Mingus se succèdent au long de cette seconde mouture d’un thème dont la version originale, Jelly Roll Jellies, interprétée à la Nonagon Art Gallery, reste inédite.
Trois mois plus tard, Mingus récidiva en studio grâce à… Jelly Roll, gravé cette fois pour le compte de la Columbia à laquelle le liait un contrat portant sur l’enregistrement d’un double 33t consacré aux compositions de Jelly Roll Morton. Ayant changé d’avis, Mingus s’attela à la préparation d’un premier LP de remplacement. Ayant plus ou moins rangé son ténor, Teo Macero qui exerçait maintenant des responsabilités éditoriales chez Columbia, en serait le producteur.
« Mingus Ah Hum », sans doute le plus bel album que son auteur ait signé à l’époque, fait étalage, pour le meilleur, de l’éventail complet de ses univers et de ses obsessions. Il offre également le plus fidèle reflet de ce que Mingus entendait présenter sur un disque. Gene Santoro rapporte que, une fois l’enregistrement terminé, il s’était emparé des bandes pour remonter les interprétations à son idée, élaguant et déplaçant les solos. L’écoute d’un album ne relevant pas de l’éphémère contrairement à celle d’un concert, il était parfaitement conscient que ses méthodes en studio pouvaient déboucher sur des incompréhensions et des contresens. Jimmy Knepper raconta ainsi que, les membres de l’orchestre n’ayant jamais de partitions, John Handy ne connaissait pas les accords de Goodbye Pork Pie Hat.
Mingus fut-il responsable des coupes pratiquées dans certaines interprétations afin que neuf de ses compositions trouvent place sur un seul disque? Bien malin qui pourrait le dire, les déclarations d’un Mingus perpétuellement en colère n’étant pas d’une grande fiabilité. Si ce fut Teo Macero qui se chargea du travail, il procéda avec autant intelligence qu’il en témoignait avec Miles Davis.
Laissé intact, Better Git in Your Soul se référait une nouvelle fois aux cérémonies religieuses auxquelles assista Mingus enfant. Interjections, claquements de mains ponctuent une interprétation dans laquelle Booker Ervin endosse le rôle du prédicateur. Parmi les morceaux en 6/8 inspirés par les offices de l’Holiness Church, Better Git It In Your Soul fut le seul à rencontrer un vif succès. Souvent repris par son auteur, il fut interprété aussi bien par Woody Herman et Pepper Adams que par Chet Baker. Par contre, ulcéré que leur soit attribuée la paternité de ce «Soul Jazz » qu’il estimait à juste titre avoir porté sur les fonts baptismaux, Mingus refusa aux frères Adderley le droit de l’enregistrer.
Dépourvu également de la moindre coupure, Self-Portrait in Three Colors, une pièce courte dont le titre faisait écho à la première phrase de « Moins qu’un chien » : « En d’autres termes, il y a trois hommes en moi. » Exceptionnelle dans l’œuvre de Mingus par la (relative) sérénité qui s’en dégage, elle se composait d’une suite d’unissons qui ne laissaient aucune place aux solos.
Dernier hommage rendu à Lester Young, Goodbye Pork Pie Hat découlait du blues lent né spontanément, deux mois plus tôt sur la scène du Half Note, à l’annonce de la disparition du Pres. Un chef-d’œuvre. Andrew Homzy : « Comme Duke Ellington, Mingus était capable de composer sur la structure du blues avec tellement de force, de beauté et de complexité que l’auditeur ne se rend pas compte de la modestie des origines de la musique. »
La version publiée du vivant de Mingus perdait 58 secondes par rapport à celle – intégrale - éditée en 1979 : le remarquable solo de ténor dû à John Handy restait bien sûr intact, les coupes touchant les ensembles au moment de l’exposition et de la ré-exposition du thème.
Entre les deux variantes de Bird Calls, trois minutes tombèrent aux oubliettes. Dans l’édition princeps disparut une partie des interventions de Booker Ervin, Horace Parlan et Shafi Hadi (le plus durement touché) ainsi que le solo de Dannie Richmond. L’écouter à la suite de la version « in unedited form » donne l’impression de découvrir une prise alternée à laquelle les réductions insufflent encore plus de force. En dehors de ces problèmes d’intendance, Bird Calls donne quelque peu matière à réflexion. Mingus jurait ses grands dieux que ce thème n’avait rien à voir avec Charlie Parker et que son titre relevait du pur hasard. On voudrait bien le croire, cependant si la coda évoque Le Réveil des oiseaux d’Olivier Messiaen, pourquoi Bird Calls débute-t-il par une phrase de Reincarnation of a Lovebird ouvertement dédié à Parker ? Alors que l’œuvre de Mingus regorge de citations identifiables d’emblée, Bird Calls, tout comme Reincarnation of a Lovebird ou Gunslinging Bird, ne contient aucune référence directe à la musique de Charlie Parker. Seul écho, celui que renvoient les solos des divers saxophonistes alto du « workshop ». En vérité, le rejet de toute allusion franche résultait du niveau auquel Mingus entendait placer ses rapports musicaux avec Bird.
« Je me suis penché sur la veine créative de Parker avec la même passion et le même désir de compréhension que je mettais en étudiant les partitions de mes compositeurs classiques favoris car je décelais dans sa musique une intégrité que, jusqu’à maintenant, je n’avais trouvée que dans la musique classique. Ce fut grâce à Bird que j’ai pris conscience que, dans le jazz, l’improvisation - tout comme la composition - pouvait égaler la musique classique à la condition que son auteur soit un créateur. Bird a conduit le développement mélodique jusqu’à un niveau inédit dans le jazz ; aussi loin que Bartok ou Schoenberg ou Hindemith l’avait conduit dans le classique. Mais aussi il a transmis à sa musique un pouvoir d’attraction naturel, magique, dépassant l’intelligence que j’ai seulement trouvé dans les derniers quatuors de Beethoven et plus encore chez Stravinsky. »
À ces lignes accompagnant la présentation de Gunslinging Bird, il faudrait associer la réponse que Mingus fit à une question concernant son disque de Parker préféré: « Je les aime tous, pas un plus que l’autre mais si je devais en citer un ce serait Lover Man pour l’émotion qu’il contient et son habileté à transcrire cette dite émotion (11). » « Transcrire une émotion », le moteur même de la musique de Mingus. Un domaine dans lequel, au-delà de la lettre et de l’esprit, il s’était choisi Parker comme directeur de conscience. Entre eux, toute correspondance au premier degré était superfétatoire. À la différence de ce qui se passait avec Duke Ellington, son autre idole.
Charles Mingus n’hésitera ni à transposer son mode d’expression ni à s’attaquer de front à ses compositions, témoin Do Nothin’ Till You Hear From Me dont il servit une magnifique version. Un arrangement d’une grande subtilité qui, à la façon du Tea for Two de 1954, insérait I Let a Song Out of My Heart dans la mélodie de ce qui avait été le Concerto for Cootie ; le travail d’Eric Dolphy au poste de premier alto – un rôle dans lequel on aura peu l’occasion de le rencontrer - ; les solos de trois ténors, successivement Yusef Lateef, Joe Farrell et Booker Ervin ; le jeu impérial de Mingus exceptionnellement mis en valeur par la prise de son… Autant d’atouts à l’actif de Do Nothin’ Till You Hear From Me.
Gunslinging Bird évoqué plus haut et Song with Orange qui donnait à Jimmy Knepper et à un nouveau trompettiste, Richard Williams, l’occasion de briller, figuraient dans « Mingus Dynasty ». Le second album gravé pour Columbia dont la pochette s’ornait d’une photo de Mingus vêtu en empereur chinois posant devant l’un de ces dragons imaginaires chers à l’Empire du Milieu. Une image incongrue pour quelqu’un qui, au contraire de Monk, n’était guère porté sur ce style de mise en scène. En fait un tel déguisement agréait à Mingus car il faisait référence à l’un des surnoms qui lui avaient été attribués durant son adolescence, « Ming », et mettait l’accent sur le quart de sang chinois dont il se prévalait.
À l’instar de « Mingus Ah Hum », « Mingus Dynasty » contenait dans sa version originale neuf morceaux. À même cause, mêmes effets, quatre morceaux dont Gunslinging Bird dont le titre intégral était If Charlie Parker Were a Gunslinger There’d Be a Whole Lot of Dead Copycats et Song with Orange, existent en deux moutures. Leur écoute successive montre que les versions intégrales, certes indispensables, ne sont pas forcément les plus efficaces. Il est donc regrettable qu’aucune édition ne les confrontent entre elles.
Pour une question de gros sous, Mingus s’était brouillé avec la Columbia. Do Nothin’ Till You Hear from Me avait été gravé pour le compte de Mercury, tout comme Bemoanable Lady exécuté par une formation de vingt-cinq musiciens. Un second témoignage évident de l’emprise qu’exerçait Ellington sur Mingus. Dans un contexte ramenant à la mémoire les interventions de Johnny Hodges chez le Duke, s’y fait entendre un solo d’alto ; libre sans être libertaire, d’une approche en complète empathie avec un univers plus fermé qu’il ne semble de prime abord. Il était signé Eric Dolphy.
Ted Curson : « Un soir, à minuit, son manager m’appela pour me dire que c’était O.K. , je commençais tout de suite ; il suffisait que je prenne mon instrument. En chemin, j’ai rencontré Eric Dolphy qui, lui aussi, transportait le sien. Quand Mingus nous a vu arriver, il a congédié sur le champ ceux qui étaient sur l’estrade. Voilà comment ça a débuté ; au milieu de la nuit à The Showplace. Nous ne connaissions rien du répertoire, cependant nous nous y sommes mis (12). » John Handy et Jimmy Knepper reçurent leurs lettres de licenciement argumentées avec une parfaite mauvaise foi… Travailler avec Mingus n’avait jamais été une sinécure.
Supporter de la première heure de Mingus et profondément impliqué dans les luttes pour les droits civiques, Nat Hentoff occupait les fonctions de directeur artistique d’une compagnie de disques nouvellement créé, Candid Records. Il n’était donc pas homme à censurer Fables of Faubus ainsi que Columbia l’avait fait en privant de son texte cette diatribe née d’un fait-divers passé dans l’histoire.
En dépit d’une décision de la Cour Suprême déclarant illégale toute ségrégation scolaire, le gouverneur de l’Arkansas, Orvell Eugene Faubus, s’était opposé en 1957 à l’entrée de neuf enfants afro-américains au lycée de Little Rock en ayant même recours à la garde nationale. Dwight Eisenhower, alors président des Etats-Unis, fut contraint d’envoyer mille hommes de la fameuse 101ème Division aéroportée pour faire respecter la loi.
Immédiatement Louis Armstrong avait réagi à chaud avec une rare virulence, interpellant Eisenhower et traitant Faubus de « bouseux mal éduqué ». Bien qu’il semble que Fables of Faubus ait pris naissance durant l’automne 1957, l’indignation de Mingus sera rendue publique avec un certain retard. Dannie Richmond : « À l’origine, le morceau ne possédait pas de titre… Nous étions en train de le jouer un soir et les paroles « Tell me someone who’s ridiculous » (Cite moi quelqu’un de ridicule) vinrent se greffer naturellement sur la mélodie originale et c’est par hasard que j’ai répondu « Governor Faubus ». À cette période, lorsque Mingus et moi inventions sur scène quelque chose de musicalement important, nous le conservions (13). » Pour faire bonne mesure les noms d’Eisenhower et de Nelson Aldrich Rockfeller, alors gouverneur de New York, rejoindront bientôt celui du gouverneur de l’Arkansas dans Original Fables of Faubus.
Alors que Mingus n’avait pas attendu Little Rock pour exprimer violemment sa détestation de l’Amérique blanche, Fables of Faubus, sans doute sa composition la plus connue, lui valut une solide réputation d’activiste. Ce fut aussi celle qu’il interpréta le plus souvent. « Je joue encore Fables of Faubus, dira-t-il en 1973, surtout parce que c’est une de mes compositions où je m’impose le moins aux gars qui jouent. » La raison sans doute pour, qu’au fil des ans, sa durée dépasse souvent la demi-heure.
La version gravée en quartette au Nola Penthouse Sound Studio de New York durant le mois d’octobre 1960 reste la plus prenante de toutes, grâce aux solos de Dolphy, de Ted Curson et de Mingus lui-même ; la plus intense aussi car en moins de dix minutes, tout est dit. Un rappel de ce que Mingus écrivait de façon prémonitoire dans une lettre ouverte à Miles Davis publiée dans Down Beat en 1956 : « La musique est – ou a été – le langage des émotions. Si quelqu’un se détache de la réalité, je ne m’attends pas à ce qu’il apprécie ma musique. Si par hasard cela survenait, je commencerais à m’inquiéter sur ce que je compose … Ma musique est vivante, elle parle de la vie et de la mort, du bien et du mal. Elle est colère. Elle est réelle parce qu’elle sait être colère. »
Alain Tercinet
© 2013 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux & Associés.
(1) Nat Hentoff, « Jazz Is », Avon Books, NYC, 1978.
(2) Buddy Collette with Steven Isoardi, « Jazz Generations – A Life in American Music and Society » , Continuum Londres & New York, 2000.
(3) (4) Nat Hentoff, « The Jazz Life », A Panther Book, Londres, 1962.
(5) Jacques Réda, « Autobiographie du Jazz », Editions Climats, 2002.
(6) Jean Wagner « Le gros ours en colère », Jazz Magazine n° 94, mai 1963.
(7) Gene Santoro, « Myself When I Am Real - The Life and Music of Charles Mingus », Oxford University Press, 2000.
(8) Lee Jeske, « Jimmy Knepper : A Rare Bird », Down Beat, août 1981.
(9) (10) comme (4)
(11) Ira Gitler, « Jazz Masters of the Forties, McMillan, 1966.
(12) Bret Primack, « The Gospel According to Mingus : Disciples carry the tune», Down Beat, 7 décembre 1978.
(13) Brian Priestley, « Mingus – a critical biography » , Da Capo Press, 1983.
CANNONBALL ADDERLEY – RANDOM TRACKNOTES
On September 20th 1951 the Miles Davis All Stars made their debuts, playing at Birdland; on bass was a newcomer with whom Miles used to hang around in California a few years earlier, Charles Mingus. Mingus had just left the group where he’d been playing for over a year, the trio led by vibraphone-player Red Norvo. There had been a regrettable incident: Red had been contacted by Mel Tormé with an invitation to appear on a TV show, but representatives from the New York chapter of the Musicians’ Union had noticed that Mingus, coming from California, hadn’t signed up with Local 802 in New York... Norvo was given a choice: change his bassist or forget the TV show. Clyde Lombardi stepped in for Mingus. It was an “incident”, yes, but for Mingus it took on the proportions of a national emergency, and he resigned (noisily). At the age of thirty, having just decided to live in New York, Mingus could only write off everything he’d previously accomplished: the Big Apple didn’t attach the slightest importance to what happened anywhere beyond the Hudson River, and Charles Mingus Jr. (born in Nogales, Arizona, on April 22nd 1922) had begun his career much further away than that... in Los Angeles.
“A lot of my music came from church. All the music I heard when I was a very young child was church music. I was eight or nine years old before I heard an Ellington record on the radio. My father went to the Methodist church; my stepmother would take me to a Holiness church. My father didn’t dig my mother going there. People went into trances and the congregation’s response was wilder and more uninhibited than in the Methodist church. The blues was in the Holiness churches – moaning and riffs and that sort of thing between the audience and the preacher.” (1). Mingus would remember that for the rest of his life. After a vain attempt at taming the trombone – it gave him the opportunity to strike up a friendship with Britt Woodman – Mingus began studying the cello when he was ten. Two years later he was playing in the orchestra at Jordan High School alongside Buddy Collette, who offered him a deal the following year: “OK, you have a cello and I have a band. I’m thinking about adding a bass player. If you want to forget the cello and find a bass, the job’s yours.” (2)
First with Red Callender as his advisor, and then with Hermann Rheinschagen as his teacher – he was a former member of the New York Philharmonic –, Mingus learned how to tame the double bass while also studying piano and composition. “I tried to hear all the bands that came to town. When I first heard Duke Ellington in person, I almost jumped out of the balcony. One piece excited me so much that I screamed. I also listened to Art Tatum a lot, and later, I tried to sit in with him, but he’d laugh at me.” (3)
Mingus began a professional career in 1940, working in the band led by drummer Lee Young, Lester’s brother, and also in Alvino Rey’s big band. He was hired three years later by Louis Armstrong, and he resigned when he learned that the band’s tour was heading for the Deep South. In parallel with a long series of engagements in various establishments, he began recording some of his own compositions, taking advantage of the situation to style himself as “The Baron”.
Lionel Hampton arrived in California towards the end of 1947 and wanted to hire another bassist. Britt Woodman was in his band at the time, and he played a Mingus record for Gladys Hampton and drummer Curley Hamner. The way Mingus remembers the story is outlined in his fantasized autobiography “Beneath the Underdog” (in which Mingus often refers to himself in the third person): “... out at the studio in Culver City... Hamp dug the sound and rolled his vibes over and began to blow with [bassist Cholly Harris] and my boy. Charles realized that Joe [Comfort] had set him up for what amounted to an audition, since he was giving his notice. The minute they finished, Hamp said, ‘Look here, gates, you want to play in my band?’ Joe Comfort had tilted him right into the spot. Mingus went home and scored ‘Mingus Fingers’ for big band and twelve other tunes as well. Hamp used ‘Fingers’ at every performance after that, and to my boy’s surprise, at his first recording session with the band for Decca, Hamp called the tune. It was his first original composition and arrangement recorded by a major band.”
Cutting against the grain of Hampton’s usual repertoire, Mingus Fingers shows how far the composer had already come as an instrumental genius; it evidences the exceptional gifts of an arranger capable of grabbing an orchestra with both hands, and then not only not letting go, but defying excess. His stay with Hampton lasted less than a year, and was followed by a lean period in which he claimed (in another fantasized chapter of his book) to have subsisted by becoming a pimp. As a matter of fact, when Rod Norvo went looking for him he found him working at the post office, like his father.
After a difficult start in New York while waiting for his indispensable cabaret card, Mingus lost no time: he joined Charlie Parker and Bud Powell in Toronto for a historic concert at Massey Hall with Dizzy Gillespie, and hung around with Lennie Tristano’s disciples. Almost immediately after joining Duke Ellington, Mingus somehow succeeded in getting fired after a rumble with Juan Tizol, Duke’s feisty, ill-tempered trombonist, and then set up a record company called Debut with Max Roach. He now had his own label, but it didn’t keep him from infidelity: on October 31st 1954 he made a record for Savoy with his own sextet (as “The Jazz Composers Workshop”) which has this astonishing version of Tea for Two combining fragments of Perdido, Body and Soul and Prisoner of Love, all of them compositions based on the same harmonic framework as the original Tea for Two by Vincent Youmans. As a musical patchwork this is perfection, a kind of heir to Lennie Tristano’s experiments, with an ensemble-sound reminiscent of what people were listening to on the West Coast at the time...
“I try to express what I really am. The reason why it’s so difficult is because I change all the time.” (4) The tune Pithecanthropus Erectus marks the moment when Mingus’ work began resembling “a long musical riot. It has [a riot’s] angry outbursts, lulls, brutal reprises, and the spontaneity that overflows from revolutionary plans,” as Jacques Réda put it. (5) Jean Wagner described its modus operandi: “With the utmost simplification it’s possible to conceive the orchestral writing of Mingus as a collective cry given by a group of musicians in a direction which is essentially individual. The conductor is the one who conceives and excites: he gives his soloists a precise foundation which is his alone; next, he distributes a few stimulants and doesn’t rest until his sidemen have extended themselves to the limit. The result is an essentially baroque aesthetic universe in which sincerity and authenticity succeed in covering any artifice which the enterprise had at the outset. Just as much as the greatest, Charlie Mingus uses his orchestra like an instrument.” (6)
The modus operandi was identical to the one adopted by Ellington, with one exception: Mingus showed the greatest defiance of written scores which, in his eyes, bridled the natural creativity of those playing his works; paradoxically, it was that same creativeness which he intended to orientate according to his mood. Most of the time – paranoia oblige – his intentions caused conflict. As John Handy said, “You could never relax with Charles. There was always unnecessary tension, unnecessary intimidation. If he didn’t like something you did, he’d threaten to call somebody else right in front of you. Worst of all was a lot of the music. I was right out of school, more academic about composition, but a lot of his stuff was raggedy, not really put together. And that turned me off.” (7) Jimmy Knepper admitted that his career – like it or not – was inseparably linked with Mingus; even so, he was at least his most severe critic: “Everyone thinks Mingus was a genius, but not me. A lot of his stuff became music by accident, well, almost... He had a kind of gift for picking up bits here and there, and then sticking them together by force to finally get something out of it. Anyway, he never wrote anything at all. He sang his things for us, played them again and again, and all I had to do was transcribe them. No clarification or notation or anything like that.” (8) In the midst of all the anger, provocation and cut-and-dried declarations, and not hesitating to publicly humiliate musicians he considered more or less consciously as extensions of himself, Mingus, against all logic, structured an unequalled opus out of complete disorganization.
The discovery in Kenya of what was then considered to be the oldest hominid fossil in civilization provided Mingus with the inspiration for a “Jazz Tone Poem” into which he drew J. R. Monterose, a tenor saxophonist as brave as he was difficult to categorize; alto Jackie McLean, at twenty-four one of Parker’s most promising disciples; pianist Mal Waldron; and drummer Willie Jones. In a little over ten minutes, Pithecanthropus Erectus aimed to evoke the history of Homo sapiens divided into four movements: evolution, superiority complex, decline, destruction. Each musician received a few brief phrases to start with, on which basis he was then supposed to improvise as freely as possible according to his own reactions to the situations proposed. In describing the disappearance of the human race, the finale serves as a warm-up for the most extreme manifestations of the free jazz that was around the corner, albeit with the proviso that Mingus never completely eliminated structures.
As prestigious as this edition of the Jazz Workshop might seem, it lasted hardly longer than the time it takes to say it: Jackie McLean and Mingus engaged in fisticuffs and J.R. Monterose joined Kenny Dorham’s Jazz Prophets. The next edition of the band saw the arrival of Charles Daniel Richmond, a former R&B saxophonist who would remain governed by his new Pygmalion for practically seventeen years, becoming his alter ego. “I was working in a club and the drummer I had then, Willie Jones, couldn’t play quick tempos. In between sets, Lou Donaldson came over to tell me there was a drummer outside who could play anything. It was Dannie Richmond. I asked him to come in for the second set and that’s how the thing started. (9)
Mingus never showed a lack of flair when he chose a musician, and that’s how he enrolled Curtis Porter, alias Shafi Hadi – he moved from tenor to alto with ease – a musician whose phrasing was “quasi-feline” according to Laurent Goddet, together with “an extraordinary way of vocalising.” Mingus had a high opinion of the abilities of his new recruit. As for what he thought of his trombonist, “I would say that Jimmy Knepper is probably the greatest trombonist who ever lived. He’s much underestimated. I know what he’s capable of doing,” said the master in 1975. (10) Not that it stopped him treating Knepper as badly as he did the other members of his bands.
Tonight at Noon was created at the 1956 Newport Festival and Mingus decided to record it; it was a chance for him to deliver sound pandemonium at levels which indisposed the bosses of Atlantic Records to the point where they allowed themselves a few years’ reflexion before they finally decided to release this tune which heralded the jazz storms to come.
Included in the album “The Clown”, Haitian Fight Song didn’t have anything to fear from Tonight at Noon from a strictly “violent” point of view. Mingus provided an explanation of its whys and wherefores in the sleeve-notes, saying the song could just as easily have been called “Afro American Fight Song”: “‘Haitian Fight Song’ has a folk spirit, the kind of folk music I’ve always heard anyway. [...] My solo in it is a deeply concentrated one. I can’t play it right unless I’m thinking about prejudice and persecution, and how unfair it is. There’s sadness and cries in it, but also determination. And it usually ends with my feeling, ‘I told them! I hope somebody heard me!’”
Thad Jones had made a record for RCA-Victor while under contract to Debut; as compensation, Celia Mingus negotiated a recording-session for her husband that was to be his first for a ‘major’ company. The result was “Tijuana Moods”, “the best record I ever made” according to Mingus. His opinion didn’t impress the label’s gurus: some time went by before they released it. Mingus had always been drawn by Mexico and its music, and towards the end of 1956 he took Dannie Richmond to Tia Juana on an epic spree... The echoes of mariachi orchestras, fugitive paso doble rhythms and hints of strip-joint-piano are as many references scattered throughout Tijuana Table Dance, rechristened Ysabel’s Table Dance in honour of Ysabel Morel, who plays castanets here. Mingus had called in reinforcements for the occasion: trumpeter Clarence Shaw; Frankie Dunlop on percussion; and pianist Bill Triglia, a member in his own right of the NY jazz underground which gravitated around Tony Fruscella. He wasn’t seen in the Workshop again; for more than one reason, Mingus just couldn’t hold on to a pianist for any length of time...
At the Creative Artists Festival held in June 1957 at Brandeis University, Jimmy Giuffre had presented Suspensions; Charles Mingus gave them Revelations, and George Russell All About Rosie, which gave Bill Evans the opportunity to bring the house down. Mingus didn’t forget, and so when Bill Evans got home at four in the morning he found this telegram waiting for him: “Can you come and do a Charlie Mingus session this morning at ten?” On the surface, the worlds of the two musicians had little in common, but that didn’t stop Bill Evans feeling right at home with Mingus. Faithful to his concept of the solo in a group-context, Bill’s chorus on West Coast Ghost extends the intentions of the horns, fitting exactly into the performance without causing the slightest hiatus. As you might guess from the title, West Coast Ghost was intended to exorcise Mingus’ past; as for Scenes in the City, Mingus here undertakes an evocation of his adoptive New York by aiming to paint a portrait of a Harlemite’s rapport with jazz in a hostile environment. Langston Hughes – he was a great figure of the “Harlem Renaissance”, and Mingus would cut the album “Weary Blues” in his company a year later – had given Lonnie Elders a hand when he was composing this poem; the narrator is Melvin Stewart, an actor who’d accompanied Mingus onstage on several occasions. With an ingenious solo from Clarence Shaw, a sustained dialogue between Jimmie Knepper and Shafi Hadi, not to mention frequent (and unexpected) variations in tempo, Scenes in the City is a rather destabilizing piece. Down Beat’s reviewer didn’t think it very convincing and only gave two and a half stars to the album “A Modern Jazz Symposium of Music and Poetry”. It gave Mingus all the more reason to continue holding critics up to public abuse.
The actor John Cassavetes – he also ran an (actors’) workshop – had chosen his hometown New York as the place where he’d shoot his first film, deciding that it would have nothing to do with the kind produced in Hollywood. With a budget of $40,000, shot on the sly in 16mm, Shadows went into the can in four months during 1957. Mostly improvised by its cast, one of its themes was racism. That struck a chord with Mingus, who found himself entrusted with the task of writing an original score for the film. What became of the film? Cassavetes wasn’t happy with the first version and did another one, which was presented at the Mostra Festival in Venice in 1960. It won the Critics’ Prize. Very little of Mingus’ music can be heard in it, although it does have a solo played a cappella by Shadi Hafi, which resulted in Mingus throwing him out of his workshop. A glimmer of hope appeared in 2004 when the original cut of Shadows, deemed irremediably lost, was discovered by Raymond Carrey, a Professor at Boston University. Does it have more of Mingus’ original music? Who knows? Cassavetes died in 1989 and his heirs are opposed to the film’s distribution. Inspired by the night-life haunting one of Manhattan’s busiest thoroughfares, Nostalgia in Times Square was originally one of the themes which Mingus composed for Cassavetes. This version was played at a concert at the Nonagon Art Gallery by a new edition of the Jazz Workshop. Replacing Shadi Hafi on tenor, Booker Ervin manages to give Mingus’ music a controlled intensity that hadn’t been heard before. John Handy is now the alto saxophonist, Mingus having recruited him at The Five Spot in the course of a surrealistic evening when, after hearing him briefly jam, Mingus demanded that he join his regular working-band, yelling “Bird’s back: Bird’s back!” after each and every chorus. John Handy was somewhat confused...
A remarkable improviser with a generous imagination, Handy lets himself go in Nostalgia in Times Square. As for what moved Mingus to commence his solo with a quote from Ol’ Man River before moving into Dixie (of all things!) in the course of his dialogue with Dannie Richmond... it remains a mystery. Losing none of its intensity with regard to earlier works, Nostalgia in Times Square shows that some decanting has been going on. Is it due to the presence of John Handy and Booker Ervin, both superlative musicians bent on remaining masters of conversation? No doubt. Less certain is the hypothesis which relies on the fact that Mingus, at odds with his tumultuous existence, voluntarily checked into the Bellevue psychiatric hospital at the end of 1958. The pretexts for this which were later put forward – and the various therapies administered – were as varied as they were numerous (and all of them just as implausible). Thanks to Nat Hentoff, however, Charles came into the hands of Dr. Edmund Pollock, an analyst with whom he had words now and then (even asking him to preface his album “The Black Saint and the Sinner Lady”: “There can be no question that [Mr. Mingus] is the Black Saint who suffers for his sins and those of mankind...”, said the shrink.
Nesuhi Ertegun, who ran the jazz division at Atlantic, suggested to Mingus that he should make an album in the same vein as Haitian Fight Song. It was by way of an answer to those who, like LeRoi Jones, considered Mingus an experimenter contaminated by European music – they weren’t entirely unjustified – and therefore someone incapable of swing. That allegation was totally untrue. The response was duly recorded in February 1959 as “Blues & Roots”. For his riposte, Mingus got together a nonet in which Jackie McLean (back in grace), Jimmy Knepper, Willie Dennis and Pepper Adams reinforced Mingus’ quintet. Their collective energies overflow in Moanin’ – the theme has nothing whatever in common with Bobby Timmons’ battle horse for the Messengers –, where each of the horns plays a different melody-line based on the blues. My Jelly Roll Soul is another justification of the programme announced by the “Blues & Roots” title, and it translates the impressions which Mingus felt on listening to the music of a certain Ferdinand La Menthe, alias Jelly Roll Morton. The latter was just as colourful a figure as Mingus, and the bassist thought Jelly Roll was also just as misunderstood and underestimated as he considered himself to be. Jimmy Knepper, Horace Parlan, Jackie McLean, Dannie Richmond and Mingus appear one after the other in the course of this second edition of a theme whose original version, Jelly Roll Jellies, performed at the Nonagon Art Gallery, remains unreleased to this day.
Three months later, Mingus went back into the studios thanks to... Jelly Roll, only this time he was recording for Columbia, with a contract to make a double album of Jelly Roll Morton’s compositions. Mingus changed his mind and buckled down to the task of preparing a first LP by way of a replacement for it. By now, Teo Macero had more or less stashed his tenor and was working for Columbia in an editorial capacity. He would be the album’s producer. “Mingus Ah Hum”, probably the most beautiful album the bassist made in this period, provided – and so much the better – a complete display of his universes and obsessions. Gene Santoro reports that once the recording was over, Mingus grabbed the tapes in order to splice and edit the performances the way he wanted them to appear, stripping out the solos and moving them around. Unlike listening to a concert, listening to an album has nothing ephemeral about it, and Mingus was perfectly aware that his studio-methods could lead to misinterpretation, if not incomprehension. Jimmy Knepper said that because the members of the band never had scores, John Handy didn’t know the chords for Goodbye Pork Pie Hat.
Was Mingus responsible for the cuts made in some takes so that nine of his compositions would fit onto one record? It would take a wise man indeed to sort the wheat from the chaff in the declarations made by Mingus, a man in a continual state of anger. If Teo Macero was the man who actually edited them, then he did so with the same intelligence he showed when he was recording Miles Davis.
Better Git in Your Soul was left intact, and it was yet another reference to the church ceremonies witnessed by Mingus as a child. Interjections and hand-claps punctuate a performance where Booker Ervin plays the role of the preacher. Among the pieces in 6/8 inspired by the Holiness Church, Better Git It In Your Soul was the only one which met with great enthusiasm; often played by its composer, it was also taken up by Woody Herman, Pepper Adams and Chet Baker. On the other hand, Mingus refused to allow the Adderley brothers to record it: he was (understandably) outraged that they had been credited with the paternity of that “Soul Jazz” which he had carried to the baptismal font.
Also devoid of the slightest cut is Self-Portrait in Three Colors, a short piece whose title echoes the first line in “Beneath the Underdog”: “In other words I am three.” The tune is exceptional in the Mingus opus due to the (relative) serenity which emanates from the series of unisons contained in it, which leave no room for soloing.
Goodbye Pork Pie Hat, a last tribute to Lester Young, derives from the slow blues which had been born spontaneously some two months earlier onstage at the Half Note, on the announcement of Pres’ disappearance. It is a masterpiece. According to Andrew Homzy: “Like [Ellington], Mingus was able to compose over the blues structure with such strength, beauty and sophistication that the listener is not aware of the music’s humble origins.” The version released while Mingus was still alive is 58 seconds shorter than the (complete) version released in 1979: John Handy’s remarkable tenor solo remains intact of course, with the cuts affecting the ensemble passages in the statement and reintroduction of the theme.
Three minutes were shelved between the two variants of Bird Calls. Missing from the original were parts of the contributions from Booker Ervin, Horace Parlan and Shafi Hadi (the most affected), together with Dannie Richmond’s solo. Listening to the version ‘in unedited form’ straight after the first gives you the feeling this is an alternate take where the cuts have given the piece even more strength. Apart from these ‘supply-chain’ problems, Bird Calls provides the listener with food for thought: Mingus swore the tune had nothing to do with Charlie Parker, and that the title was a pure coincidence. You’d like to believe him but, if the coda is indeed reminiscent of Olivier Messiaen’s Le Réveil des oiseaux, why does Bird Calls begin with a phrase from Reincarnation of a Lovebird? That was overtly dedicated to Parker. Mingus’ work abounds with instantly identifiable quotes, yet Bird Calls, like Reincarnation of a Lovebird or Gunslinging Bird, contains no direct reference to Charlie Parker’s music. The only echo is the one returned by the various alto saxophonists in the “workshop”. The truth of the matter is that this rejection of any direct allusion indicated the level at which Mingus was determined to situate his musical rapports with Bird.
“I studied Bird’s creative vein with the same passion and understanding with which I’d studied the scores of my favorite classical composers, because I found a purity in his music that until then I had found only in classical music. Bird was the cause of my realization that jazz improvisation, as well as jazz composition, is the equal of classical music if the performer is a creative person. Bird brought melodic development to a new point in jazz, as far as Bartok or Schoenberg or Hindemith had taken it in the classics. But he also brought to music a primitive, mystic, supra-mind communication that I’d only heard in the late Beethoven quartets and, even more, in Stravinsky.” Taken from Mingus’ introduction to “Mingus Dynasty” and its Gunslinging Bird, those lines need to be seen in the context of the great man’s reply when asked to name his favourite Parker recordings: “I like all,” he said, “none more than the other, but I’d have to pick ‘Lover Man’ for the feeling he had then and his ability to express that feeling.” That was the engine which drove Mingus’ music, a domain in which, beyond the spirit and the letter, he’d chosen Parker as the one to direct his conscience. Between the two of them, any first-degree relationship was unnecessary, unlike what happened with Duke Ellington, his other idol.
Charles Mingus never hesitated to transpose his mode of expression or attack his compositions frontally, as shown by his magnificent version of Do Nothin’ Till You Hear From Me. It has an extraordinarily subtle arrangement which, as with Tea for Two in 1954, inserts I Let a Song Out of My Heart into the melody of what was formerly Duke’s Concerto for Cootie; there’s Eric Dolphy’s work on first alto – a role in which listeners would rarely have the opportunity to hear him –, the solos by three tenors (Yusef Lateef, Joe Farrell and Booker Ervin in succession), an imperial Mingus whose playing is exceptionally well-served by the sound set-up... In a word, Do Nothin’ Till You Hear From Me is a hand full of trumps.
The above-mentioned Gunslinging Bird, together with Song with Orange, which gave Jimmy Knepper – and a new trumpeter, Richard Williams – the chance to shine, appear on “Mingus Dynasty”, the second album Mingus recorded for Columbia (its sleeve was adorned by a photograph of Mingus clothed as a Chinese Emperor, against a backdrop featuring one of those dragons so dear to the Middle Empire). It was an incongruous image for someone who, unlike Monk, showed little inclination for that kind of window-dressing. But Mingus actually quite liked the disguise, because it was a sly reference to one of the nicknames he’d been given as a teenager, “Ming”, and it emphasized the “quarter-Chinese” blood that ran in his veins, an inheritance of which he was very proud. Like “Mingus Ah Hum”, the original version of the “Mingus Dynasty” album contained nine pieces. Same cause, same effect: four tunes exist in two different drafts, including Gunslinging Bird – its full title was If Charlie Parker Were a Gunslinger There’d Be a Whole Lot of Dead Copycats – and Song with Orange. Listening to them one after the other shows that the complete versions, indispensable though they are, are not necessarily the most efficient. It’s a shame that no release has given us a chance to confront both.
Mingus’ relations with Columbia blurred (for money reasons). Do Nothin’ Till You Hear from Me had been recorded for Mercury, as was this Bemoanable Lady by a group of twenty-five musicians, a tune which provides more evidence of Ellington’s hold over Mingus. In a context which calls to mind Johnny Hodges’ interventions with the Duke, the album provides an alto solo which is free without being libertarian, and has an approach in complete empathy with a universe that is more closed than would appear on the surface. The solo is by Eric Dolphy: according to Ted Curson, “One night at midnight his manager called me to say it was OK, I was starting right away; all I had to do was bring my instrument. On the way I met Eric Dolphy, who was carrying his also. When Mingus saw us come in he immediately fired those who were on the bandstand. That’s how it all started; in the middle of the night at The Showplace. We didn’t know the book at all. However, we got into it.” (12) John Handy and Jimmy Knepper later received letters dismissing them with arguments that were totally untrue... Working with Mingus was never a sinecure.
Nat Hentoff had backed Mingus right from the beginning, and he was just as committed to the struggle for civil rights. At the time, he was the A&R director for the newly-formed label Candid Records, so he wasn’t about to censor Fables of Faubus like Columbia had done in removing from its text a diatribe resulting from a historic episode in US history.... Despite a Supreme Court decision declaring all racial segregation to be illegal, in 1957 the Governor of Arkansas, Orvell Eugene Faubus, prevented nine Afro-American children from entering their High School in Little Rock. He even called out the National Guard. The then President, Dwight D. Eisenhower, was obliged to send a thousand men from the famous 101st Airborne to ensure the law was respected. Louis Armstrong hotly reacted with rare virulence: he said Eisenhower “had no guts” and called Faubus “an uneducated plow boy”. Although it seems that Fables of Faubus dates from autumn 1957, Mingus’ indignation was only made public later. According to Dannie Richmond, “Originally the piece didn’t have a title... We were playing it one night and the words ‘Tell me someone who’s ridiculous’ just fitted naturally with the original melody; and I just answered, ‘Governor Faubus’. In that period, when Mingus and I invented something that was musically important onstage, we kept it.” (13) For good measure, the names “Eisenhower” and “Nelson Aldrich Rockfeller” (then Governor of New York) were soon added to that of the Arkansas Governor in Original Fables of Faubus.
While Mingus hadn’t waited for Little Rock to come along to violently express his hate for white America, Fables of Faubus, no doubt his best-known composition, earned him a solid reputation as an activist. It was also the tune he played most often. “I still play ‘Fables of Faubus’”, he said in 1973, “Especially because it’s one of my compositions where I impose myself least on the other players.” This is no doubt the reason why, over the years, the tune often stretched to over thirty minutes. The quartet version recorded in October 1960 at New York’s Nola Penthouse Sound Studio remains the most enthralling, thanks to the solos from Dolphy, Ted Curson and Mingus himself; it’s also the most intense, because it says everything in less than ten minutes. The tune is a reminder of what Mingus wrote in a premonitory, open letter to Miles Davis which Down Beat published in 1955: “Music is, or was, a language of the emotions. If someone has been escaping reality, I don’t expect him to dig my music, and I would begin to worry about my writing if such a person began to really like it. My music is alive and it’s about the living and the dead, about good and evil. It’s angry yet it’s real because it knows it’s angry.”
Adapted by Martin Davies from the French text of Alain Tercinet
© 2013 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux & Associés
(1) Nat Hentoff, Jazz Is, Avon Books, NYC, 1978.
(2) Buddy Collette with Steven Isoardi, Jazz Generations – A Life in American Music and Society, Continuum, London & New York, 2000.
(3) (4) Nat Hentoff, The Jazz Life, Panther, London, 1962.
(5) Jacques Réda, Autobiographie du Jazz, Editions Climats, 2002.
(6) Jean Wagner, Le gros ours en colère, Jazz Magazine N° 94, May 1963.
(7) Gene Santoro, Myself When I Am Real - The Life and Music of Charles Mingus, Oxford University Press, 2000.
(8) Lee Jeske, Jimmy Knepper: A Rare Bird, Down Beat, August 981.
(9) (10) as (4)
(11) Ira Gitler, Jazz Masters of the Forties, Macmillan, 1966.
(12) Bret Primack, The Gospel According to Mingus: Disciples carry the tune, Down Beat, 7 December 1978.
(13) Brian Priestley, Mingus – a critical biography, Da Capo Press, 1983.
Dur comme fer, il se croyait la cible élue du désastre, le souffre-douleur personnel de toutes les oppressions, le préjudice incarné. Son appétit de persécution aurait trouvé refuge dans la folie, si la musique ne lui avait accordé le privilège d’être plus fou encore.
He blindly believed himself to be disaster’s chosen target, the personal whipping boy of all kinds of repression, prejudice incarnate. His appetite for persecution would have found refuge in madness if music hadn’t granted him the privilege of being even madder.
CD Charlie Mingus The Quintessence New York-Los Angeles 1947-1960 © Frémeaux & Associés 2013.