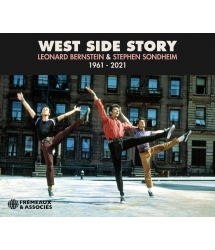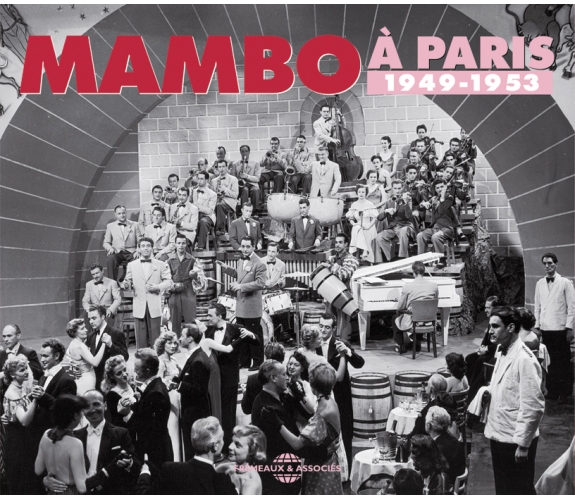- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary











- Our Catalog
- Philosophy
- Philosophers of the 20th century and today
- History of Philosophy (PUF)
- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray
- The philosophical work explained by Luc Ferry
- Ancient thought
- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today
- Historical philosophical texts interpreted by great actors
- History
- Books (in French)
- Social science
- Historical words
- Audiobooks & Literature
- Our Catalog
- Jazz
- Blues
- Rock - Country - Cajun
- French song
- World music
- Africa
- France
- Québec / Canada
- Hawaï
- West Indies
- Caribbean
- Cuba & Afro-cubain
- Mexico
- South America
- Tango
- Brazil
- Tzigane / Gypsy
- Fado / Portugal
- Flamenco / Spain
- Yiddish / Israel
- China
- Tibet / Nepal
- Asia
- Indian Ocean / Madagascar
- Japan
- Indonesia
- Oceania
- India
- Bangladesh
- USSR / Communist songs
- World music / Miscellaneous
- Classical music
- Composers - Movie Soundtracks
- Sounds of nature
- Our Catalog
- Youth
- Philosophy
- News
- How to order ?
- Receive the catalog
- Manifesto
- Dictionnary
Ref.: FA5132
EAN : 3561302513225
Artistic Direction : ERIC REMY
Label : Frémeaux & Associés
Total duration of the pack : 2 hours 18 minutes
Nbre. CD : 2
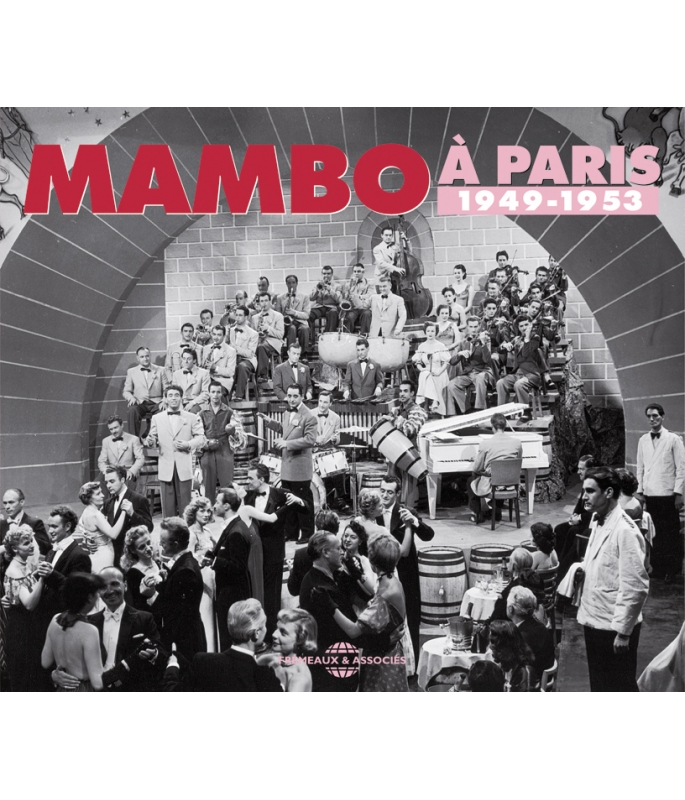
“Following Amours, bananes et ananas and Roots of mambo, Eric Rémy presents another album featuring Brazilian and West Indian music played in Paris in the fifties. This anthology pays tribute to this exotic genre which roused both musicians and dancers and portrays the charm of life in Paris and its cultural melting-pot.” Patrick Frémeaux
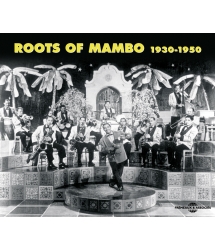
MAMBO - AFRO - CUBOP - LATIN JAZZ
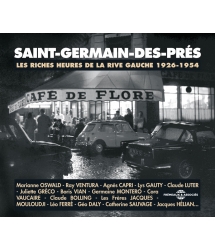
LES RICHES HEURES DE LA RIVE GAUCHE

1922-1951

ANTHOLOGIE DE LA CHANSON EXOTIQUE
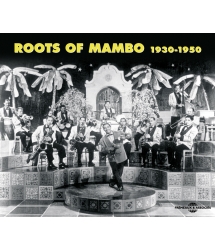
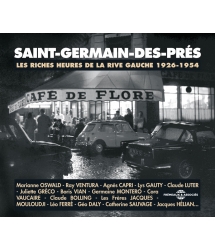


-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1Mambo En ParisVaronaVarona Lewis00:03:371951
-
2El MamboRossottiKesari-Lambertucci Mazzeo00:02:351950
-
3Mambo Jambo Que Rico El MamboRossotti00:02:531950
-
4Mambo JamboWarner00:02:181950
-
5Mambo N°5Warner00:02:241953
-
6Mambo N°8Warner00:02:421953
-
7Mambo En SaxBennet00:02:481952
-
8Mambo C'est RosseBennet00:02:421953
-
9Ohe Ohe Mambo!BarelliBonifay F.00:02:261952
-
10MambitoSolariFrances Leopoldo00:03:181952
-
11Mambo Du SoirWarner00:03:091951
-
12Chombo RumbaWarnerCalzado Ruben00:02:521950
-
13Chombo RumbaCalzado00:03:011951
-
14Un Poquito De Tu AmorWarnerGuttierez J.00:02:281950
-
15La TelevisionWarnerFergo T.00:03:231950
-
16La TelevisionRossottiFergo T.00:02:501950
-
17Suave MulatoWarnerWarner Eddie00:03:111950
-
18Un Meneito Na MaWarnerWarner Eddie00:02:411950
-
19Ole OleWarnerHernandez Bartomo00:02:431950
-
20La MucuraWarnerFuentes A.00:02:531950
-
21La MucuraRossottiFuentes A.00:02:431950
-
22GuindillaWarner00:02:591952
-
23El Bail Del SillonRossottiMennedez Carbo00:02:461950
-
24El MartillitoRossottiCalzado Ruben00:02:471950
-
PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in
-
1Tierra Va TemblaCastellMerceron Mariano00:03:001949
-
2Negro Tam TamWarner00:02:521950
-
3Tam Tam Sur Le CongoSolariTorre A.00:03:001952
-
4CharibangoRossotti00:02:461951
-
5Dansez Macoumba!Helian00:03:091952
-
6Maria PanchitaSolariIthier H.00:03:091950
-
7BorrascaSolariFrances Leopoldo00:02:441952
-
8Que MalaSolari00:02:571952
-
9Y Dice Que AsiEykanBlez Juanito00:02:241951
-
10Mira Que Eres LindaEykanBrito Julio00:02:241951
-
11Que Bueno Debe SerRossottiLaredo00:03:091950
-
12Ay!... Cupido!Rossotti00:02:501951
-
13AlmendraRossotti00:02:351951
-
14Esa Es La MonaCalzado00:02:591951
-
15Todo Para TiCalzado00:02:471951
-
16La Nina PopoffBennet00:03:361952
-
17Porque Negro SoyBennet00:03:201952
-
18Sax CantabileBennet00:03:081952
-
19CucaBennet00:02:511952
-
20BarbarabatiriBennetPuente Tito00:03:001953
-
21Ay De MiBennet00:02:521953
-
22Cao Cao Many PicaoBennetMenendez00:02:351953
-
23Parfum TropicalBennet00:03:011953
-
24La Lune était LàVarona00:03:381951
MAMBO À PARIS
MAMBO À PARIS
1949-1953
Au début du XXème siècle, la réputation de Paris comme capitale artistique européenne et même mondiale n’était plus à faire puisque l’Europe dictait ses lois à un monde qu’elle dominait. Avec le nouvel impérialisme des USA, l’accélération et l’internationalisation des moyens de communication, l’émergence de ce que l’on considérait comme des sous-cultures ou des arts « primitifs », Paris après 1920 devient une ville-carrefour, une plaque tournante extrêmement appréciée des musiciens – entre autres artistes – et notamment des Noirs qu’ils viennent des USA ou qu’ils soient ressortissants de l’Empire Colonial français. Paris, comme Londres ou Berlin fut très tôt ouverte au jazz, dès son débarquement en 1917, puis aux musiques latino-américaines à partir de 1930. Nous avons déjà retracé avec légèreté d’abord dans Amours, bananes et ananas, avec plus de sérieux ensuite dans Roots of mambo les prémisses de l’engouement pour les musiques chaudes, brésiliennes ou antillaises, dans les années 30 et 40.
Paris et les stations balnéaires de l’Atlantique et de la Riviera avaient accueilli, parfois pour de longues villégiatures, des orchestres cubains et antillais avant la guerre. L’Occupation, en revanche, avait été une période creuse pour les musiques dites « typiques » : les musiciens français éprouvaient alors plus d’affinité avec le swing dont la propagation – paradoxe en cette période « contrariée » – déclencha un regain d’engouement qui, pour excentrique qu’il pût paraître, fut décisive pour la popularité du jazz sur notre territoire. A la Libération déferlèrent par vagues le swing US retrouvé, le New Orleans revival, le be-bop et, venant de latitudes plus méridionales, la samba brésilienne puis l’afro-cubain. Toutes ces variétés, édulcorées et colorisées par les chansonnettes et les films (en 1945 on retrouve le cinéma US, de surcroît paré du Technicolor qui semblait avoir été inventé pour Carmen Miranda et les rhapsodies tropicales des revues filmées par les majors d’Hollywood pour l’effort de guerre) vont être goulûment happées par les firmes discographiques qui, à partir de 1950, doivent alimenter les appétits croissants de la naissante société de consommation à coup de microsillons, d’électrophones et de télévision.
Le swing avait été subverti par les boppers qui lancèrent leurs bombes en 45-46 et les musiciens cubains ou portoricains, souvent Américains et new-yorkais d’adoption, avaient été les compagnons de route des nouveaux révolutionnaires au temps des réunions plus ou moins secrètes des années 41-44, ces jam-sessions nocturnes, ces after-hours, après les heures dévolues au business et la musique d’ambiance, fins de nuits pendant lesquelles, les patrons partis, les boppers dansaient : l’exemple toujours cité est le compagnonnage de Dizzy Gillespie et Mario Bauza, tous deux trompettistes chez Cab Calloway où l’on jouait à l’occasion rumbas, guarachas et congas vers 1940. Un lustre plus tard, on retrouve les deux hommes hérauts du cubop, Bauza leader chez Machito et Dizzy chez lui-même, à la tête d’un des plus beaux big bands de l’histoire du jazz, où les percussions afro-cubaines s’installèrent définitivement aux côtés de la batterie, pour autant du moins que vécut cet orchestre babylonien (comme eût dit Berlioz, lequel – l’orchestre de Dizzy, pas Berlioz – disparut en mai 1950) dont la profession de foi était devenu : Cubana be, cubana bop. Tout un programme – qui décoiffa d’ailleurs la salle Pleyel en trois soirs de février 1948. Charlie Parker quant à lui, s’invite dans les clubs où joue l’orchestre Machito et grave avec lui une renversante Afro-Cuban Jazz Suite qui, en 1950, est ex-aequo avec le Tanga de Bauza/Machito et le Cubana be, cubana bop susmentionné, une sorte de troisième manifeste du genre afro.
Au même moment, RCA lance sur le marché français quelques faces de 78 tours de l’orchestre de Perez Prado qui embrasaient déjà le Mexique et défrayèrent le hit parade US : Mambo jambo, Mambo en sax, Mambo n°5, Mambo n°8(1)... C’est en 1950 que des orchestres de danse français, ceux d’Eddie Warner et d’Henri Rossotti, enregistrent les premiers mambos parisiens. Il faudra attendre néanmoins deux ou trois ans pour que le cinéma ou la chanson, dont les producteurs ont souvent un mambo de retard témoignent de cet engouement. En 1953, le retard est rattrapé lorsqu’on lance à Cuba le cha-cha-cha, mambo en tempo slow ou médium, équivalent de ce qu’était à la rumba le boléro, plus alangui (certaines étiquettes mentionnent d’ailleurs mambo-boléro à propos de mambos lents qui sont déjà en quelque sorte des cha-cha-cha). La vogue du cha-cha-cha, soutenue par le 45 tours, réactivera opportunément la frénésie latino-américaine. Les derniers soubresauts de ce surgeon du mambo parfois quelque peu atteint par la dégénérescence (Dario Moreno et Dalida se dépensèrent beaucoup par chez nous dans cette discipline...) auront lieu en période yéyé car rien n’aura résisté au rock ‘n’ roll, rien, rien pas même De Gaulle et Chevalier (longtemps les deux Français les plus populaires de par le monde bien que de captivantes soirées électorales cathodiques (mars 2005) semblent avoir changé la donne : moi j’aurais bien proposé Django Reinhardt ou, pourquoi pas, Aimé Barelli...)
Mais on n’en est pas encore là avec notre anthologie, Dieu merci. Pourtant les musiciens qui sévissent ici et notamment leurs chefs ne jouent pas forcément dans leur arbre généalogique, loin de là ; on peut même dire que c’est l’exception. Avant-guerre, les formations antillaises ou caraïbes établies chez nous (Rico’s Creole Band, Oscar Calle, Lecuona Cuban Boys...) regroupaient d’authentiques émigrés des îles lointaines. Les musiciens de Mambo à Paris sont, eux, pour la plupart de bons Français de souche dont la première pratique fut généralement celle du jazz en sa période swing et qui, par élection et aussi un certain sens des affaires – la tendance était porteuse dirait-on aujourd’hui – s’adonnèrent aux trépidations sud-américaines avec, on le constatera, souvent autant de bonheur que leurs confrères latino-américains. Ils surfèrent d’abord sur l’inlassable vague cubaine (rumbas, guarachas, boléros) qui revenait d’avant-guerre, puis sur les plages brésiliennes de l’après-guerre au rythme des sambas et – à peine avaient-ils eu le temps de reprendre leur souffle – qu’enfin le mambo accosta à nos rives peu avant 1950.
Et finalement, cela correspond bien à l’évolution conjointe de ces deux formes de musiques populaires ; la nord-américaine (jazz) et la sud-américaine, latitude cubaine. Dans les années 30, swing et rumba dansent chacun leur route ; à partir des années 40 une idylle est consommée et les deux jeunes gens devenus l’un bop, l’autre afro-cubain vont donner naissance au cubop. A ce titre, l’évolution de Warner, Barelli, Rossotti, Bennet, ayant d’abord vécu par et pour le jazz, puis adoptant ensuite le nouveau bébé est significative. Il faut rappeler qu’après la Libération, la situation des jazzmen français jusqu’alors coupés du monde, vivant en autarcie et donc très « occupés » pendant 4 ou 5 ans, est devenu paradoxalement beaucoup plus difficile. Les grandes usines à swing s’essoufflaient, leur organisation tournait trop rond et elles marquèrent le pas face aux petites formations boppisantes ou non. Les grands orchestres coûtaient cher. Il fallut sacrifier au commerce. La carrière d’Aimé Barelli est tout à fait représentative de cette position : l’époux et accompagnateur de la très populaire chanteuse Lucienne Delyle ne put maintenir sur pied un orchestre régulier qu’aux prix d’arrangements souvent commerciaux qui devaient le mener emblématiquement à la direction de l’orchestre du Sporting Club de Monte Carlo : « Aimé, par pitié laisse tomber les violons ! » écrivait affectueusement Boris Vian dans une de ses chroniques de disques de juin 48. La formation réunie par Barelli que nous entendons ici joue sans violon, sans sirop et c’est probablement à peu près la même que celle qui jouait dans les divers fes-tivals de jazz de l’époque et accompagna Dizzy à la salle Pleyel en 1952.
Car il y eut bien pire. C’était le temps de l’orchestre de Jacques Hélian, ex-Collégien saxophoniste de chez Ray Ventura dont l’orchestre se constitua en octobre 38 parce que Ventura, déjà lié par contrat d’exclusivité au sponsor Lustucru (!) ne pouvait honorer aussi la Société Occulta (!!) c’est à dire la société des gaines Scandales (! ! !). Hélian s’affirme souvent dans l’euphorie sud-américaine, très digne héritier de son ancien patron parce qu’il faut bien dire que notre sourire se fige très vite quand Jacques et ses potaches quittent les terres tropicales pour regagner la France profonde. Que s’est il passé entre Ventura et Hélian dans l’esprit des « jazz de scène »(2) ? Qu’est-ce qui fait que nous sourions aisément à tant de facéties faciles des Collégiens d’avant-guerre (et jusqu’à « aller pendre notre linge sur la ligne Siegfried »(3 )! pourtant…) et comment se fait-il que nous sommes affligés par l’incommensurable bêtise des scies hélianesques (échantillons : Le Porte-bonheur (un petit cochon avec un cœur) , Faut-il marier Camille ?, La Dactylo ou La Bouteille). Et pourtant, que d’atouts : professionnalisme, virtuosité des solistes et même génie (Ernie Royal et Kenny Clarke furent des rangs, oui !), mise en place redoutable de précision sans parler de la qualité de la prise de son et des pressages Columbia ou Pathé, à faire pâlir les faces venturesques gravées à la même époque dans le même esprit chez Polydor. En valeur absolue donc, un orchestre de variété superbe au service de certain arrangement (pour dzim-boum-boum et chœur de vierges même pas folles) de la Danse du sabre de Katchaturian qui réussit à gagner des millions et à donner au très très discutable concept de mauvais goût sa véritable assiette ! C’est pourquoi nous n’hésiterons pas à affirmer qu’avec les sambas d’après-guerre, quelques trop rares faces de jazz presque pur et ce Dansez Macoumba haut en couleurs, nous tenons là les meilleurs titres d’Hélian et ses garnements. Est-il vulgarité permise ou possible, au fond, avec la « musique nègre » ?
Retracer l’itinéraire musical d’Eddie Warner, c’est aussi relire quelques pages très mouvementées de l’histoire du XXème siècle et témoigner que ce n’en est pas la dernière décennie qui découvrit le métissage musical ! Eddie Warner est né citoyen allemand l’année où les troupes US débarquèrent en Europe avec le jazz dans leurs bagages. A 17 ans, nanti d’une solide éducation musicale, il quitte une patrie désormais invivable pour une trajectoire de réfugié, tristement classique dans ces années-là mais qui eût pu plus mal finir encore : Strasbourg en 34, Paris en 37, la Légion étrangère en 39, Nice en 41 puis « l’Armée des ombres ». Dans ses tribulations, il a croisé, entre autres, Hughes Panassié (fondateur du Hot Club de France et de la revue Jazz Hot), Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Henri Salvador, Leonard Feather qui dans le magazine américain Melody Maker le cite comme un des meilleurs pianistes de jazz français. « Au début de ma carrière, j’ai vécu pour le jazz et non par le jazz. A l’époque, le hit parade et le jazz étaient totalement incompatibles. »(4)
De fait, après la Libération, de piano-bar en big band, d’accompagnement de vedettes de la chanson en engagement à la radio où il joue à la demande des auditeurs exprimée en un coup de fil tous les airs en vogue, Eddie Warner « et ses rythmes » sont amenés à interpréter de plus en plus souvent de la « musique tropicale ». C’est cette veine là qui lui vaudra le Grand Prix du disque en 1947 avec Samba samba et lorsqu’il constitue enfin son grand orchestre beaucoup plus étoffé trois ans plus tard, c’est cette dénomination pittoresque, folklorique et séduisante qu’il adoptera. Comptant 17 musiciens, « cet orchestre, gag suprême, était composé à 85% de musiciens français; seuls les percussionistes étaient sud-américains. »(5)
Son « rival », Henri Rossotti lui aussi, à l’occasion utilisera le qualificatif « tropical » mais précédé par le terme « orchestre » plutôt que par le mot « musique ». Lui aussi venait du jazz. Lui aussi obtiendra un grand prix du disque un an après Warner, en 48 avec une samba, Cavaquino. Le son de la phalange Warner est plus diffus, plus étale, laisse plus de place aux soli instrumentaux. La formation était à géométrie variable et s’adjoignit, à l’occasion, une flûte et une section de cordes pour de très envoûtants boléros aux arrangements raffinés (Boléro dans la nuit, Noche de Ronda, Andalucia, Jeux dangereux, Atlantide, Pluie d’étoiles..., juin 52)(6). Chez Rossotti, les soli sont plus rares et donc l’orchestre, jouant davantage par sections ou en tutti, recherchant volontiers l’effet de masse fait preuve d’un punch très percutant, idéal pour le mambo qui n’est pas précisément une musique pour ballerines.
Mais il s’agit de points de détails et la prise de son n’y est sans doute pas pour rien non plus : que l’on compare le son « touffu », « trappu » des gravures Warner de juin 50 et le son beaucoup plus aéré et réverbéré des séances de janvier 53. Et au cours d’une même session de Négro Tam Tam (à l’atmosphère moite et étouffée) à Mambo Jambo (à la jubilation cavalcadante), on peut se demander si l’on à affaire à la même formation. L’encre de l’arrangeur n’était sûrement pas la même en tout cas : Negro Tam Tam est en noir et blanc et Mambo Jambo en couleurs. Pour rester dans l’image cinéma, Mambo du soir et Mambo Jambo (toujours dans sa version Warner fort différente de celle de Rossotti et de celle, originelle, de Perez Prado, son auteur ou encore de celle de Machito), ont une atmosphère « italienne ». En effet, le mambo fit fureur en Italie. Toutes les vamps de Cinecittà s’illustrèrent dans une ou plusieurs séquences paroxystiques où leur sex-appeal (et leurs appâts débordants) se trouvait bien attisés par les rythmes sud-américains: de Gina à Sophia, en passant par Silvana Mangano et son illustrissime bayon, El Negro Zumbon, dans Anna(7) trois ans avant une coproduction italo-américaine intitulée Mambo, tout simplement. Même Antonioni sacrifia au torride dans son premier long métrage (Cronnacca d’un amore, 1950) où les galas de charité dans les restaurants de luxe se déroulent au son de la conga et où la ravissante Lucia Bosé se fait enlacer par un séducteur à fine moustache pour une samba très mondaine. Il y a toujours un mambo dans les premiers Fellini (ceux des années 53 /56 : Vittelloni, Bidone, Nuits de Cabiria) et je ne sais pas qui est ce Théo Trianda, signataire de Mambo du soir (comme « … soirs de Rome ») mais son encre à lui ressemble fort à celle d’un Nino Rota. C’est un des disques de Benny Bennet présentés ici qui sert de viatique à la prostituée volcanique incarnée par Mélina Mercouri dans le film de Cacoyannis qui la révéla en 1955, Stella. Et la prostituée la plus occidentale, la plus fardée, la plus new-look, en jupe collante, juchée sur ses talons Louis XV, dans le bordel de La Rue de la honte, dernier film du sublime Mizoguchi en 56, s’étourdit à coup de mambo. Mais il y a loin des belles Hellènes ou même des jolies nippones aux belles américaines qui naturellement, au coeur de freezelandia – l’Amérique frileuse et prude des années de guerre froide – furent les premières à s’initier aux bacchannales frénétiques de Chango, une des divinités les plus souvent invoquées dans le mambo. Parce que les années mambo, c’est aussi le triomphe de l’Amérique 100% US, 100% blanche, 100% macho et hétéro. Petite bourgeoise, raciste, paranoïaque, maccarthiste et anti-rouge, mais « c’était un véritable paradis (...) une décennie dominée par la bêtise et par l’ennui »(8). Le bonheur américain, cette imposture. Ces ménagères corsetées, à tête de caniche qui se faisaient la trombine de Doris Day ou June Allyson – les actrices les moins sexy du monde – ces pères de famille à tête d’adjudants qui, rentrés du boulot dans leur banlieue – cinq cent cottages identiques – apprennent au fiston très excité le maniement de la batte et du fusil anti-martiens pendant que maman torchonne et que fifille rêve de devenir Debbie Reynolds, voilà ce que les films américains, même les plus progressistes nous donnaient à voir et à rêver ad nauseam. Il n’est pas sûr que ce soit fini. Là dedans arrivait toujours une mauvaise femme, une voleuse de mari, une Yvonne de Carlo, une Gloria Grahame, une Shelley Winters, une Dorothy Malone (Rita et Ava s’étaient tirées dans le Vieux Monde et Marilyn à New-York – ce qui, vu du Texas, est quasiment la même chose) pour incarner le Mal et, à coup sûr, on entendait du mambo. Heat Wave, croupionnait impudemment Marilyn(9). On respirait cinq minutes avant de revenir à la soupe quotidienne cent pour cent pur boeuf.
La carrière de Benny Bennet est elle aussi caractéristique de tous les va-et-vient et croisements entre jazz et musiques cubaines. Qu’on en juge d’après le texte de pochette d’un microsillon 25 cm Vogue de 1954 (où figurent Cuca, Sax cantabile et Porque negro soy) que nous reprenons quasi intégralement car nous ne saurions mieux dire : « Né à Port-d’Espagne (Vénézuela) en 1922, Benny Bennet émigra aux Etats-Unis avec sa famille dès l’âge de deux ans. A douze ans il entre à l’Ecole Manhattan de musique où, jusqu’à l’âge de dix-sept ans, il étudiera la percussion : cymbales, vibraphone, batterie, etc. Entre temps, il a commencé à jouer dans les orchestres de jazz amateurs. A quinze ans, il joue dans l’orchestre de Freddie Mitchell, puis avec Elmer Snowden. Nous le retrouvons après chez Jimmy Monroe à l’Up Town House, rendez-vous des artistes où chaque soir les grandes vedettes du jazz se réunissent. C’est ainsi qu’il joue avec Coleman Hawkins, Teddy Wilson, Jimmy Blanton, Charlie Barnet... Chaque lundi soir, il fréquente le Minton’s Play House où se retrouvent Thelonius Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Christian et tant d’autres précurseurs du jazz moderne. C’est alors qu’il fait connaissance de sa première femme, Cathalina, une danseuse cubaine qui l’entraînera dans les dancings et l’intéressera à la musique sud-américaine. C’est ainsi qu’il fait connaissance avec Machito y sus afro-cubans qui, à cette époque, interprètent déjà la rumba guaïda qui deviendra plus tard le mambo. Venu en spectateur, il est séduit par cette musique où il retrouve la vigueur et le rythme du jazz. Au cours d’une jam- session de Machito, il est complètement emballé et se lie d’amitié avec Machito et ses musiciens, prenant des leçons avec Chino, l’un des musiciens. Trois mois après, lorsque Tito Puente quitte l’orchestre de Machito, Benny Bennet prend sa place et débute avec l’orchestre au La Conga de New York. Sur les conseils de sa femme qui le pousse vers la danse, il quitte cet orchestre et commence une carrière de danseur professionnel et part en tournée vers le Nord, le Canada et l’Ouest.
De retour à New York, il entre dans l’orchestre de Pupi Campo(10) et ses danseurs, composé de trois hommes et de trois femmes. En 1942, après quelques difficultés avec l’orchestre qu’il venait de former, il part en tournée avec les Four Bars of Rhythm. Mobilisé en Floride, il entre dans l’orchestre militaire. Il demande à être versé dans l’aviation et suit les cours pour devenir mitrailleur. Il est reçu et envoyé en Angleterre d’où il participe à plusieurs missions. Son avion est abattu dans la Manche et, blessé, il est muté comme mécanicien. Il vient en France en 1944 et découvre les musiciens de jazz français. Ensuite, il est envoyé en Allemagne où il est muté dans le Special service, tantôt comme boxeur – il ira jusqu’aux finales du Championnat militaire – tantôt comme footballeur, enfin comme chef du Sky Liners et de ses dix-huit musiciens. Démobilisé en mars 1946, il revient à Paris où l’attend un engagement au Rêve et il y restera un an et demi avec l’orchestre de Charlie Lewis. Il part ensuite en tournée avec Alix Combelle puis revient au Rêve. Il participe alors à des concerts de jazz pour le Hot Club avec les grandes vedettes du jazz français, Jacques Diéval, Léo Chauliac, Hubert Rostaing et enregistre les premiers disques bop faits en France pour la marque Swing (avant même Kenny Clarke ! NDLR). Engagé au Jimmy’s, il reprend son ancienne spécialité et introduit à Paris le mambo (avant même Warner, qui a dit la même chose ?! NDLR). Mais ce n’est qu’en 1950, après un nouvel engagement au Rêve qu’il forme son premier orchestre typique au Vieux Colombier de Juan-les-Pins.
Il est ensuite engagé au Moulin-Rouge puis au Carroll’s. C’est à cette époque que se situent ses premiers disques vogue. Ceci se fait d’une façon assez amusante. Il a organisé avec Vogue l’enregistrement d’une vedette brésilienne qui, au dernier moment, se trouve malade. Il a sur lui assez de matériel pour proposer de la remplacer et fait finalement une séance avec huit de ses arrangements. (...) En juin 1955, il devra retourner aux Etats-Unis pour renouveler sa nationalité américaine et il espère en profiter pour y faire une tournée de six mois. » Benny Bennet est revenu poursuivre sa carrière en France après cet épisode (dont on ne sait s’il eut lieu) et s’adonna aux joies en vogue du cha-cha-cha, du calypso, du merengue, jusqu’aux environs de 1960 après quoi l’on perd sa trace. La pochette en anglais d’un disque Palette de 1960(11) nous apprend que Ruben Calzado est né à Manzanillo dans la province d’Oriente à Cuba le 22-11-1916. Nous n’en retranscrirons pas intégralement le texte, pourtant beaucoup plus court que celui consacré à Benny Bennet, parce que la traduction littérale nous exposerait à d’hilarantes équivoques du type : « Il fut distingué pour jouer lors de la fameuse « Nuit à l’Opéra de Paris », événement annuel qui vit en décembre 1958 les débuts de Maria Callas en ces lieux. » Equivoque qui ne seraient pas tout à fait notre faute même si nous n’apportions pas la précision que Ruben dut jouer non pas du Bellini ou du Puccini dans la fosse de la salle prestigieuse, mais quelques latineries distinguées à la sauterie de gala qui suivit le récital de la plus célèbre cantatrice du XXème siècle dont on sait que l’orchestre qui l’accompagnait était celui de l’Opéra de Paris dirigé par Georges Prêtre. Maintenant, libre à nous d’imaginer la rencontre de Madame Maria Callas et de Monsieur Charles de Gaulle, Président de la République française, sur un boléro langoureux ou un mambo torride, à l’ombre de la trompette de Ruben Calzado, lors des mondanités qui s’ensuivirent...
Entre sa naissance et cette consécration donc, les seules traces avérées que nous trouvions de Ruben sont celles qu’il a laissées sur des disques gravés à la Havane en 48 en compagnie, entre autre, des illustres Arsenio Rodriguez (guitare) et Chano « Pozo » Rodriguez (conga) puis, à partir de l’année suivante à Paris et dans les stations chics des bords de mer, où l’on ne saurait dire s’il était à la tête d’un orchestre régulier bien à lui. Arrangeur savant, trompettiste délicat, il nous offre des interprétations incandescentes et musclées de ses thèmes personnels.
L’orchestre de Sébastien Solari ne semble pas avoir été un orchestre régulier et peut-être n’était-il qu’une formation de studio, un des orchestres-maisons de chez Odéon comme celui de Jean Faustin auquel il emprunte peut-être des requins de studio, de ces musiciens ultra professionnels capables de tout jouer. Dany Lallemand(12) pense qu’on entend probablement ici un Benny Vasseur (tb), un André Paquinet, un Charles Verstraete, peut-être aussi des percussionistes de chez Eddie Warner. Solari a enregistré des boogies et des sambas quand c’en était la vogue en 45 et il s’est naturellement mis aux boléros et aux mambos quand ce fut leur tour quelques années plus tard. Il a même signé certains titres ici présents avec Léopoldo Frances dont nous parlerons tout à l’heure. De tous les orchestres que l’on peut entendre – mais ceci est peut-être dû aussi à la prise de son –, c’est celui qui sonne le moins typique, le moins cubain, le plus music-hall et cette formation est peut-être la plus importante en nombre d’exécutants. Les titres, supra exotiques et qui se veulent évocateurs (et ils le sont : Borrasca, Que mala!, Tam-tam sur le Congo) sont regroupés avec d’autres de la même eau, au début du second disque. Nous sommes sur les rives ou dans les parages d’un tropicalisme de cinéma, saturé de moiteur, en noir et blanc ombreux ou en Technicolor cruel. Les Européens sont bien seuls dans leurs vêtements immaculés, sous leurs chapeaux élégants et dérisoires quand ils descendent du petit avion qui s’est posé sur l’aérodrome désert en pleine jungle; de chaque côté du fleuve aux eaux jaunes, la forêt a des yeux et le rythme des pagayeurs qui semblent obéir au tam-tam qui résonne d’une rive à l’autre ajoute à l’angoisse; dans chaque clairière un énorme chaudron attend les voyageurs déjà cuits à l’étouffé. Toutes les tables de village sont dressées pour un grand festin cannibale. Il nous souvient avoir assisté, tout enfant, au milieu des années 60 à une émission de variétés ou un grand diable noir en jupe de raffia et masque de sorcier dansait en brandissant un bâton à tête de mort pour une bamboula terrifiante entre deux marmites géantes dans une jungle de carton-pâte. Tel était encore l’imaginaire blanc des années 60. Mais peut-être s’agissait-il de la séquence vaudou de Stormy Weather (1943) qui lui ressemble diablement...(13)
Nous pouvons réécrire ici ce que nous avons observé à propos de Barelli et surtout de Solari en ce qui concerne les quatre faces que nous connaissons gravées par l’orchestre réuni sous le nom d’André Ekyan (les deux mambos ici présents et deux boléros : Que va ! et Dos gardenias). Ekyan était l’un des meilleurs saxophonistes français depuis les années 30 (on peut entendre son alto aux côtés de Benny Carter, Coleman Hawkins, Alix Combelle, Django et Grappelli dans ce qui reste l’une des plus prestigieuses sessions d’enregistrement du jazz français, la séance du 28 avril 1937 qui produisit Honeysuckle Rose, Crazy Rhythm, Out of Nowhere et Sweet Georgia Brown.). Vers 1950, contrairement à Barelli, il ne semble plus avoir depuis longtemps d’orchestre régulier – s’il en eut jamais – et il n’a probablement été ici qu’un prête-nom d’autant qu’on ne perçoit de lui pas l’ombre d’un solo; en fait, c’est « le chanteur mexicain Léopoldo Frances » la vraie vedette des ces disques. Comme ils enregistraient pour la même firme (Odéon) et que cela se pratiquait en toute amitié dans le petit monde du jazz, il n’est pas exclu que les gravures Solari et Ekyan aient réuni le même personnel. On notera tout de même que la formation Ekyan est plus énervée, plus explosive, plus swing en un mot mais cela est sans doute dû au fait qu’elle joue des mambos en tempo rapide alors que les titres de Solari sont des boléro-mambos ou des afro, en tempo médium.
L’éditeur Jean Garzon était un amateur de musique latino-américaine mais à un degré de latitude plutôt Argentine et il fit surtout enregistrer pour sa marque Typic des ensembles de tango comme celle du vétéran Bachicha. C’est sans doute pour étoffer son répertoire qu’il sacrifia à la vogue afro-cubaine et que l’on trouve dans sa modeste écurie un certain Lewis Varona qui dirigea des séances de rumbas, boléros et mambos. Parmi ces derniers, certains sont excellents et Mambo à Paris qui porte le nom de notre anthologie méritait bien d’ouvrir le bal d’autant qu’il annonce le motif principal de Tequila, autre avatar de la musique cubaine mâtinée de rhythm and blues six ou sept ans plus tard. Le soliste qui s’y taille la part du lion est pianiste et cela nous permet d’avancer que ce Lewis Varona n’est peut-être personne d’autre que le pianiste Luis Varona qui, tout comme Calzado, serait venu prêcher la bonne parole cubaine sous nos climats après avoir joué, comme Benny Bennet, dans la formation des Afro Cubans de Machito en 1943 chez qui, avec Julio Andino il aurait improvisé les variations de Tanga dont Mario Bauza s’empara et fit l’indicatif de l’orchestre puis le thème de ralliement du cubop. Varona quitte Machito au bout de quelques mois dans ses rangs après quoi l’on perd sa trace avant de le retrouver vers 1950 chez Tito Puente, lui aussi transfuge de chez Machito et haute pointure du latin jazz. Ses enregistrements français datent de 1951 et nous n’en savons pas plus.
Reste à évoquer les chanteurs qui contribuent largement à l’ambiance. Tous sont Noirs (sauf Ben) et d’origine latino-américaine. Nous avouons n’en pas savoir beaucoup plus, ce qui est curieux quand on songe à leur présence évidente : qui étaient ces hommes si vivants ? Le sont-ils encore ? S’est-il trouvé quelqu’un pour avoir la bonne idée de les rencontrer, de les interviewer, de leur faire raconter leur jeunesse ? Mystère. On remarquera l’absence totale d’élément féminin alors que, de l’autre côté de l’océan, Machito laissait abondamment s’exprimer la facétieuse Graciela (d’ailleurs sa soeur) et que se trouvait à Paris l’excellente Chiquita Serrano qui chantait notamment avec le Rico’s Creole Band et qui fit un superbe disque cubain enregistré au studio Pigalle en mars 57.
Pour ce qui concerne les messieurs ici présents, à peine avons-nous pu glaner quelques bribes d’informations, ça et là. José Bartel fut autour de 1950, le vocaliste attitré de chez Barelli et nous l’avions déjà invité sur l’anthologie précédente (Roots of mambo) pour un Lamento pas triste, entre samba et mambo lequel constituait, si l’on veut, notre modeste version française de l’illustre Cubano Be Cubana Bop. A propos de version française et de doublage, on retrouvait Jo Bartell une bonne dizaine d’années plus tard sur la bande sonore des Parapluies de Cherboug où il permettait au charmant Nino Castelnuovo de faire croire au public qu’il savait chanter... Ruddy Castell a animé bien des nuits parisiennes des dancings d’après-guerre et signé beaucoup de disques en compagnie de formations à géométrie variable qu’il dirigeait ou dont il était l’invité (Eddie Warner par exemple).
Umberto Canto Morales, lui, semble avoir été plus interprète que leader ou organisateur et son nom est plus particulièrement associé à la carrière de l’orchestre Rossotti, ce qui ne l’empêcha pas de sévir aussi chez Eddie Warner et Benny Bennet et de prêter main forte à Dizzy aux percussions lorsque ce dernier eut des accès de fièvre tropicale lors de son séjour parisien de 1952-53. « Le chanteur mexicain Leopoldo Frances » – selon l’intitulé des étiquettes des disques Odéon de 51 / 52 – est celui dont il y a le plus à dire parce qu’ il s’est assuré par le cinéma une visibilité beaucoup plus grande. En effet, il fut « le Noir de service » des films français des années 50, comme Habib Benglia l’avait été au théâtre et sur les écrans avant-guerre. Fort beau garçon, belle gueule au sourire carnassier, chanteur sans complexe et parolier, danseur à l’occasion, on peut l’apercevoir quelques instants dans les petits rôles d’au moins trois classiques cités plus haut et où, comme par hasard, on entend du mambo : Les Orgueilleux (1953) dans la séquence du bureau de poste, où il essaye de soulever une Michèle Morgan excédée et au bout du rouleau (le mari mort, la méningite, l’hôtelier violeur, la canicule, le ventilateur déglingué, les fanfares mexicaines et les mambos par dessus tout ça... c’est beaucoup pour une seule femme !), Razzia sur la chnouf (1955) en marin américain trafiquant de drogue, Et Dieu créa la femme (1956) où après le soutien-gorge et la peau moite de Michèle Morgan dans Les Orgueilleux, les adolescents des années 50 et les Américains scandalisés trouvèrent de quoi alimenter leurs fantasmes érotiques, ce qui assurera encore quelques temps une certaine notoriété à ce film qui fut très dans le vent et donc mainenant forcément démodé(14), Léopoldo donc, dans une séquence qui en est le paroxysme et le meilleur moment, excite BB avec ses maracas et ses ondulations de hanche et la pousse à un déchaînement de sex-appeal et de déshabillage pour ce qui reste une des plus belles manifestations de l’hystérie au cinéma, hystérie féminine et masculine (le mambo est une musique bien hystérique, il est temps d’en convenir et s’arrose volontiers de rhum et de tequila). Leopoldo apparaissait encore en marin joueur face à Fernandel dans Le Mouton à cinq pattes (1954) et dans Le Port du désir (même année) d’Edmond T. Gréville, cinéaste que Bertrand Tavernier a tenté de nous faire redécouvrir, mais sur ce coup-là, il ne nous a guère convaincu : c’est encore un Gabin poussif et période « creux de la vague » (malgré le Grisbi !). L’ambiance marseillaise interlope et crapuleuse ne nous excite plus guère et les scènes de plongée sous-marine avec scaphandrier antique n’ont plus aucun intérêt. Seuls détails piquants : c’est le film où J. R. Caussimon en maniaque sexuel pique les seins des femmes avec des aiguilles à chapeau ( ?!) ; on peut y voir aussi Gaby Basset(15) s’envoyer le sexy Leopoldo, toujours en bordée, qui danse un bref boogie. On le retrouvera sans doute dans tel ou tel film, pas encore vu ou revu et ce sera toujours amusant.
Ben qui chante La Mucura chez Eddie Warner, constituera un combo quelques années plus tard et sera l’un des grands célébrants hexagonaux du culte du cha-cha-cha, du calypso, du merengue avant que les colères et les trépignements du rock n’oblige tout ce petit monde à remballer ses percussions et à céder le pas.
A propos de cette réédition… ou de quelques madeleines cubaines
Marcel Proust a évoqué en quelques pages universelles les caprices de la mémoire involontaire et des libres associations. Ainsi certains titres figurant sur cette anthologie sont pour moi inséparables de... la Normandie quand, avec mes parents nous étions invités chez des amis à eux dans leur fermette un peu bohême. A un âge (14 ou 15 ans) où on commence à prendre le large par rapport aux adultes avec lesquels on s’ennuie généralement beaucoup, je ne refusais pourtant jamais d’aller aux fiestas chez eux (que m’évoquent à la perfection certains films de Claude Sautet exactement contemporains). En effet, ils avaient des 78 tours que j’écoutais inlassablement sur un vieux tourne-disques : les Mambo n°5 et Mambo n°8 d’Eddie Warner, La Nina Popoff(16), Mambo Boogie et Sax cantabile de Benny Bennett, un Noro Morales, un Tito Puente, un Lecuona Cuban Boys toujours fumant (Rumba tamba) et puis aussi des Billie Holiday réédités sur 33 tours et qui procuraient un autre type de frisson... Mon père pour sa part n’avait qu’un 45 tours de cha-cha-cha par Xavier Cugat et un autre par le mystérieux Big César (nom étrange derrière lequel se cachait le délicieux Jean Constantin); mais il avait beaucoup de très bon jazz (Hawkins, Hampton, Bird, Miles, Gerry Mulligan, Horace Silver, Guy Laffitte...). Délaissant quelque peu Bach, Watteau et le XVIIIème siècle, découvrant Fred Astaire au Mac Mahon et le cinéma classique hollywoodien à l’Action Lafayette, je trouvais sans difficulté de quoi satisfaire ma curiosité pour le jazz qui, comme les films, commençait à faire l’objet de rééditions systématiques, du moins pour les années 20, 30 ou 40. Il n’en était pas de même pour les musiques latino-américaines (on ne parlait pas encore de musiques latino ni même de latin jazz et la salsa battait son plein). Pour trouver des disques qui évoquaient ces musiques qu’on entendait dans des films qui passaient encore à la télévision aux heures de grande écoute – prime time – (Le Salaire de la peur, Les Orgueilleux, Razzia sur la chnouf, Et Dieu créa la femme...) où le mambo était toujours le préliminaire à quelques turpitudes, j’en étais réduit à emprunter à des amis de mes parents des microsillons de musique de danse des années 50 aux intitulés du type Surprise-party, Cocktail de danses, Thé dansant... formule produite par toutes les marques dans un but pratique (ces disques étaient numérotés –il y eut des dizaines d’éditions de Surprise-party sur tous les labels : Surprise-party n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 etc... – ou thématique (Surprise party chez Ghyslaine, Minou ou Pépère, à Auteuil, Rue de Lappes, Hossegor ou Hollywood, Orange, Bleu etc...), objets relégués dans l’arrière-fond des discothèques où l’on trouvait ça et là, entre les viennoiseries, le musette, le tango et les fox-boogies, quelques faces de « musique typique ». C’est d’ailleurs comme cela que j’ai découvert la plupart des titres ici présents et certains ont été repiqués sur des disques de cet acabit(17). C’est dire si cette zizique intéressait grand monde... Et puis, dans les années 70, les années 50 étaient encore trop proches pour la nostalgie bien que très lointaines pour l’adolescent que j’étais : à 15 ans tout vous semble antédiluvien; après tout, j’étais né en 1960... Il fallut aller aux Puces de Clignancourt où, comme par hasard, mes premières trouvailles (ce n’était pas un tour de force, vu le tirage qu’avait atteint ces disques à l’époque) furent El manisero (The Peanut Vendor) par l’orchestre de Don Azpiazu (1930), le premier 45 tours de l’orchestre Benny Bennett (Nina Popoff, Mambo Boogie etc..., 1952), un Noro Morales et... j’ai oublié le reste. Dans les bacs des disquaires vendant du neuf, rien ou presque. A partir de 1980 on vit apparaître quelques rééditions très parcimonieuses de l’inévitable Xavier Cugat(18), un Lecuona, des imports aléatoires de Machito, Perez Prado, Beny Moré, Tito Puente... Il y eut tout de même un Eddie Warner, on se demande par quel caprice du sort. Mais la volonté manquait et sans doute l’intérêt. Le mambo (terme alors totalement désuet) n’avait droit de cité que sous le nom d’afro-cubain chez les jazzmen (Gillespie, Parker...) et encore : les titres de Parker avec Machito n’étaient pas les plus réédités, on leur préférait souvent les flirts de Bird avec de filandreux orchestre à cordes... Et puis, après tout, la plupart de ces gens-là étaient encore vivants et jouaient une musique dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est très vivante. On a pu voir Machito, Puente, Celia Cruz et j’en passe au New Morning et de plus en plus souvent invités aux festivals de jazz au même titre que les jazzmen purs et durs (adjectifs horribles). Il y eut l’arrivée du disque-compact dont on sait qu’il réactiva les ventes et stimula les rééditions. Il y eut Buena Vista Social Club qui donna envie à tout le monde d’aller voir les palais, les bagnoles et les frigos de La Havane qui dataient au moins du temps du mambo, d’adopter une mamy ou un papy cubains et qui fit découvrir aux moins de cinquante ans Besame mucho, Dos Gardenias, Quizas, quizas, quizas, La Mucura... Moi ce film, je l’ai trouvé gentil mais j’étais déjà un peu au parfum. Depuis déjà des années, chaque été, un ou plusieurs des titres présents sur ce CD avait été à nouveau un tube dans mon entourage : Mambo n°8, La Television, Chombo rumba, El Baile del sillon, Mambo c’est rosse, La Lune était là... Aujourd’hui, mes élèves de lycée qui ont l’âge que j’avais quand j’écoutais mes premiers mambos en Normandie et qui n’ont connu que Lou Béga, m’empruntent mes CD de mambos parce qu’il faut être très mauvais coucheur pour trouver cette musique ringarde et que comme disait Eddie Warner à qui nous rendons la parole et qui aura ainsi le dernier mot : « même réadaptée, voire édulcorée, elle gardera toujours sa place en raison de son dynamisme et de sa sincérité. »
Eric REMY
© 2007 Frémeaux & Associés
Remerciements : Jean-Pierre Capelle, Génia et Claude Chabrol, Marc Dumont, Dany Lallemand, Jean-Pierre Meunier, Daniel Nevers, Gérard Roig.
NOTES
1 Nous avouons ignorer l’origine et le sens de ces numéros (sans doute un clin d’oeil ou une inside joke de la bande à Prado). Tout ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’il n’existe que deux autres opus numérotés : un Mambo zéro de Ruben Calzado et un Mambo n°7 d’un certain Salamanca. Nous n’avons pas réédité ces deux titres enregistrés l’un par Calzado, l’autre par Benny Bennet parce qu’il nous ont semblé moins bien frappés que les autres. Pour fan de numérologie seulement. Ajoutons qu’il n’y eut qu’un seul cha-cha-cha pareillement numéroté : un n°5 (comme Chanel n°5 ?) dont l’orchestre Eddie Warner donna une version explosive mais qui, par sa date (1954) nous situe hors des limites de cette anthologie.#
2 Orchestres jouant aux frontières du jazz, importants en nombre d’exécutants sinon en qualité – qualité jazzique s’entend- car leur répertoire aussi éclectique que très bien joué n’adoptait le jazz qu’assez occasionnellement et dans un style très… dilué. Nos futurs chefs mambo (Hélian, Ekyan, Barelli, Rossotti, Warner), encore « petits swings » en 1940 frayèrent allègrement dans les pupitres bien payants de ces entreprises aux patrons plus ou moins contraignants selon qu’ils leurs tenaient la bride sur le cou ou leurs autorisaient soli et impro. Le nom de ce type de formations fut longtemps indéterminé, le mot « jazz » ayant vite signifié, dès les années 20, « orchestre de danse », pour des ébats chorégraphiques de races très diverses : de la polka au swing et du musette à la rumba. « Jazz symphonique » pourrait bien convenir mais il est restrictif si l’on veut rendre compte de toute la gamme de leurs activités, de plus, il sous-entend (si l’on peut dire) la présence de pas mal de violons et de toute façon cette dénomination sonnait déjà un peu démodé. « Musique de genre » est impropre même si le propre de cette musique du genre « fourre-tout » est, justement de n’avoir aucun genre en particulier. Toujours est-il que les musiciens de ces orchestres de « variétés » devaient pouvoir tout exécuter à la demande : pages choisies du « classiques » (ouvertures d’opéras, ballets…), opérettes et viennoiseries bien sûr, pots-pourris et arrangements -du folklore à la comédie musicale-, toutes les danses en vogue dont des fox-trots, donc, au sens large, du jazz. Ils accompagnaient les revues, les films, les récitals de chanteurs, animaient les dancings, cabarets et thés dansants des grands hôtels et des grands magasins. Ils amusaient dans des chansons-sketchs comiques et parodiques et, sautant de la fosse sur la scène ils furent bientôt le spectacle à eux tout seuls. Voilà pourquoi le terme « jazz de scène », inventé récemment est le mieux propre à les désigner. Ainsi Ray Ventura et ses Collégiens qui, dans leurs années vingt, vivaient pour le jazz et par le jazz en eurent assez, vers 1930 de jouer, entre les potiches et les plantes vertes, des fox-trots amidonnés pour soirées mondaines du XVIème arrondissement. L’esprit gaulois fut invité à la noce et d’anciens Collégiens (Raymond Legrand, Jacques Hélian), les Adisoniens de Fred Adison, les Cadets de Roland Dorsay, les bouillonnants de Jo Bouillon créèrent des bandes rivales où, presque toujours, la gaudriole avait une allure swing. Ils se mirent aussi tout naturellement au latino-américain quand le temps en fut venu.#
3 Nous irons pendre notre linge sur la Ligne Siegfried, grand succès des Collégiens, en 1939, d’ailleurs commis par les anglais – mais c’est encore plus drôle dans la langue des vaincus.#
4 Interview parue au dos d’une pochette d’un 33 tours, seule réédition à notre connaissance de mambos et cha-cha-chas enregistrés entre 1954 et 1957 et parue (Warner Music 005) en 1980, peu avant la mort d’Eddie en 82. #
5 Ibid.#
6 Ce ne sont pas encore ceux de Lalo Schiffrin, parfois décevants d’ailleurs, qui n’intervient que plus tard, en 1954.#
7 Savoureusement démarqué, décalé et re-immortalisé dans le succulent Journal Intime de Nanni Moretti (1994) qui d’ailleurs y clame son désir d’être un bon danseur de musiques latino-américaines.#
8 Jay Presson Allen dans le documentaire de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (1995) d’après le livre de Vito Russo, The Celluloid Closet.#
9 Dans une séquence anthologique, la seule d’ailleurs d’un film passablement lourdingue, Theres’s No Business Like Show Business (1954).#
10 Lequel, dix ans plus tard, devait mourir d’épuisement sur une piste de danse devant son orchestre dans les bras d’une belle !!!#
11 (Chiquito, Palette MPZ-10006) #
12 Qui nous prêta les deux tiers des disques ici réunis et, comme toujours dans un état impeccable.#
13 Nous avons pu voir récemment un extrait intitulé A Chango du film Neptune’s Daughter (1948) au Technicolor dément avec l’orchestre de Xavier Cugat, empereur du kitsch latino, et y constater les os dans les cheveux et les culottes enveloppantes des girls sous les pagnes de voile qui justifient largement le délire de ces lignes. Les scopitones de l’ochestre Gillespie tournés vers 47 / 48 sont, dans le genre kitsch, croquignolets eux aussi et la séquence en langage « petit nègre » de Cubana be, cubana bop vaut son pesant de bananes. Sans parler de la prestation de Marlène dans le numéro Hot Voodoo dans Blonde Venus (1932) où la star émerge en perruque afro ornée de fléchettes d’une peau de gorille (sic), entourée d’un essaim de girls mulâtresses brandissant sagaies et boucliers barbares. Il était du devoir de Josef von Sternberg, à qui aucune forme du baroque n’aura été étrangère, de signer dès 1932 cette séquence culte.#
14 Les Orgueilleux ont assez bien vieilli contrairement à tant de films d’Yves Allegret et la Chnouf reste fascinant à plusieurs degrés comme film et comme document. #
15 Qui avait été la première épouse de Gabin, sa première partenaire à l’écran (Chacun sa chance, 1930 où Jean chantait et dansait !), et qui resta une très bonne copine à qui il trouva souvent un second rôle dans ses films d’après-guerre (Grisbi, Voici le temps des assassins, etc...)#
16 Titre grotesque ou énigmatique (ou les deux) de ce potache de Prado : antistalinisme ou hommage au peuple d’un petit père qui ignora sans doute le mambo jusqu’à son dernier souffle prochain (le père Joseph meurt en 1953) ? A moins que (cherchez la femme) ce ne soit l’hommage à une belle (il y a tout de même nina dans le titre) dont on ne sait où et dont on ne saura peut-être jamais d’où…#
17 On pourrait croire que ces disques n’intéressent à priori plus grand-monde, qu’ils jonchent les vide-greniers et sont donc très facilement trouvables vus les tirages qu’on leur suppose avoir atteint. Et bien l’on se tromperait. Peut-être ont-ils été jetés à la poubelle ce qui expliquerait leur rareté mais, pour trouver du Ruben Calzado en bon état -car ces disques de surprise-party ont été fort malmenés pour la
plupart- il a fallu se lever tôt et les Voulez-vous danser ? et autres Bal du réveillon Columbia nous ont donné bien du fil à retordre.#
18 Chef d’un grand orchestre qui, entre 1930 et les années 60 vulgarisa et commercialisa le rayon entier des musiques chaudes afro-cubano-tropico-latino-hispano-sud-américaines. Rumbas, guarachas, congas et boléros cubains, sambas et bayons brésiliens, mambos et cha-cha-chas portoricains, merengues dominicains et calypsos jamaïcains, sans oublier les bons vieux tangos argentins, paso-dobles et valses espagnoles, hymnes mexicains et bambas, il a tout joué !
English notes
In the early 20th century, Paris was reputed as being not only the European, but even the international capital of art. Indeed, as from 1920, Paris was considered as the hub for artists, including musicians, in particular Blacks from the USA or the French colonial empire. In the same way as London and Berlin, Paris welcomed jazz as soon as it arrived in 1917 and then the Latin American genres in 1930. The craze for Brazilian and West Indian sounds in the thirties and forties has already been covered light-heartedly in our album Amours, Bananes et Ananas and, on a more serious note, in Roots of Mambo.
Before the war, Paris and France’s coastal resorts on the Atlantic and Riviera had already billed Cuban and French West Indian bands. However, these ‘typical’ groups were put aside during Occupation as the fad for swing swept the land. After Liberation came the waves of US swing, the New Orleans revival, be-bop and then, from the southern latitudes, the Brazilian and then Afro-Cuban samba. As the genre was sweetened and tinted by songs and the movie industry, as from 1950 the record labels had to satisfy the growing appetite of the consumers.
Swing had been subverted by the revolutionary boppers and Cuban and Puerto Rican artists were present in their discreet after-hours jam sessions in 1941-44. The teaming up in 1940 of Dizzy Gillespie and Mario Bauza, both trumpeters with Cab Calloway who sometimes played rumbas, guarachas and congas, is often quoted. A year later the two cubop forerunners were both leading bands where Afro-Cuban percussion took pride of place next to the drums. And Charlie Parker frequented the clubs in which Machito’s orchestra was billed and cut a breathtaking Afro-Cuban Jazz Suite with him. During the same period, RCA released some sides with Perez Prado which had already hit Mexico and the US charts: Mambo Jambo, Mambo en Sax, Mambo N° 5, Mambo N° 8, etc.
In 1950, Eddie Warner and Henri Rossotti’s French dance bands recorded the first Parisian mambos. But it was only two or three years later that films and song started following this movement. In 1953 the cha-cha-cha was launched (a mambo on a slow or medium tempo), and the fashion brought back the Latin American craze. Yet the artists, in particular the band leaders, were in majority far from the original lineage. Before the war, the West Indian or Caribbean groups in France (Rico’s Creole Band, Oscar Calle, Lecuona Cuban Boys, etc.) reunited authentic immigrants from distant islands. The musicians in Mambo à Paris are mainly genuine Frenchmen and most had debuted in jazz during its swing period. They first put their hand to the Cuban wave (rumbas, guarachas, boleros) before the hostilities, and then went on to the post-war Brazilian sounds with their samba rhythms. Having barely found their feet in this genre, the mambo hit France just before 1950, a style which corresponded to the joint evolution of these two forms of popular music: North American (jazz) and South American (Cuban). In the thirties, swing and rumba individually followed their paths and then, in the forties, what had become bop and Afro-Cuban teamed up to give birth to cubop. In this respect, the evolution of Warner, Barelli, Rossotti and Bennett, having previously lived through and for jazz, to then adopt the newborn genre was significant. One must remember that after Li-beration French jazzmen, having been severed from external influences for a few years, found it hard to adjust. Big bands were out of breath and were expensive to run.
Eddie Warner’s musical itinerary is a fine example of the 20th century melting-pot. Warner was born as a German citizen in the year when the US troops arrived in Europe with jazz tucked in their pockets. At the age of 17, he left his homeland as a refugee to be in Strasbourg in ’34, Paris in ’37, the Foreign Legion in ’39, Nice in ’41 and was then a member of the Resistance. While travelling, he met Hughes Panassié (founder of the Hot Club de France), Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Henri Salvador and Leonard Feather who quoted him as being one of the best pianists of French jazz. After Li-beration, Warner and his gang played more and more ‘tropical music’ and he was awarded the Grand Prix du Disque in 1947 with Samba samba. Yet 85% of his orchestra was French, the percussionists alone were South American.
His ‘rival’, Henri Rossotti also used the term ‘tropical’ at times. He also came from a jazz background and he was also awarded a Grand Prix du Disque for Cavaquino. In his orchestra, the soli were less frequent than in Warner’s band, giving a more global effect, ideal for the mambo. Some mambos (Mambo du Soir and Mambo Jambo for instance) have an Italian flavour, but then Italy was mambo-crazy. As was the USA, despite its reigning bourgeoisie, racism, paranoia and McCarthyism. id Benny Bennet’s career also zigzag between jazz and Cuban sounds? Born in Venezuela in 1922, Bennet immigrated to the US with his family at the age of two. When 12, he began studying in the Manhattan music school and, still in his teens, started playing in amateur jazz bands and had the opportunity of playing with Coleman Hawkins, Teddy Wilson, Jimmy Blanton, Charlie Barnet. Every Monday night he could be found at Minton’s Play House where he found Thelonius Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Christian and others heralding modern jazz.
His first wife, Cathalina, was a Cuban dancer who opened his eyes to South American music. He thus met and befriended Machito y sus Afro-Cubans who were then playing the rumba guaïda, which was to later become the mambo. As a spectator, Benny was enchanted by the genre as its vitality and rhythms reminded him of jazz and decided to take tuition with Chino, one of the musicians. When Tito Puente quit Machito’s band three months later, Bennet took his place and debuted with the orchestra in La Conga, New York. Following his wife’s advice, he left the band, began a career as a professional dancer and toured the north, Canada and the west. Back in New York, he joined Pupi Campo’s band. In 1942 he toured with the Four Bars of Rhythm. In Florida he was called up and entered the military band, was sent to England where he plane was shot down. He went to France in 1944 and discovered French jazzmen. He was then sent to Germany in the Special Service where he headed the Sky Liners and their 18 musicians.
In 1946 he was demobbed and returned to Paris and spent a year and a half in the Charlie Lewis orchestra and toured with Alix Combelle before returning to the French capital, billed at the Rêve as before. He played in gigs for the Hot Club with great French jazz artists such as Jacques Diéval, Léo Chauliac and Hubert Rostaing and cut the first bop discs in France for the Swing label (and this was before Kenny Clarke!). Hired at Jimmy’s, he went back to his old speciality and introduced the mambo to Paris. But only in 1950, after another contract at the Rêve did he found his first typical orchestra at the Vieux Colombier in Juans les Pins.
While under contract at the Moulin-Rouge and at Carroll’s, he organized the recording of a Brazilian star for Vogue, but the lady in question fell ill at the last moment. He agreed to replace her, resulting in a session with eight of his arrangements. In June 1955, Bennett had to return to the US to renew his American nationality and toured on site for 6 months. He then pursued his career in France, playing the cha-cha-cha, calypso, and meringue until around 1960 when we lost trace of him. On the sleeve of a 1960 Palette disc, we learn that Ruben Calzado was born in Manzanillo, Cuba in November 1916. His rare recorded traces were cut in Havano in 1948 with, among others, Arsenio Rodriguez (guitar) and Chano ‘Pozo’ Rodriguez (conga). The following year he was in Paris playing in chic seaside resorts, though we cannot confirm if headed his own band or not. However, he was an artful arranger and delicate trumpeter as we can appreciate here.
Sébastien Solari’s band does not seem to be a regular orchestra, though could have been a studio group for Odéon. Solari recorded boogies and sambas in 1945 and went on to boleros and mambos a few years later. He even signed some titles with Léopoldo Frances. Among all bands in this selection, his orchestra sounds less typical, less Cuban and maybe has the largest number of players. The supremely exotic titles (Borrasca, Que mala!, Tam tam sur le Congo) can be found with others following the same lines in the first part of CD 2. André Ekyan was one of the greatest French saxophonists of the day, having sided Benny Carter, Coleman Hawkins, Alix Combelle, Django and Grappelli in one of the most prestigious recording sessions of French jazz on 28 April 1937. Around 1950, Ekyan didn’t seem to belong to a regular band, but it is possible that the Solari and Ekyan recordings reunited the same musicians. One must note, however, that the discs under Ekyan’s name are more explosive and swinging than Solari’s.
Publisher Jean Garzon leant more towards Argentinean sounds, but to undoubtedly enlarge his repertory he gave in to the Afro-Cuban vogue with musicians including Lewis Varona who led rumba, bolero and mambo sessions. Some of these pieces are excellent and Mambo à Paris which lends it title to this album deservedly opens the disc. The pianist takes the lion’s share, leading us to believe that Lewis Varona is none other than Luis Varona who, like Calzado, came to preach Cuban sounds in this part of the world after playing in Machito’s Afro Cubans in 1943. Varona left Machito after a few months, but we find him once again around 1950 with Tito Puente. His French recordings were made in 1951. The singers were all black (apart from Ben) and were originally Latin American. But despite their immense contribution to the general atmosphere, not much is known about them. No ladies are present, whereas on the other side of the Atlantic Machito welcomed his sister Graciela and in Paris there was the excellent Chi-quita Serrano who mainly sang with Rico’s Creole Band.
As far as our men are concerned, we only have a few snippets of information. Around 1950 José Bartel was Barelli’s regular singer, and was a guest in our previous anthology, Roots of Mambo. Ruddy Castell was very present in the post-war dance halls in Paris and made many discs either as a band leader or guest (Eddie Warner for example). Umberto Canto Morales was more of an interpreter than leader or organiser and his name is well-associated with that of the Rossotti orchestra, but also appeared with Benny Bennet and Dizzy while the latter was ill during his 1952-53 Paris sojourn. The handsome Mexican singer and dancer Leopoldo Frances held some minor roles in French films in the fifties and appeared next to icons such as Michèle Morgan (Les Orgueilleux), Brigitte Bardot (Et Dieu créa la Femme) and Fernandel (Le Mouton à cinq Pattes and le Port du Désir). Ben, who sang La Mucura with Eddie Warner, founded a combo a few years later which was to be one of France’s greatest representatives of the cha-cha-cha, calypso and merengue before rock took hold. Back in the seventies, the latino genre was hard to come by on disc, although mambo was often featured on the small screen in prime time movies, and fans had to rake through flea market stands to fulfil their needs. As from 1980 a handful of re-issues appeared: Xavier Cugat, Lecuona, Machito, Perez Prado, Beny Moré, Tito Puente and even an Eddie Warner. Then Machito, Puente, Velia Cruz, to name but a few, were increasingly invited to jazz festivals. Sales were stimulated by the compact disc, the younger generations became familiarized with and charmed by this exotic genre which has again become part of today’s musical culture.
English adaptation of Laure WRIGHT from the french text of Eric REMY
© 2007 Frémeaux & Associés
CD MAMBO À PARIS 1949-1953 © Frémeaux & Associés