L'ESPRIT CRÉOLE par vibrations
Le fabuleux destin des Antillais de Paris s’écrit sur plus d’un siècle. Où l’on se rend compte qu’il y a une vie avant et après le zouk.
Il y a un siècle tout juste, au printemps 1902, la montagne Pelée raya d’un jet de lave et de poussière la ville de Saint-Pierre. A l’époque, la métropole martiniquaise forte de près de trente mille âmes était la capitale des Antilles françaises, et plus largement l’une des grandes cités de la créolité caraïbe. Son rayonnement culturel allait bien au-delà des rivages. On y dansait et jouait de la biguine, la musique des salons d’une bourgeoisie métisse bourgeonnante. Née quelques décennies plus tôt, cette musique aux origines incertaines, dont même les plus fameux spécialistes ne se risqueraient pas à en expliquer le nom, combine le souvenir tenace des tambours africains à l’héritage du quadrille. Pour Jean-Pierre Meunier, spécialiste de la question à qui l’on doit de multiples rééditions sur le label Frémeaux, « il s’agit d’une interprétation de la polka à la manière africaine, marquée par les syncopes ». A chacun sa définition. Toujours est-il que quand on songe que la Louisiane fut française, quand on pense que les transactions commerciales et les migrations de population furent fréquentes entre les îles et la côte du Golfe du Mexique, on ne peut manquer de tisser un lien évident entre le jazz qui allait naître aux États-unis et la biguine dont le centre créatif venait de s’éteindre des suites de cette catastrophe naturelle. Jean-Christophe Averty osera même : « Si saint-Pierre n’avait pas été totalement détruite, le jazz y serait né ! ».
Les instruments de la révolte
Á l’orée du vingtième siècle, le mento jamaïcain, le son cubain, la samba brésilienne apparaissaient, styles à l’évidence cousins de la biguine. Chacune de ces musiques nées en ville même les harmonies européennes aux cadences africaines, sur quelques accords de base et une trame mélodique appuyée. On pourrait de même rapprocher les instrumentations…Chacune conserve une part de l’héritage de la grande déportation, longtemps consigné dans des sociétés secrètes, plus ou moins syncrétiques. La biguine porte en elle les stigmates des lewoz et autres chants de veillée, dont elle s’affranchi en s’urbanisant, en même temps que l’esclavage est aboli. Dès lors, deux branches d’un même tronc vont se séparer pour ne se retrouver qu’un siècle et bien des péripéties plus tard. D’un côté, les tambours et la transe rythmique vont nourrir le terreau des mornes, ces petits monts arrondis des îles, des campagnes ; de l’autre, les cordes et la danse mélodique vont se développer sur le pavé des villes. « Mais l’esprit de la biguine a toujours été dans le ka », tempère Eric Vinceno, bassiste guadeloupéen qui a grandi avec les grands maîtres du genre mais qui a aussi retenu les leçons du jazz appris à Berklee. En 2002,il est temps pour sa génération de réunir enfin ces deux traditions. Il est temps de réexaminer à leur juste valeur le gwo ka et son équivalent martiniquais le bel-air, ces instruments ces instruments de la révolte, de la résistance à la colonisation. Ces longs fûts taillés dans les barriques de rhum conservent les origines de antillais, demeurent les porte-parole de leur originalité. « Le ka, ce n’est pas qu’un rythme et un tambour. C’est un phrasé, un sens mélodique. Il y a toute une dimension spirituelle », ajoute Vinceno. Tandis que la biguine devient l’emblème, puis le zouk, de la musique antillaise, le ka est rejeté aux oubliettes d’une histoire filtrée selon les critères politiques de la métropole. Il y a bien des raisons d’expliquer l’attitude de la France dans cette affaire, qui n’a jamais favorisé cette expression. Si la conga et le djembé n’ont pas de secrets pour le français moyen, le ka et le bel air font figures d’illustres inconnus pour la plupart. Ce n’est pas là l’un des moindres paradoxes de cette drôle d’histoire coloniale qui fit taire les tambours, bannir le créole de l’école jusque dans les années 60, tandis que nombre d’antillais affichaient l’envie de se blanchir, de s’assimiler pour réussir en s’intégrant au risque de se désintégrer…
Précurseurs et passeurs
« Pendant très longtemps, la musique antillaise a été parquée, réduite à la Compagnie créole et Kassav. Et pourtant depuis le début du siècle, les Antillais ont apporté beaucoup de musique dans leurs bagages. Mais les français ne se sont pas rendu compte que le chaînon manquant entre les États-unis et l’Europe, c’était les Antilles ! Les décideurs ont privilégié les Afro-américains ». L’écrivain et musicien Roland Brival ne cache pas son amertume face à une métropole qui a privilégié la voie « doudouiste », plus simple à contrôler que celle d’une réelle diversité, loin de tout exotisme bon teint, mais sans doute plus proche des discours indépendantistes. A toutes les époques, les Antillais ont été à la fois précurseurs et passeurs, conservant leur accent spécifique tout en adaptant avec aisance aux autres musiques. Pour Vinceno, « les Antillais ont plus de facilités à jouer tous les répertoires. Ils ont l’oreille. C’est sans dout du à notre culture créole ». Albert Lirvat, l’un des mentors de l’époque, précise : « Contrairement aux Cubains, nous avons la chance de pouvoir jouer n’importe quel style. Si on avait eu un conservatoire aux Antilles, on aurait sorti des musiciens extraordinaires ». Sans, ce n’est déjà pas si mal…De Félix Valvert, surnommé « roi de la rumba » dans le Paris des années 30 à Daddy Yod, « prophète » en son genre d’un dancehall à la française au milieu des années 80. Du virtuose Stellio, clarinettiste qui débarque avec la biguine du « serpent maigre » et un sens inné du swing dans le Paris des années folles, à Henri Guédon, qui fera chavirer tambour battant la capitale avec sa salsa. De Liquid Rock, trio en fusion dirigé par Alain Jean-Marie dès les années 60 aux grandes fanfares créoles d’Eddy Louiss…Et que dire de Vélo, véloce tambourinaire qui finira sur les trottoirs de Pointe-à-Pitre le 5 Juin 1984…
Paris, terre d’accueil
Des orchestres de « jazz » des années 20 aux solistes tels que que le saxophoniste Emilen Antile, le guitariste André Coudouant, le clarinettiste Robert Noisron, le pianiste Michel sradaby qui s’illustrèrent à la suite du bop, les Antilles ont envoyé des bataillons de musiciens, des générations d’excellents instrumentistes, mais pour peupler les longues nuits de séance studio plus que pour exprimer leurs différences de styles. Rares sont ceux qui réussiront à se faire un nom, à passer à la postérité du patrimoine national. Des pianistes en pagaille, des souffleurs en rafale, des tambours en série, des chanteurs d’exception…Des dynasties entières quand on songe aux Louiss, père et fils, à la fratrie Jean-Marie, à la famille Fanfant, de Roger directeur d’orchestre dans les années 20 à Jean-Philippe, qui a traversé le siècle et du mêm coup tout le spectre de la musique noire. Tous ceux-là seront bien là parmi les plus grands, bien peu sur le devant de la scène. Tous iront contre mauvaise fortune aller chercher la reconnaissance à Paris. « et sans doute inconsciemment une respectabilité ; Mais en même temps, ils étaient porteurs de leurs différences, des idées nouvelles nées aux États-unis », souligne Vinceno. L’émigration s’accélère avec l’exposition coloniale de 1931, où les soufflants antillais s’affichent tout pavillon dehors. C’est à la capitale que ces amateurs se professionnalisent, s’inspirent des autres musiques pour créer, même si la biguine tient alors le haut du pavé. Le phénomène va s’amplifier avec la guerre, et l’impossibilité pour les musiciens américains de venir swinguer. « La guerre a permis aux Antillais de remplacer les Américains dans les grands orchestres. Cela s’est fait naturellement d’autant que certains, comme Sam Castendet, avaient déjà gravé des pièces de jazz avant-guerre. Ils jouaient à l’identique. Un musicien comme Mavounzy était capable de tout mémoriser et rejouer, ajoutant un petit vibrato très personnel », analyse Jean-Pierre Meunier. Le jazz, les musique cubaines et autres versions latines n’ont plus aucun secret pour les antillais. Mais l’âge d’or de la biguine se situe dans l’après guerre et les années 1950. C’est l’époque des grands lieux qui font courir le tout-Paris, mais aussi les musiciens américains de passage. Il n’est pas rare d’y entendre les grands jazzmen de passage y boeuffer tard dans la nuit. Il y a la Boule Blanche, la Canne à Sucre, le bal de la rue Blomet…Il y a surtout La Cigale, la grande brasserie de Pigalle qui va brasser toutes les générations jusqu’à sa fermeture, le 28 Septembre 1975.
Le wabap d’Al Lirvat
Du haut de ses 87 printemps, Al Lirvat se souvient de ses vertes années. Sa carrière est exemplaire, son style emblématique. Guitariste autodidacte, il déboule de sa guadeloupe en Décembre 1935. Il est déjà un bon musicien amateur, un compositeur en herbe, mais pas encore le visionnaire loué par tous. Plusieurs rencontres vont s’avérer décisives, à commencer par celle avec Félix Valvert : « Il m’a embauché dans son orchestre pour remplacer son tromboniste qui venait de mourir. Seulement, moi, j’étais guitariste ! J’ai donc tout appris à l’oreille, en travaillant les chorus de Jack Teagarden, JJ Johnson et JC Hingginbotham ». C’est ainsi qu’il se met au jazz américain, initié par son ami Charles Delaunay. Il est vite cité au plus haut dans les classements du Hot Club. Et là, deuxième révélation qui cette fois va révolutionner la biguine. « En février 1948, j’ai assisté comme tous ceux qui étaient curieux au concert de Dizzy avec Chano Pozzo à Pleyel. Bien entendu, dans ce déluge de notes, on n’y comprenais rien ! Mais quand j’ai commencé à piger, tout est devenu limpide. Et je me suis dit : pourquoi ne pas faire pareil avec la biguine ? » Il crée alors le wabap, c’est-à-dire les principes du cubop et du bebop appliqués à la biguine, qu’il modernise en intégrant des assonances et des dissonances, des accords altérés et des rythmes en cinq, six et sept temps. « Le nom m’a été soufflé par Nelly, une danseuse de la Canne à Sucre ». « Doudou pas pleuré » sera le titre phare qui marque une rupture avec la tradition des années 1950. Dès lors, il ne sera jamais plus tout à fait considéré comme un musicien de biguine ni comme un musicien de jazz par les puristes des deux côtés. Entre les deux, ce mélodiste raffiné était surtout en avance de cinquante ans ! Il suffit de se pencher sur ses quelques 250 compositions originales pour mesurer le talent de ce personnage qui, à la fin des années 1960 va encore inventer un nouveau rythme, le kalangué, bientôt suivi par le beka. « Deux temps after beat, deux temps biguine : la parfaite combinaison ! C’était aussi une danse, avec une cavalière et des pas bien précis ». Et de mimer sa danse sous les lambris de sa vaste demeure aux allures de palais habanero. « C’était chouette !». L’expression nous rappelle un autre « Antillais » revenu d’on ne sait où : Henri Salvador, lui aussi guitariste et fin mélodiste. En 2002, Al Lirvat vit toujours à Paris, il est encore absent des encyclopédies de jazz, au même titre que l’immense saxophoniste Robert Mavounzy.
Le Tépaz de Ti Marcel
Á deux pas de chez lui, on retrouve un autre rescapé de la belle époque des mazurkas et biguines. Le saxophoniste martiniquais Ti Marcel, de son vrai nom Marcel Louis-Joseph, n’a « que » 72 ans. Lui aussi a débuté en autodidacte, « sur le pipeau de mon cousin », puis sur un biniou troqué contre un biclou. Ti Marcel découvre le jazz en gagnant à la loterie un Tépaz et un 75-78 tours de jazz. « Johnny Hodges, Coleman Hawkins et surtout Don Byas ». Il les rejoue note à note, tant et si bien que très vite on surnomme le jeune homme Don Byas. Le jour où il croise l’Américain aux Trois-Maillets, celui-ci l’invite à « se démarquer de son jeu ». Mais voilà, celui qui affirme avoir joué de tout, « du mambo, du paso doble, des boléros, des guarachas », a pour modèle les grands ténors américains de l’époque : Lester Young et Sonny Rollins, plus que Stellio et Sylvio Siobud…
S’il a connu une carrière bien remplie, s’il a joué avec Quincy Jones début 60, Ti Marcel restera pour la mémoire un bon musicien de séance, n’ayant gravé qu’un disque sous son nom. Il ne regrette rien, bien au contraire. « Si j’étais resté au pays, je seraiplus connu, mais moins fort techniquement ». Et le retraité des affaires d’enchaîner quelques chorus chaloupés, du Rollins et une biguine. « Avec un solo de jazz, j’peux pas m’en empêcher ! ».
La salsa du démon Guédon.
Originaire de Fort-de-France et influencé par Sainte-Marie, « lieu mythique et mystique du bel air, l’équivalent du guaguanco cubain », le touche-à-tout Henri Guédon fut lui aussi un musicien attentif aux nouveaux courants venus des Etats-Unis. C’est ainsi qu’il créera très tôt la contesta, marquée par la musique latine, mais c’est endébarquant en France qu’il prend un temps d’avance sur son époque. Il participe aux prémices de la fusion du Chat qui Pêche avec Loe Maka et Tony Scott et au début des années 1970, de retour de New York, il s’illustre en créant un big band de jazz caraïbes aux fortes consonances salsa. « A Paris, nous avion plus de possibilités, les producteurs étaient plus ouverts », se souvient le quasi-sexagénaire assagi qui réalisa « les premières adaptations créoles de classiques cubains ». C’est à lui que l’on doit la vague zouk, « un mot tiré du créole qui désignait une pauvre paillote, un lieu de perdition qui accueillait toutes les fusions avec les tambours ». Aujourd’hui épuisés, « Cosmozouk » et « Zouk experience » sortirent sur CBS au milieu des années 70.Á écouter ces tourneries insensées, on mesure le contresens historique et esthétique qui va suivre, même si les premiers disques de Kassav, de Malavoi, sont loin d’être sans qualité. « Le zouk ne me gêne pas. Il y en a juste trop, et pas assez bon ». A l’époque, il enflamme L’escale, lieu de rendez-vous des danseurs et transeurs. Avec le recul, celui qui se considérait comme un franc-tireur, l’ami de Pierre Goldman, estime que « cette attitude a fait avancer les choses ». « Je me souviens que le public communautaire nous sifflait. Il nous fallait prendre le maquis ! Mais nous avons montré le chemin aux plus jeunes ». Depuis bientôt vingt ans, le percussioniste-compositeur s’est fait plus discret, favorisant une autre facette de son travail, les arts plastiques. Il n’en reste pas moins créatif, toujours prompt à se lancer dans l’aventure si tant est qu’on lui donne l’envie et la place. La réécoute attentive de disques comme « Afro Blue » et « Afro Temple » est un argument qui devrait achever de convaincre les plus sceptiques…
Retour aux racines
Si la fermeture de la Cigale conclut la fin d’une ère, celle d’un jazz antillais aux couleurs de la biguine, c’est à la même époque que débarquent progressivement d’autres musiciens, cette fois plus soucieux de valoriser leurs origines africaines. L’heure n’est pas encore à la world, mais déjà à la « musique racine ». Le ka et la flûte en bambou peuvent enfin desczendre des mornes. Depuis les années 60, quelques maisons (Cellini, Emeraude, Mavounzy) publient des disques de cette musique de « mauvais garçons », mal considérée voire envisagée comme une tache sur les vestons bien propres et lisses de la bourgeoisie typique. « dans le miouvement d’assimilation, le ka était un symbole dérangeant. Pour moi, il est l’affirmation de notre identité », pointe Klod Kiavé, tambourinaire guadeloupéen arrivé en 1994 avec la dernière vague et coleader du groupe Wopso. Q’importe : les temps changent, l’heure est à l’indépendance et les tambours sont là pour rappeler de douloureux souvenirs. En la matière, quelques personalités vont vite s’illustrer : le flûtiste Max Cilla, les percussionistes Robert Loyson, Ti Raoul Grivalliers…Là encore, impossible de tous les citer tant le vivier est riche. Il en est deux pourtant que l’on ne peut passer sous silence : Eugène Mona et Marcel Lollia, plus connu sous le sobriquet de Vélo. Le premier est martiniquais, joue de la flûte et chante comme Fela. Le second est guadeloupéen et frappe les peaux aussi fort, aussi juste, qu’un Patato. L’un et l’autre incarnent l’âme noire qui renaît. La légende de l’un et le mythe de l’autre ne traverseront jamais tout l’océan. Vélo terminera dans le caniveau, Mona dans le quasi oubli. Et pourtant n’importe quel percussionniste antillais vous dira que Vélo était le meilleur marqueur, à la fois le plus ouvert et le plus conscient de ses racines. L’un comme l’autre ont réveillé les consciences. Leur spiritualité va irradier toutes les générations à venir à Paris. D’autant mieux qu’en métropole, l’heure est au free. Les héritiers de Césaire peuvent enfin sortir du ghetto, la musique bwa-bwa ou chouval-bwa raisonner de son plus bel écho. Et là encore, la parenté est évidente avec les musiques noires américaines. « Il existe un sentiment ka comme il existe un sentiment blues », résume Klod Kiavé. « Le boladieul, c'est-à-dire le tambour de bouche dans la musique ka, c’est du scat qui s’ignore », précise Roland Brival. […]
Trois livres pour en savoir plus
« Félix Valvert, le roi de la rumba » (Ed. New Legend), par Isabelle de Valvert. La biographie du saxophoniste et chef d’orchestre qui en forma plus d’un. Á noter la future parution dans la même collection d’un ouvrage consacré à Al Lirvat. « La Biguine de l’Oncle Ben’s » (Ed. Caribéennes), par Jean-Pierre Meunier et Brigitte Léardée. Avant de devenir le célèbre Oncle Ben’s, Ernest Léardée a traversé le siècle et l’océan pour imposer à Paris le son typique de la biguine.
« Musiques & musiciens de la Guadeloupe », par Alex et Françoise Uri. Un ouvrage un peu ancien mais qui a l’intérêt de bien insister sur les racines de la musique antillaise.
Jacques DENIS
© VIBRATIONS
Le fabuleux destin des Antillais de Paris s’écrit sur plus d’un siècle. Où l’on se rend compte qu’il y a une vie avant et après le zouk.
Il y a un siècle tout juste, au printemps 1902, la montagne Pelée raya d’un jet de lave et de poussière la ville de Saint-Pierre. A l’époque, la métropole martiniquaise forte de près de trente mille âmes était la capitale des Antilles françaises, et plus largement l’une des grandes cités de la créolité caraïbe. Son rayonnement culturel allait bien au-delà des rivages. On y dansait et jouait de la biguine, la musique des salons d’une bourgeoisie métisse bourgeonnante. Née quelques décennies plus tôt, cette musique aux origines incertaines, dont même les plus fameux spécialistes ne se risqueraient pas à en expliquer le nom, combine le souvenir tenace des tambours africains à l’héritage du quadrille. Pour Jean-Pierre Meunier, spécialiste de la question à qui l’on doit de multiples rééditions sur le label Frémeaux, « il s’agit d’une interprétation de la polka à la manière africaine, marquée par les syncopes ». A chacun sa définition. Toujours est-il que quand on songe que la Louisiane fut française, quand on pense que les transactions commerciales et les migrations de population furent fréquentes entre les îles et la côte du Golfe du Mexique, on ne peut manquer de tisser un lien évident entre le jazz qui allait naître aux États-unis et la biguine dont le centre créatif venait de s’éteindre des suites de cette catastrophe naturelle. Jean-Christophe Averty osera même : « Si saint-Pierre n’avait pas été totalement détruite, le jazz y serait né ! ».
Les instruments de la révolte
Á l’orée du vingtième siècle, le mento jamaïcain, le son cubain, la samba brésilienne apparaissaient, styles à l’évidence cousins de la biguine. Chacune de ces musiques nées en ville même les harmonies européennes aux cadences africaines, sur quelques accords de base et une trame mélodique appuyée. On pourrait de même rapprocher les instrumentations…Chacune conserve une part de l’héritage de la grande déportation, longtemps consigné dans des sociétés secrètes, plus ou moins syncrétiques. La biguine porte en elle les stigmates des lewoz et autres chants de veillée, dont elle s’affranchi en s’urbanisant, en même temps que l’esclavage est aboli. Dès lors, deux branches d’un même tronc vont se séparer pour ne se retrouver qu’un siècle et bien des péripéties plus tard. D’un côté, les tambours et la transe rythmique vont nourrir le terreau des mornes, ces petits monts arrondis des îles, des campagnes ; de l’autre, les cordes et la danse mélodique vont se développer sur le pavé des villes. « Mais l’esprit de la biguine a toujours été dans le ka », tempère Eric Vinceno, bassiste guadeloupéen qui a grandi avec les grands maîtres du genre mais qui a aussi retenu les leçons du jazz appris à Berklee. En 2002,il est temps pour sa génération de réunir enfin ces deux traditions. Il est temps de réexaminer à leur juste valeur le gwo ka et son équivalent martiniquais le bel-air, ces instruments ces instruments de la révolte, de la résistance à la colonisation. Ces longs fûts taillés dans les barriques de rhum conservent les origines de antillais, demeurent les porte-parole de leur originalité. « Le ka, ce n’est pas qu’un rythme et un tambour. C’est un phrasé, un sens mélodique. Il y a toute une dimension spirituelle », ajoute Vinceno. Tandis que la biguine devient l’emblème, puis le zouk, de la musique antillaise, le ka est rejeté aux oubliettes d’une histoire filtrée selon les critères politiques de la métropole. Il y a bien des raisons d’expliquer l’attitude de la France dans cette affaire, qui n’a jamais favorisé cette expression. Si la conga et le djembé n’ont pas de secrets pour le français moyen, le ka et le bel air font figures d’illustres inconnus pour la plupart. Ce n’est pas là l’un des moindres paradoxes de cette drôle d’histoire coloniale qui fit taire les tambours, bannir le créole de l’école jusque dans les années 60, tandis que nombre d’antillais affichaient l’envie de se blanchir, de s’assimiler pour réussir en s’intégrant au risque de se désintégrer…
Précurseurs et passeurs
« Pendant très longtemps, la musique antillaise a été parquée, réduite à la Compagnie créole et Kassav. Et pourtant depuis le début du siècle, les Antillais ont apporté beaucoup de musique dans leurs bagages. Mais les français ne se sont pas rendu compte que le chaînon manquant entre les États-unis et l’Europe, c’était les Antilles ! Les décideurs ont privilégié les Afro-américains ». L’écrivain et musicien Roland Brival ne cache pas son amertume face à une métropole qui a privilégié la voie « doudouiste », plus simple à contrôler que celle d’une réelle diversité, loin de tout exotisme bon teint, mais sans doute plus proche des discours indépendantistes. A toutes les époques, les Antillais ont été à la fois précurseurs et passeurs, conservant leur accent spécifique tout en adaptant avec aisance aux autres musiques. Pour Vinceno, « les Antillais ont plus de facilités à jouer tous les répertoires. Ils ont l’oreille. C’est sans dout du à notre culture créole ». Albert Lirvat, l’un des mentors de l’époque, précise : « Contrairement aux Cubains, nous avons la chance de pouvoir jouer n’importe quel style. Si on avait eu un conservatoire aux Antilles, on aurait sorti des musiciens extraordinaires ». Sans, ce n’est déjà pas si mal…De Félix Valvert, surnommé « roi de la rumba » dans le Paris des années 30 à Daddy Yod, « prophète » en son genre d’un dancehall à la française au milieu des années 80. Du virtuose Stellio, clarinettiste qui débarque avec la biguine du « serpent maigre » et un sens inné du swing dans le Paris des années folles, à Henri Guédon, qui fera chavirer tambour battant la capitale avec sa salsa. De Liquid Rock, trio en fusion dirigé par Alain Jean-Marie dès les années 60 aux grandes fanfares créoles d’Eddy Louiss…Et que dire de Vélo, véloce tambourinaire qui finira sur les trottoirs de Pointe-à-Pitre le 5 Juin 1984…
Paris, terre d’accueil
Des orchestres de « jazz » des années 20 aux solistes tels que que le saxophoniste Emilen Antile, le guitariste André Coudouant, le clarinettiste Robert Noisron, le pianiste Michel sradaby qui s’illustrèrent à la suite du bop, les Antilles ont envoyé des bataillons de musiciens, des générations d’excellents instrumentistes, mais pour peupler les longues nuits de séance studio plus que pour exprimer leurs différences de styles. Rares sont ceux qui réussiront à se faire un nom, à passer à la postérité du patrimoine national. Des pianistes en pagaille, des souffleurs en rafale, des tambours en série, des chanteurs d’exception…Des dynasties entières quand on songe aux Louiss, père et fils, à la fratrie Jean-Marie, à la famille Fanfant, de Roger directeur d’orchestre dans les années 20 à Jean-Philippe, qui a traversé le siècle et du mêm coup tout le spectre de la musique noire. Tous ceux-là seront bien là parmi les plus grands, bien peu sur le devant de la scène. Tous iront contre mauvaise fortune aller chercher la reconnaissance à Paris. « et sans doute inconsciemment une respectabilité ; Mais en même temps, ils étaient porteurs de leurs différences, des idées nouvelles nées aux États-unis », souligne Vinceno. L’émigration s’accélère avec l’exposition coloniale de 1931, où les soufflants antillais s’affichent tout pavillon dehors. C’est à la capitale que ces amateurs se professionnalisent, s’inspirent des autres musiques pour créer, même si la biguine tient alors le haut du pavé. Le phénomène va s’amplifier avec la guerre, et l’impossibilité pour les musiciens américains de venir swinguer. « La guerre a permis aux Antillais de remplacer les Américains dans les grands orchestres. Cela s’est fait naturellement d’autant que certains, comme Sam Castendet, avaient déjà gravé des pièces de jazz avant-guerre. Ils jouaient à l’identique. Un musicien comme Mavounzy était capable de tout mémoriser et rejouer, ajoutant un petit vibrato très personnel », analyse Jean-Pierre Meunier. Le jazz, les musique cubaines et autres versions latines n’ont plus aucun secret pour les antillais. Mais l’âge d’or de la biguine se situe dans l’après guerre et les années 1950. C’est l’époque des grands lieux qui font courir le tout-Paris, mais aussi les musiciens américains de passage. Il n’est pas rare d’y entendre les grands jazzmen de passage y boeuffer tard dans la nuit. Il y a la Boule Blanche, la Canne à Sucre, le bal de la rue Blomet…Il y a surtout La Cigale, la grande brasserie de Pigalle qui va brasser toutes les générations jusqu’à sa fermeture, le 28 Septembre 1975.
Le wabap d’Al Lirvat
Du haut de ses 87 printemps, Al Lirvat se souvient de ses vertes années. Sa carrière est exemplaire, son style emblématique. Guitariste autodidacte, il déboule de sa guadeloupe en Décembre 1935. Il est déjà un bon musicien amateur, un compositeur en herbe, mais pas encore le visionnaire loué par tous. Plusieurs rencontres vont s’avérer décisives, à commencer par celle avec Félix Valvert : « Il m’a embauché dans son orchestre pour remplacer son tromboniste qui venait de mourir. Seulement, moi, j’étais guitariste ! J’ai donc tout appris à l’oreille, en travaillant les chorus de Jack Teagarden, JJ Johnson et JC Hingginbotham ». C’est ainsi qu’il se met au jazz américain, initié par son ami Charles Delaunay. Il est vite cité au plus haut dans les classements du Hot Club. Et là, deuxième révélation qui cette fois va révolutionner la biguine. « En février 1948, j’ai assisté comme tous ceux qui étaient curieux au concert de Dizzy avec Chano Pozzo à Pleyel. Bien entendu, dans ce déluge de notes, on n’y comprenais rien ! Mais quand j’ai commencé à piger, tout est devenu limpide. Et je me suis dit : pourquoi ne pas faire pareil avec la biguine ? » Il crée alors le wabap, c’est-à-dire les principes du cubop et du bebop appliqués à la biguine, qu’il modernise en intégrant des assonances et des dissonances, des accords altérés et des rythmes en cinq, six et sept temps. « Le nom m’a été soufflé par Nelly, une danseuse de la Canne à Sucre ». « Doudou pas pleuré » sera le titre phare qui marque une rupture avec la tradition des années 1950. Dès lors, il ne sera jamais plus tout à fait considéré comme un musicien de biguine ni comme un musicien de jazz par les puristes des deux côtés. Entre les deux, ce mélodiste raffiné était surtout en avance de cinquante ans ! Il suffit de se pencher sur ses quelques 250 compositions originales pour mesurer le talent de ce personnage qui, à la fin des années 1960 va encore inventer un nouveau rythme, le kalangué, bientôt suivi par le beka. « Deux temps after beat, deux temps biguine : la parfaite combinaison ! C’était aussi une danse, avec une cavalière et des pas bien précis ». Et de mimer sa danse sous les lambris de sa vaste demeure aux allures de palais habanero. « C’était chouette !». L’expression nous rappelle un autre « Antillais » revenu d’on ne sait où : Henri Salvador, lui aussi guitariste et fin mélodiste. En 2002, Al Lirvat vit toujours à Paris, il est encore absent des encyclopédies de jazz, au même titre que l’immense saxophoniste Robert Mavounzy.
Le Tépaz de Ti Marcel
Á deux pas de chez lui, on retrouve un autre rescapé de la belle époque des mazurkas et biguines. Le saxophoniste martiniquais Ti Marcel, de son vrai nom Marcel Louis-Joseph, n’a « que » 72 ans. Lui aussi a débuté en autodidacte, « sur le pipeau de mon cousin », puis sur un biniou troqué contre un biclou. Ti Marcel découvre le jazz en gagnant à la loterie un Tépaz et un 75-78 tours de jazz. « Johnny Hodges, Coleman Hawkins et surtout Don Byas ». Il les rejoue note à note, tant et si bien que très vite on surnomme le jeune homme Don Byas. Le jour où il croise l’Américain aux Trois-Maillets, celui-ci l’invite à « se démarquer de son jeu ». Mais voilà, celui qui affirme avoir joué de tout, « du mambo, du paso doble, des boléros, des guarachas », a pour modèle les grands ténors américains de l’époque : Lester Young et Sonny Rollins, plus que Stellio et Sylvio Siobud…
S’il a connu une carrière bien remplie, s’il a joué avec Quincy Jones début 60, Ti Marcel restera pour la mémoire un bon musicien de séance, n’ayant gravé qu’un disque sous son nom. Il ne regrette rien, bien au contraire. « Si j’étais resté au pays, je seraiplus connu, mais moins fort techniquement ». Et le retraité des affaires d’enchaîner quelques chorus chaloupés, du Rollins et une biguine. « Avec un solo de jazz, j’peux pas m’en empêcher ! ».
La salsa du démon Guédon.
Originaire de Fort-de-France et influencé par Sainte-Marie, « lieu mythique et mystique du bel air, l’équivalent du guaguanco cubain », le touche-à-tout Henri Guédon fut lui aussi un musicien attentif aux nouveaux courants venus des Etats-Unis. C’est ainsi qu’il créera très tôt la contesta, marquée par la musique latine, mais c’est endébarquant en France qu’il prend un temps d’avance sur son époque. Il participe aux prémices de la fusion du Chat qui Pêche avec Loe Maka et Tony Scott et au début des années 1970, de retour de New York, il s’illustre en créant un big band de jazz caraïbes aux fortes consonances salsa. « A Paris, nous avion plus de possibilités, les producteurs étaient plus ouverts », se souvient le quasi-sexagénaire assagi qui réalisa « les premières adaptations créoles de classiques cubains ». C’est à lui que l’on doit la vague zouk, « un mot tiré du créole qui désignait une pauvre paillote, un lieu de perdition qui accueillait toutes les fusions avec les tambours ». Aujourd’hui épuisés, « Cosmozouk » et « Zouk experience » sortirent sur CBS au milieu des années 70.Á écouter ces tourneries insensées, on mesure le contresens historique et esthétique qui va suivre, même si les premiers disques de Kassav, de Malavoi, sont loin d’être sans qualité. « Le zouk ne me gêne pas. Il y en a juste trop, et pas assez bon ». A l’époque, il enflamme L’escale, lieu de rendez-vous des danseurs et transeurs. Avec le recul, celui qui se considérait comme un franc-tireur, l’ami de Pierre Goldman, estime que « cette attitude a fait avancer les choses ». « Je me souviens que le public communautaire nous sifflait. Il nous fallait prendre le maquis ! Mais nous avons montré le chemin aux plus jeunes ». Depuis bientôt vingt ans, le percussioniste-compositeur s’est fait plus discret, favorisant une autre facette de son travail, les arts plastiques. Il n’en reste pas moins créatif, toujours prompt à se lancer dans l’aventure si tant est qu’on lui donne l’envie et la place. La réécoute attentive de disques comme « Afro Blue » et « Afro Temple » est un argument qui devrait achever de convaincre les plus sceptiques…
Retour aux racines
Si la fermeture de la Cigale conclut la fin d’une ère, celle d’un jazz antillais aux couleurs de la biguine, c’est à la même époque que débarquent progressivement d’autres musiciens, cette fois plus soucieux de valoriser leurs origines africaines. L’heure n’est pas encore à la world, mais déjà à la « musique racine ». Le ka et la flûte en bambou peuvent enfin desczendre des mornes. Depuis les années 60, quelques maisons (Cellini, Emeraude, Mavounzy) publient des disques de cette musique de « mauvais garçons », mal considérée voire envisagée comme une tache sur les vestons bien propres et lisses de la bourgeoisie typique. « dans le miouvement d’assimilation, le ka était un symbole dérangeant. Pour moi, il est l’affirmation de notre identité », pointe Klod Kiavé, tambourinaire guadeloupéen arrivé en 1994 avec la dernière vague et coleader du groupe Wopso. Q’importe : les temps changent, l’heure est à l’indépendance et les tambours sont là pour rappeler de douloureux souvenirs. En la matière, quelques personalités vont vite s’illustrer : le flûtiste Max Cilla, les percussionistes Robert Loyson, Ti Raoul Grivalliers…Là encore, impossible de tous les citer tant le vivier est riche. Il en est deux pourtant que l’on ne peut passer sous silence : Eugène Mona et Marcel Lollia, plus connu sous le sobriquet de Vélo. Le premier est martiniquais, joue de la flûte et chante comme Fela. Le second est guadeloupéen et frappe les peaux aussi fort, aussi juste, qu’un Patato. L’un et l’autre incarnent l’âme noire qui renaît. La légende de l’un et le mythe de l’autre ne traverseront jamais tout l’océan. Vélo terminera dans le caniveau, Mona dans le quasi oubli. Et pourtant n’importe quel percussionniste antillais vous dira que Vélo était le meilleur marqueur, à la fois le plus ouvert et le plus conscient de ses racines. L’un comme l’autre ont réveillé les consciences. Leur spiritualité va irradier toutes les générations à venir à Paris. D’autant mieux qu’en métropole, l’heure est au free. Les héritiers de Césaire peuvent enfin sortir du ghetto, la musique bwa-bwa ou chouval-bwa raisonner de son plus bel écho. Et là encore, la parenté est évidente avec les musiques noires américaines. « Il existe un sentiment ka comme il existe un sentiment blues », résume Klod Kiavé. « Le boladieul, c'est-à-dire le tambour de bouche dans la musique ka, c’est du scat qui s’ignore », précise Roland Brival. […]
Trois livres pour en savoir plus
« Félix Valvert, le roi de la rumba » (Ed. New Legend), par Isabelle de Valvert. La biographie du saxophoniste et chef d’orchestre qui en forma plus d’un. Á noter la future parution dans la même collection d’un ouvrage consacré à Al Lirvat. « La Biguine de l’Oncle Ben’s » (Ed. Caribéennes), par Jean-Pierre Meunier et Brigitte Léardée. Avant de devenir le célèbre Oncle Ben’s, Ernest Léardée a traversé le siècle et l’océan pour imposer à Paris le son typique de la biguine.
« Musiques & musiciens de la Guadeloupe », par Alex et Françoise Uri. Un ouvrage un peu ancien mais qui a l’intérêt de bien insister sur les racines de la musique antillaise.
Jacques DENIS
© VIBRATIONS
Produits associés

Ernest Leardee - Rythmes Des Antilles 1951-1954
AVEC L’INTEGRALE ANDRE SALVADOR
29,99 €
19,95 €
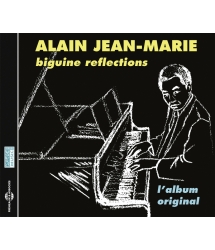
Biguine Reflections
ALAIN JEAN-MARIE
19,99 €
9,95 €

Malavoi
PREMIERS ENREGISTREMENTS (1969)
19,99 €
9,95 €
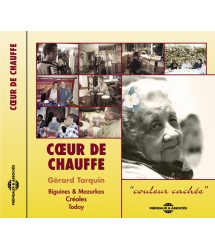
Gérard Tarquin – Cœur de Chauffe
COULEUR CACHEE
19,99 €
9,95 €
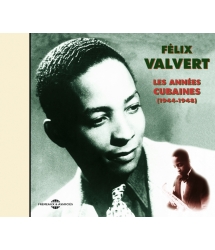
Felix Valvert
LES ANNEES CUBAINES 1944 - 1948
19,99 €
9,95 €

Swing Caraibe
CARIBBEAN JAZZ PIONEERS IN PARIS 1929 - 1946
29,99 €
19,95 €
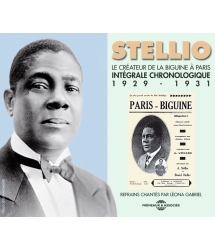
Stellio
INTEGRALE CHRONOLOGIQUE 1929-1931
29,99 €
19,95 €










